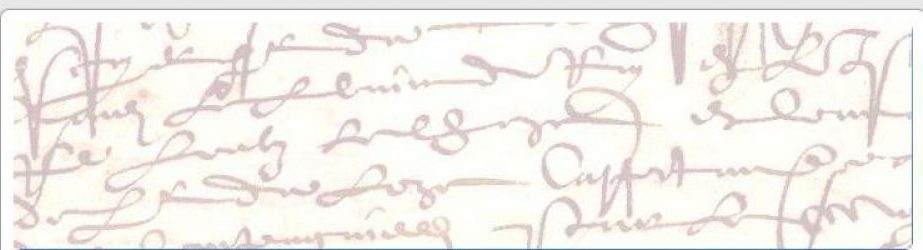Cette chanson de geste, long, très long poème à la gloire d’Olivier de Clisson et sa femme Jeanne de Bellevile, écrit par Emile Péhant, est numérisé sur GALLICA, et j’ai seulement remis en forme le texte après avoir corrigé les quelques erreurs de texte de la machine.
tome 2
ÉMILE PÉHANT
CONSERVATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUÉ PUBLIQUE DE NANTES
CHANSON DE GESTE En plusieurs poëmes distincts
Éditeur : V. Forest et Grimaud (Nantes)
Éditeur : A. Aubry (Paris, 1868)
Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, YE-29702
Table des matières
QUATRIÈME PARTIE : LE SERMENT. 2
I. LA SÈVRE NANTAISE. 2
II. LE REPAS CHAMPÊTRE. 5
III. LES RENCONTRES DE NUIT. 8
IV. L’ARRIVÉE A NANTES. 11
V. LES DOUVES SAINT-NICOLAS. 13
VI. LA PORTE SAUVETOUR. 16
VII. – LA MALÉDICTION. 19
VIII. L’APPEL A LA VENGEANCE. 23
IX. LES CONFIDENCES DANGEREUSES. 26
CINQUIÈME PARTIE : LA VENGEANCE. 31
I. CHATEAU-THÉBAUD. 31
II. LA SURPRISE. 34
III. – LE GALOIS DE LA HEUSE. 37
IV. LE FLÉAU DE DIEU. 40
V. PÉAN DE MALESTROIT. 43
VI. L’ÉVASION. 46
VII. LE CHATEAU DE TOUFFOU. 48
VIII. L’EMBUSCADE. 51
IX. UNE APPARITION. 52
X. LES DEUX AMIS. 54
XI. UN ARRÊT POSTHUME. 57
XII. LES ROUTIERS EN GAIETÉ. 60
XIII. PEN-MARC’H. 64
XIV. LES PIRATES. 65
XV. LA PROCESSION. 67
XVI. L’ÉPÉE ET LA CROIX. 70
XVII.– LA FLOTTE DUCALE. 73
XVIII. – L’INCENDIE. 76
SIXIÈME PARTIE : L’EXPIATION 77
I. LA TEMPÊTE. 77
II. LE CONVOI FUNÈBRE. 80
III. LE FIDÈLE KERGOFF. 82
IV. LA RÉVOLTE. 85
V. LES DERNIÈRES IMPRÉCATIONS. 87
VI. – LE DÉPART POUR LOC-TUDI. 88
VII. LE COUP DE VENT. 91
VIII. – DEUX GAIS REPAS SUR MER. 93
IX. LE RIVAGE NATAL! 96
X. LA FAIM. 99
XI. – LE CRI DU REPENTIR. 102
XII. UN HORRIBLE PROJET. 105
XIII. LES CONSOLATIONS. 108
A LA BRETAGNE 108
NOTES. 108
LISTE DES SOUSCRIPTEURS. 109
QUATRIÈME PARTIE : LE SERMENT.
I. LA SÈVRE NANTAISE.
Oui durant les longs jours de la saison brûlante,
Où le corps allangui traîne une âme indolente ;
Quand le rayon moins vif du soleil qui descend
Laisse enfin votre souffle attiédir votre sang ;
Quand le vent endormi se réveille et se lève ;
Quand l’esprit qui se calme à ses soucis fait trêve :
Oui, c’est plus qu’un plaisir, c’est une volupté
D’être par un bateau mollement emporté
A travers la fraîcheur d’une eau limpide et lisse,
Qui devant votre proue en angle aigu se plisse,
Ou vous suit en chantant, moins rapide que vous.
Comme tout prend alors des tons charmants et doux !
Ici, les longs carex courbés par le sillage ;
Là, le clocher qui pointe au-dessus du feuillage ;
Ici, les saules creux penchant leur front sur l’eau ;
Là-bas, le bourg qui grimpe aux rampes du coteau ;
Et le toit isolé qui blanchit et qui fume ;
Et l’horizon lointain déjà voilé de brume ;
Et, dans le fond du ciel, ce grand soleil en feu
Qui se couche dans l’or, sous un riche dais bleu !
Sur ces enchantements étendez le silence,
Votre cœur enivré prie et vers Dieu s’élance.
Mais si toute rivière offre à l’œil ces tableaux,
Qui, dépeints mille fois, semblent toujours nouveaux,
Comme leur charme augmente et parle mieux à l’âme,
Lorsque ces fraîches eaux que vous ouvre la rame,
Au lieu de serpenter aux bords plats d’un marais,
Longent de hauts coteaux chargés de bois épais !
A chaque tournant brille une grâce nouvelle,
Et la dernière vue est encore la plus belle.
Telle est la Sèvre ; aussi quiconque a vu son cours
L’admire autant que l’Erdre et s’en souvient toujours.
Avec leur frais silence, avec leurs eaux dormantes,
L’Erdre et la Sèvre sont comme deux sœurs charmantes
Entre qui l’œil hésite ; et pourtant je sais bien
Qui, moi, je choisirais… Mais chut ! n’en disons rien.
Le bateau qui portait Jeanne de Belleville
Depuis longtemps déjà glissait sur l’eau tranquille.
Grâce à ses trois rameurs, trois robustes lurons,
Dont un tenait la barre et deux les avirons ?
Il avait, près du bourg, pu franchir, sans encombre,
Les défilés formés par des rochers sans nombre,
Qu’un souffle de tempête arracha du coteau
Et qui sur leurs flancs bruns faisaient écumer l’eau.
Laissant bien loin là-bas la cascade qui gronde,
On nage maintenant dans une eau très-profonde,
Mais dont le lit parfois se resserre à ce point
Que des bords opposés chaque arbre se rejoint.
Si longtemps qu’un bas-fond ou des passes étroites
Offrirent des dangers pour des mains maladroites,
Olivier, attentif à l’écueil évité,
Admira les rameurs et leur dextérité ;
D’un regard curieux suivant chaque manœuvre,
Il voulut bien souvent mettre la main à l’œuvre,
Et les marins , joyeux des efforts de l’enfant,
Qui, si l’esquif passait, souriait triomphant,
Battirent des deux mains, quand sa gaffe rapide
Ecarta, d’un coup sûr, une roche perfide.
Pendant ce temps, Herblain et Jeanne, assis tous deux,
Repaissaient leur douleur de souvenirs hideux,
Regardant sans rien voir, dans un morne silence.
Mais quand loin des bas-fonds la barque enfin s’élance
Et, laissant à la rame entière liberté,
Sur un large courant glisse en sécurité,
Le bouillant Olivier, qui ne sait plus que faire,
En franchissant les bancs, s’approche de sa mère :
« Je suis peu curieux et vous le savez bien,
Car de tous vos secrets vous ne me livrez rien ;
Mais je n’en garde pas une âme plus chagrine :
Ce qu’on veut me cacher, mon esprit le devine.
Vous ne m’avez point dit quelle grave raison
Nous fait, quand on y danse, abandonner Clisson ;
Eh bien , mère, avec vous je parie, et, pour gage,
J’offre ces verts lauriers conquis par mon courage,
Que vers Nantes, tous trois, si nous voguons ce soir,
C’est qu’enfin s’accomplit votre plus doux espoir. »
Jeanne à ce mot d’espoir frémit ; son cœur qui souffre
Revoit, sous cet éclair, les profondeurs du gouffre
Où tout ce qu’elle aimait, hélas ! s’est abîmé
Attirant dans ses bras cet enfant bien-aimé
Qui creuse à son insu sa cruelle blessure :
-« Ce soir tu sauras tout, cher fils, je te le jure ;
Mais, si tu ne veux pas me déchirer le cœur,
Oh ! ne me parle plus d’espoir ni de bonheur. »
-« Je ne sais pas pourquoi vous m’en faites mystère :
Si vous quittez Clisson, où l’on fête mon père,
C’est qu’il est de retour, pour moi c’est évident,
Et qu’avec notre duc à Nante il nous attend…
Il pourra m’embrasser sans trop courber sa taille,
Car j’ai grandi beaucoup… A défaut de bataille,
Il me racontera ses hauts faits au tournoi…
Crois-tu qu’il ait les prix que lui donna le Roi ?…
Ma mère, qu’avez-vous ? votre joue est bien pâle ! »
« Eh ! ne voyez-vous pas que votre mère râle ? »
S’écrie Herblain, debout et presque impérieux.
« Oh ! ce n’est rien, dit Jeanne, et je suis déjà mieux, »
Poignante est la douleur : si Jeanne la surmonte,
Ce n’est qu’à grands efforts que son âme se dompte ;
Cherchant donc un prétexte au hasard pour souffrir :
« O le cruel enfant, qui me fera mourir ! »
Dit-elle, en retenant Olivier, qui se penche
Pour cueillir au passage une large fleur blanche ;
Et, pouvant soulager enfin son cœur trop plein,
Jeanne pleure à son aise, en regardant Herblain.
Son fils lui saute au cou, l’embrasse et la rassure :
« Le péril n’était pas bien grand , je te le jure ;
Mais je sais qu’une femme est prompte à s’effrayer.
Allons, ne pleure plus : je m’en vais essayer
D’être, puisque d’un rien tu te fais un fantôme,
Tranquille comme un ange… ou mon frère Guillaume,
Qui, depuis le départ, dort là d’un si bon cœur. »
Et, donnant, en passant, un baiser au dormeur,
Olivier va s’asseoir, soufflant une fanfare,
A côté du marin dont la main tient la barre :
« Beau marinier, dit-il, puisqu’il faut rester coi,
Si tu sais quelque histoire, eh bien, conte-la moi. »
II. LE REPAS CHAMPÊTRE.
Après avoir suivi dans ses courbes charmantes
La Sèvre aux cent détours, la Sèvre aux eaux traînantes,
Et vu ses horizons, brodés de pampres verts,
Se clore ou s’élargir sous mille aspects divers,
On avait de La Haye, illustre par sa fouace
Dépassé les longs prés, et déjà dans l’espace
Se montrait, au-dessus d’un étroit défilé,
Du couvent de Vertou le clocher effilé.
Il est tard : le soleil, qui de plus en plus baisse,
Jette un rayon oblique à la ramée épaisse ;
L’eau va si lentement qu’on dirait qu’elle dort,
Mais on y voit trembler de larges plaques d’or,
Car le ciel sans nuage y réfléchit sa teinte.
Le silence se fait : une cloche qui tinte,
Quelques oiseaux épars chantant aux environs,
Le bruit toujours égal des deux courts avirons,
Ou parfois d’Olivier la voix fraîche et sonore,
C’est tout… En d’autres temps, que dis-je ? hier encore,
De ce calme profond savourant la douceur,
Jeanne eût tressailli d’aise à ce site enchanteur.
» Son âme poétique et jusqu’alors si pure,
Dans ses charmes secrets comprenant la nature,
Aimait à refléter les chefs-d’œuvre de Dieu,
Comme l’eau tranquille aime à sourire au ciel bleu ;
Mais cherchez donc le ciel au fond d’une eau troublée !
Pour admirer encor, Jeanne est trop désolée ;
La prière elle-même est muette en son cœur
Et sa pensée entière est toute à son malheur.
Guillaume, qui s’éveille aux fraîcheurs de la brise,
Témoigne par des cris sa naïve surprise
De voir, sous les eaux, fuir les peupliers du bord.
Dont le tronc renversé se balance et se tord.
Quant au vif Olivier, voudra-t-on bien me croire ?
Il reste assis, tranquille, en écoutant l’histoire
De ces païens d’Herbauge, outrageant le bon Dieu
Et submergés un jour dans le lac de Grand-Lieu.
Mais se levant soudain : — « Merci de ta légende.
De tous ces vieux récits mon oreille est friande,
Mais je dois obéir à la faim que j’entends. »
Et, faisant à grand bruit claquer ses blanches dents,
Il saute vers sa mère : — « Avez-vous quelques vivres ?
Peut-être qu’au château mes vingt amis sont ivres ;
Moi, je me crois à jeun, malgré mon déjeuner,
Tant dans mon estomac je sens le creux sonner!…
Mon père nous attend, et ce serait dommage
De lui mener ses fils morts de faim en voyage :
Une mort glorieuse , on l’accepte parfois ;
Mais une mort ignoble ! oh ! c’est mourir dix fois. »
Sentant toute l’horreur de cette verve folle,
Herblain aurait voulu refouler sa parole ;
Car la mère et l’épouse avait encor pâli,
A ces allusions au forfait accompli.
Jeanne lui dit tout bas : « Vous prenez trop de peine :
Ma douleur ne peut croître, Herblain, la coupe est pleine.
Je dois m’accoutumer à ces coups imprévus :
Bientôt mon cœur meurtri ne les sentira plus.
Autant que moi, d’ailleurs, Olivier est à plaindre :
Trop tôt… dès cette nuit, sa gaîté va s’éteindre. »
Puis elle dit tout haut, en caressant ses fils,
Car, près d’elle, Guillaume à ses jeux s’était mis :
« Olivier a raison : l’arbre vit par l’écorce.
Nous avons tous besoin ce soir de notre force :
Je vais donner l’exemple… et ceux qui m’aimeront
Ici, comme partout et toujours, me suivront. »
Sur les bancs, aussitôt on ouvrit les corbeilles :
Un jambon, les fruits mûrs du verger et des treilles,
Du pain blanc et du vin, tel était le menu
Offert à l’appétit à venir ou venu ;
Et, l’esquif amarré près de la rive agreste,
Jeanne fit les honneurs de ce festin modeste.
Jeanne et le vieil Herblain, prévoyants du danger,
Subissaient par raison le besoin de manger ;
Mais au fond de leur cœur grondaient de tels orages
Que des ombres passaient souvent sur leurs visages.
Les enfants, au contraire, et les trois mariniers
Aux plaisirs du repas se donnaient tout entiers :
La joie étincelait dans toutes leurs paroles,
C’était un feu croisé des gaîtés les plus folles ;
Et leurs propos bruyants, leurs rires et leurs cris
Réveillaient dans les bois les oiseaux endormis ;
Et Jeanne refoulait sa douleur grandissante,
De peur d’effaroucher cette joie innocente.
Certe, aucun des témoins de ce charmant tableau,
Les marchands remontant la Sèvre en leur bateau,
Les enfants, les rameurs, le pauvre Herblain lui-même,
Malgré les noirs desseins roulant sous son front blême,
Nul n’aurait soupçonné l’effroyable projet
Auquel la châtelaine, en souriant, songeait.
Chacun eût admiré, mélangés avec grâce,
La douceur de la femme et l’orgueil de la race,
Car Jeanne garde encor dans ce chétif bateau
La même majesté qu’en son noble château ;
Mais s’ils avaient appris ce qui l’amène à Nante,
Tous auraient, même Herblain, reculé d’épouvante ;
Car la Furie antique aux cheveux de serpents,
Le Diable aux yeux de flamme et qui grince des dents,
Les Fables et l’Histoire en leur tragique empire,
Et ces sombres rêveurs, Dante, Eschyle, Shakspeare,
Nul œil n’a jamais vu, nul esprit inventé
Ce que Jeanne médite en ce beau soir d’été.
III. LES RENCONTRES DE NUIT.
La collation faite et tout remis en place,
Le canot démarré s’élance et fend l’espace ;
Car les marins, ayant réparé leur vigueur,
Faisaient crier la rame et nageaient de tout cœur.
Ils vont : et le soleil, derrière un massif d’aulnes,
Se couche ; l’horizon assombrit ses tons jaunes,
Et, sous ce jour douteux, qui tourne à la pâleur,
Tout se mêle et se fond, la ligne et la couleur.
Ils vont : la nuit qui vient laisse traîner ses voiles ;
On commence à compter dans l’air brun les étoiles ;
Une humide fraîcheur monte en léger brouillard ;
On n’entend plus chanter que le flot babillard ;
Le vent est faible, et tiède, et doux comme l’haleine
Du bel enfant qui dort près de la châtelaine…
Toujours silencieuse et dont l’œil fixe luit.
— « Vrai Dieu ! dit Olivier, c’est une belle nuit ;
Nos bourgeois, à Clisson, ont beau temps pour leur fête
Ce n’est pas étonnant : pour mon père elle est faite…
Je ne sais ce qu’au Ciel a fait notre maison,
Mais le Ciel a toujours protégé les Clisson ;
Demandez-le plutôt à mes deux gouvernantes. »
— « Vous en aurez la preuve en arrivant à Nantes,
Dit Jeanne amèrement; mais d’ici là, mon fils,
Ne me fatiguez plus de propos étourdis. »
— « Je ne sais pas en moi ce qui peut vous déplaire,
Mais contre moi toujours vous semblez en colère :
Je ne puis dire un mot, je ne puis faire un pas,
Sans que vous me grondiez, soit tout haut, soit tout bas. »
Olivier va s’asseoir, n’ayant pas de réponse ;
Et Jeanne en ses projets de plus en plus s’enfonce…
Oh ! son noble mari, comme ils l’ont outragé !
Mais aussi, dès demain, comme il sera vengé !
La barque va toujours, toujours aussi rapide,
Sous les étoiles d’or montant dans l’air limpide.
Olivier, que l’ennui commençait à gagner,
Voit une masse sombre en cercle s’aligner,
Où flottaient dans la nuit cent clartés nébuleuses,
Dont les reflets tremblaient dans les eaux vaporeuses :
Est-ce un Argus géant entr’ouvrant ses cent yeux ?
Est-ce un astre brisé tombé du haut des cieux,
Et ces points si brillants en sont-ils les parcelles ?…
Tous ces feux, Olivier, sont de pâles chandelles :
C’est le bourg de Vertou, qui, du haut du coteau,
S’échelonne et descend jusques au bord de l’eau.
Son rieux couvent, perché sur la brune colline,
Disperse au loin les sons de la cloche argentine,
Car ces moines, dont Dieu seul occupe le cœur,
Avant de s’endormir vont prier le Seigneur.
Et Jeanne se disait, l’âme désespérée,
En passant au-dessous de l’église éclairée :
« Ceux qui peuvent prier sont bien heureux ; mais moi,
Prier m’est impossible, et Dieu sait trop pourquoi !
Il me commanderait l’oubli de mon offense…
Je veux bien pardonner, mais après la vengeance. »
Quand on n’entendit plus tinter qu’en sons lointains
La cloche du couvent des noirs Bénédictins,
La Sèvre, jusqu’alors presque toujours déserte,
Offrit, quoique plus large et d’arbres moins couverte,
A nos rameurs de nuit des dangers sérieux ;
Car de nombreux bateaux, se croisant avec eux,
Les effleuraient souvent de leurs pesantes rames.
Les uns, sous leurs flancs noirs faisant rouler des lames
Et chargés jusqu’aux bords d’hommes silencieux,
Affectaient je ne sais quel air mystérieux :
L’œil, parfois, y croyait voir briller les écailles
Des haubergeons d’acier et des cottes de mailles.
— « Oui, se disait Herblain, qui, lui, n’hésitait pas,
Malestroit est fidèle et ce sont nos soldats. »
Les autres lourds bateaux, pleins de rumeurs bruyantes,
Ramenaient au logis, de la foire de Nantes,
Les marchands, les bourgeois, les serfs des environs.
Le bruit des voix couvrant le bruit des avirons,
Olivier écoutait, mais sans y tenir guères ;
Presque tous, en passant, ne parlaient que d’affaires.
Mince était le plaisir, surtout pour un enfant,
D’entendre ces bourgeois prendre un air important,
Pour vanter les produits, plus ou moins profitables,
Ceux-ci de leurs greniers, ceux-là de leurs étables.
Quand, montrant un bateau, par son bruit dénoncé :
— « Chut ! le nom de Clisson vient d’être prononcé ;
Écoutons tous, dit-il ; on parle de mon père…
Ma mère, priez donc maître Herblain de se taire. »
Et Jeanne, comme Herblain, tremble sous un frisson
— « Je te dis que c’est bien le seigneur de Clisson :
Je l’ai vu trop de fois pour ne pas le connaître. »
— « Je ne contredis pas et cela peut bien être ;
Pourtant je n’en crois rien. » — « Tu me fais enrager :
J’ai reconnu sa tête. » — « Elle a dû bien changer. »
— « On changerait à moins ; mais son front haut et large.
Et ses sourcils épais, si noirs et que surcharge… »
Le bateau s’éloignait. Pour en entendre plus,
Le pauvre Olivier fit des efforts superflus.
Serrant sa mère alors de ses mains caréssantes :
— « J’avais deviné juste et mon père est à Nantes.
Comme il doit lui tarder de nous voir arriver !
Mais notre lourd bateau ne sait que dériver…
Allons, ramez plus fort et hâtez notre course :
J’ai pour chacun de vous un sou d’or dans ma bourse. »
— « Parmi tant de bateaux courir est défendu ;
Mais nous regagnerons bientôt le temps perdu :
Passé le pont Rousseau , dont là-bas on voit l’ombre,
Nous pourrons naviguer très-vite et sans encombre.
La lune va, d’ailleurs, avant peu se lever,
Et dans une heure au plus nous devons arriver. »
IV. L’ARRIVÉE A NANTES.
Déjà, vers l’Orient, sur une bande brune,
L’horizon blanchissait lentement, quand la lune,
Baignant de ses lueurs la crête des coteaux,
Puis jetant tout à coup ses reflets sur les eaux,
Apparut, échancrée à demi, mais brillante ;
Et la barque volait sous la rame moins lente.
L’arche du pont Rousseau cache un moment les deux,
Puis la Sèvre reprend son cours silencieux.
Après avoir longé quelques saules énormes,
Si larges et si hauts qu’on eùt dit de vieux ormes,
Les eaux ont fait un coude et leur lit s’agrandit.
Olivier, tout joyeux, frappe des mains et dit :
« Au courant plus rapide on reconnaît la Loire ;
Voici Nantes là-bas et sa muraille noire.
Tenez, gais mariniers, prenez ce beau sou d’or,
Mais ramez, ramez donc, ramez plus vite encor ;
Je suis impatient des baisers de mon père. »
— « Dix minutes de nage, et nous serons, j’espère,
Au coteau Miséri , qui, devant Trentemoult,
Avec son haut rocher semble un géant debout.
C’est Nantes, mais pourtant pas d’espérance fausse !
Car votre mère veut, longeant toute la Fosse,
Monter au Port-au-Vin, près de Saint-Nicolas ;
Le courant sera vif, mais l’on a de bons bras. »
Pendant que le pilote expliquait le voyage,
Les deux marins ramaient toujours avec courage,
Et, la pente du fleuve aidant à leur effort,
Nantes les vit enfin pénétrer dans son port.
Le silence y régnait, et de rares lumières
Des pêcheurs de la Fosse éclairaient les chaumières .
Le timonnier ayant tourné le gouvernail,
On remonta la Loire, et dur fut le travail ;
Mais que ne dompte pas la force unie au zèle ?
Bientôt de Saint-Julien apparaît la chapelle,
Et dans le fleuve, en face, un écusson de bois,
Où le seigneur évêque, en vertu de ses droits,
A tout nouvel époux fait courir la Quintaine,
Ou de soixante sols lui fait subir la peine .
—- « Le voyage est fini, dit un des mariniers;
Voici le Port-au-Vin, Madame, et ses chantiers .
Faut-il à ce perré faire accoster la barque ? »
« Mère, dit Olivier, une seule remarque :
Il vaudrait mieux pousser tout droit jusqu’au Château ;
Car, si nous arrêtons ici notre bateau,
Il est bien évident que, pour joindre mon père,
Il faudra traverser la ville tout entière :
Or, la porte est fermée, et, pour la faire ouvrir
Que de retards encor nous aurons à souffrir,
Quand au palais ducal vous êtes attendue!… »
Jeanne ne répond pas, mais sa main étendue
Ordonne aux trois marins d’aborder sans délai.
« C’est bien, dit Olivier, faisons ce qui vous plaît ;
Mais c’est dans le Château que nous attend mon père,
Car monseigneur de Blois le traite comme un frère.
Quelles fêtes demain le duc va nous donner ! »
Et voyant tout à coup sa mère frissonner :
—- « Eh bien, descendez donc, puisque le froid vous gagne ;
Les portes s’ouvriront quand nous dirons : Bretagne ! »
Lorsqu’on eut débarqué Jeanne avec ses deux fils,
Que le vieil écuyer en silence a suivis,
Elle dit aux marins : « Gardez ici la barque
Et déguisez mon nom, si quelqu’un vous remarque.
Dans une heure au plus tard nous serons de retour ;
Mais restez, dussiez-vous m’attendre jusqu’au jour. »
Puis, s’éloignant du quai, de peur d’être entendue,
Et fouillant d’un regard inquiet l’étendue,
La veuve de Clisson, montrant du doigt le ciel,
Dit, en baissant la voix, mais d’un ton solennel :
« Enfants, préparez-vous à des choses funèbres ;
Sous les pâles clartés de l’astre des ténèbres,
Nous allons visiter la porte Sauvetour .
Herblain, conduisez-nous tout droit à cette tour. »
—- « La porte Sauvetour ! Y songez-vous, Madame !
Et devant ces enfants !… Ah ! vous me glacez l’âme. »
—- « Est-ce pour mon plaisir que je viens, par hasard ?
Quel but donnais-tu donc, Herblain, à mon départ ? »
—- « Consulter vos amis et réclamer leur aide. »
—- « Oui, ce projet m’amène, oui, ce souci m’obsède ;
Mais mon premier désir est un dernier adieu ! »
—- « De ce qu’il adviendra vous répondez à Dieu. »
« J’ai juré dans mon cœur la funèbre visite.
Laisse-nous, si déjà ton dévoûment hésite,
Ou si ton sang glacé ne connaît que l’effroi. »
—- « C’est m’offenser, Madame ! Eh bien donc, suivez-moi. »
Et, malgré la terreur qui lui serre la gorge,
Prenant la rue alors déjà dite de Gorge ,
Puis de Saint-Nicolas côtoyant le fossé,
Herblain devant eux marche, et va d’un pas pressé.
V. LES DOUVES SAINT-NICOLAS.
En longeant dans la nuit les eaux de cette douve,
Où des hauts murs s’étend l’ombre, Guillaume éprouve,
Pauvre enfant de trois ans toujours prêt à l’effroi,
Un tremblement de peur, qu’il appelle du froid.
Jeanne en ses bras l’enlève, et sur son sein le serre :
—- « Malgré ce que je fais, va ! je suis bonne mère ;
Reste-là, dans mes bras, et t’échauffe à mon sein. »
Puis, de son fils aîné prenant alors la main :
—- « Cher enfant, as-tu peur ? Oh ! dis-le moi sans honte. »
—- « Le cœur aime à savoir les périls qu’il affronte :
Peut-être l’imprévu pourra-t-il me troubler,
Mais ce dont je suis sûr, c’est de ne pas trembler ;
Quel que soit ton secret, tu peux donc me le dire. »
—- « Oh ! merci, noble enfant, que j’aime et que j’admire ;
Tu seras donc toujours ma consolation !
J’ai bien fait de compter sur ton cœur de lion…
Puisque tu peux, dis-tu, t’émouvoir, mais non craindre,
Avec toi je vais donc enfin cesser de feindre :
Sous tant de désespoir, sous tant de déshonneur,
Ah ! comme je souffrais de mentir le bonheur !
» Mon fils ! mon bien-aimé ! le malheur nous accable :
Tout ce qu’on peut rêver de plus épouvantable…
Ce Dieu, qui protégeait si bien notre maison,
Sa foudre a tout brisé, puissance, amour, blason. »
—- « Si mon père est vivant, qu’importe un coup de foudre ?
Son bras relèvera notre maison en poudre ;
Il est de ceux que Dieu fait toujours triomphants :…
Son épouse l’a dit cent fois à ses enfants. »
—- « Si ton père vivait, je te dirais : Espère !
Mais je n’ai plus d’époux et tu n’as plus de père. »
L’enfant pousse un grand cri, tombe à terre, et ses pleurs
Jaillissent à torrent du fond de ses douleurs.
Déposant sur le sol son fils Guillaume, Jeanne,
Folle de désespoir et qui meurtrit son crâne,
Sur Olivier se jette et le prend dans ses bras :
—- « Dis-moi donc, ô mon fils, que tu ne mourras pas.
Comment n’ai-je pas mieux ménagé sa jeune âme ?
Un enfant ne sait pas souffrir comme une femme. »
Olivier, dont l’angoisse en sanglots débordait,
Dans les bras de sa mère Olivier se tordait.
Voyant en vains efforts s’épuiser sa tendresse,
Pour calmer de son fils la douloureuse ivresse,
Jeanne le laisse à terre et, sur lui se penchant,
Elle attend que son cœur s’apaise en s’épanchant.
—- « 0 mon père! ô mon père! Est-ce chose possible ?
Quoi! mort! perdu pour nous! et je vis…
C’est horrible : Ne plus jamais le voir! ne jamais l’embrasser!
Ne plus sentir ses mains sur mes cheveux passer !
Et tous ses beaux exploits que j’espérais entendre !
Oh ! comme je voudrais être encore à l’attendre !
Quand il me regardait, ses yeux étaient si doux!
Il ne me fera plus monter sur ses genoux.
Mon père ! mon bon père !… Oh! non, c’est un mensonge
Il n’a pas pu mourir sans nos adieux… J’y songe :
Ma mère a voulu voir si vraiment je l’aimais…
Non, non ! c’est bien fini!. Jamais ! jamais! ! jamais ! ! ! »
Mon vers vous peindrait mal les tortures de Jeanne :
Chaque cri de son fils l’accuse et la condamne ;
Car Jeanne lui prépare un plus affreux tourment,
Si devant Sauvetour elle tient son serment ;
Et, sans miséricorde, Herblain, debout près d’elle,
Lui dit tout bas : « Madame, en serviteur fidèle,
Je vous avais prédit ce qui vient d’arriver :
Il est de ces terreurs qu’on ne doit pas braver.
Si la mort de son père à cet excès l’écrase,
Une douleur de plus et vous brisez le vase :
Vous le verrez mourir là-bas, désespéré. »
—- « J’en ai fait le serment, Dieu le veut et j’irai…
Ah ! ne m’accuse pas de manquer de tendresse :
Ces deux pauvres enfants dont tu plains la détresse,
Je donnerais ma vie, Herblain, et de grand coeur,
Si ma mort les pouvait arracher au malheur ;
Mais je ne suis pas libre et c’est Dieu qui commande ;
De notre âme broyée il exige l’offrande.
L’Ange exterminateur vole devant mes pas
Et, malgré mes efforts, il m’entraîne là-bas…
Ne va pas dire, Herblain, que ta maîtresse est folle :
Il est là, je le vois et j’entends sa parole…
Je sais que tu ne peux l’entendre ni le voir :
Il n’apparaît jamais qu’au complet désespoir. »
Herblain était breton et plein de foi chrétienne,
Mais il doute que Jeanne ait sa raison bien saine…
Eh! qu’importe, après tout ? car par son dévoûmcnt
A Jeanne il est lié mieux que par son serment ;
Et, reprenant sa marche, il dit, courbant la tête :
—- « Que votre volonté, Madame, soit donc faite. »
Pendant cet entretien, en réalité court,
Car mon vers lourd se traîne, hélas! quand le temps court,
Le front dans les deux mains, Olivier continue
D’exhaler ses regrets; et son âme ingénue,
Nourrissant sa douleur de chaque souvenir,
Pleure tout le passé, sans prévoir l’avenir.
Poussant un long sanglot, Jeanne de lui s’approche
Et prenant, à dessein, presque un ton de reproche :
—- « Fils aîné de Clisson, tu ne demandes pas
De quelles mains ton père a reçu le trépas ?
Là-bas, où nous allons, eh bien! tu vas l’apprendre…
Mais te sens-tu de force, Olivier, à m’entendre ?
Si, pauvre et faible enfant, l’héritier des Clisson
N’a que des pleurs aux yeux, dans le cœur qu’un frisson ;
Si le malheur qui n’a, moi femme, pu m’abattre,
Olivier n’ose pas corps à corps le combattre,
Ah ! malgré mon serment, retournons au bateau,
Et cachons notre honte en notre vieux château. »
Ce que tu dois entendre est une chose horrible,
Et ce que tu dois voir est encor plus terrible :
As-tu peur, Olivier ? Dis, ne me cache rien. »
—- « Mère, je n’ai pas peur, non, mais je souffre bien…
Partons, je te suivrai, n’importe où tu me mènes.
Quand tu m’y montrerais des choses surhumaines,
Tu verras que ton fils, incapable d’effroi,
Est digne de son père et digne aussi de toi. »
« Viens donc, mais pleure, enfant ; que ton cœur se soulage
Aux cœurs bien nés les pleurs retrempent le courage. »
Et, tout entière alors à son affreux dessein,
Elle se baisse et prend de nouveau sur son sein
Guillaume, qui pleurait de voir pleurer les autres.
—- « Oui, pleurez, vous aussi, car nos maux sont les vôtres. »
Et son fils sur le bras, l’autre tenant sa main,
Jeanne d’un pas hâtif rejoint le vieil Herblain.
VI. LA PORTE SAUVETOUR.
Herblain sent la sueur couler froide à sa tempe,
Car ils ont de la Motte enfin gravi la rampe.
Les voilà parvenus sous les épais ormeaux,
Où la lune, des murs dépassant les créneaux,
Faisait glisser sa blanche et paisible lumière.
Un silence profond régnait sur la Hautière .
—- « Préparez-vous, Madame, un cœur bien endurci,
Car nous touchons au but qui vous attire ici. »
—- « Je tiendrai mon serment ; mais avant que je l’ose,
Avant de me montrer l’horrible et douce chose
Que je n’ose nommer devant ces deux enfants,
Que je vois de sanglots et de pleurs étouffants,
Herblain, répète-leur, à ces enfants que j’aime,
Tout ce que ce matin tu m’as dit à moi-même.
Ton récit va broyer leur coeur, et je le sais ;
Je maudis comme toi mes serments insensés ;
Mais plains-moi : je ne suis ici qu’une victime.
Il me faut obéir. Lutter serait un crime :
Je vois toujours planer l’Ange au glaive de feu,
Et sa voix à mon cœur redit l’arrêt de Dieu.
» Lorsque je paraîtrai devant le trône auguste
Du juge souverain, clément, mais surtout juste,
Du juge qui comprend les expiations,
Mais pèse les forfaits et leurs punitions ;
Quand je lui montrerai mes mains de sang couvertes,
Si, des atrocités que Clisson a souffertes,
Je n’avais pour témoins que de simples ondit,
De Dieu mon bras vengeur pourrait être maudit.
Voilà pourquoi, Clisson, tes enfants et ta veuve
Viennent chercher ici l’irrécusable preuve.
Nos pleurs ne pourraient pas seuls peut-être effacer
Le souvenir du sang que nous allons verser.
Tu nous verrais d’en haut, tout justes que nous sommes,
Damnés par le Seigneur, exécrés par les hommes ;
Mais chacun répondra pour nous, d’un cœur ému :
Si le bras fut cruel, c’est que l’œil avait vu…
Quand nous aurons juré devant l’horrible lance,
On nous pardonnera notre horrible vengeance…
» Commence ton récit… Enfants, levez vos fronts :
Écoutez ce qu’un père a pu subir d’affronts.
Fasse Dieu qu’aux détails de l’odieux supplice,
Ce ne soit pas de pleurs que votre cœur s’emplisse! »
Olivier de son poing s’est essuyé les yeux :
—- « Herblain, raconte-nous le supplice odieux. »
Et levant vers sa mère un regard où l’audace
Fait succéder aux pleurs l’éclair de la menace :
—- « Je suis prêt ; qu’Herblain parle, et je te ferai voir,
Ma mère, que ton fils sait remplir son devoir. »
—- « Devant tant de courage, oh ! je serais bien lâche
De te laisser, Herblain, la douloureuse tâche.
Je porterai ma croix, dit Jeanne, jusqu’au bout.
Venez, enfants, c’est moi qui dois vous dire tout. »
Et, cédant à l’élan de fureur qui l’emporte,
Jeanne entraîne ses fils vers la fatale porte.
Sur le ciel blanchissant, leur regard vient de voir
Les tours de Sauvetour se détacher en noir.
Dans la bande d’azur entre les tours laissée,
Au-dessus de l’arceau, dont la herse est baissée,
On voit se découper une lance au bois long,
Qui soutient dans les airs quelque chose de rond…
Oh ! ne demandez pas ce que cela peut être ;
Cette chose est facile, hélas! à reconnaître,
Car la lune qui monte, épandant sa clarté,
D’un oblique rayon la frappe de côté :
C’est une tête d’homme, une tête livide
Qui brille ainsi là-haut sur ce pan de ciel vide,
Cheveux et barbe gris, yeux clos et traits crispés.
De Jeanne les regards ne s’y sont pas trompés :
De l’époux dont l’amour faisait vivre son âme,
C’est tout ce que jamais reverra cette femme !
Un tremblement d’horreur a secoué son corps ;
Elle va s’affaisser, malgré tous ses efforts,
Quand soudain dans le ciel l’Ange vengeur s’élève,
Brandissant sur l’arceau les flammes de son glaive.
Jeanne alors, transportée et de rage et d’amour,
A bondi jusqu’au bout du pont de Sauvetour,
Et, par le pont-levis seulement séparée
De cette tête pâle et pour elle sacrée,
Elle envoie un baiser ardent à son époux
Et dit à ses deux fils : « Mes enfants, à genoux ! »
—- « J’ai peur, lui dit Herblain, que le soldat de garde
Ou le bourreau, qui loge ici, ne nous regarde.
Dans l’angle où ce matin je me suis abrité,
Venez, vous verrez tout avec sécurité.
Pour éclore et grandir, songez-y bien, Madame,
Il faut l’ombre aux projets qui couvent dans votre âme. »
—- « Venez, enfants ; d’Herblain écoutons le conseil,
Et qu’à nos ennemis rien ne donne l’éveil. »
Tous trois sont à genoux dans l’angle de la place ;
Jeanne entre ses deux fils, que chaque bras enlace.
—- « Enfants, qui désormais avez seuls mon amour,
Hélas ! chaque matin, quand se levait le jour,
Chaque soir, quand mes mains préparaient votre couche,
Après le doux baiser cueilli sur votre bouche,
Je vous disais : Enfants, mettons-nous à genoux
Et prions pour celui qui là-bas pense à nous.
» Aujourd’hui que mon cœur se brise et désespère,
Je vous dis, en pleurant : Priez pour votre père,
Priez comme autrefois; mais, hélas! aujourd’hui
N’adressez pas au Ciel les mêmes vœux pour lui.
Ne dites pas à Dieu,… s’il daigne vous entendre :
Conservez notre père et veuillez nous le rendre.
Dieu, tout puissant qu’il est, ne vous le rendrait pas :
Il reprend rarement une proie au trépas ;
Ce n’est qu’au dernier jour que les têtes tranchées
Pourront aux troncs saignants être enfin rattachées.
Demandez donc à Dieu seulement, ô mes fils,
D’ouvrir à votre père, hélas! son paradis…
» Le paradis ! Seigneur, Seigneur, quoi qu’il advienne,
Mon vœu le plus ardent est de rester chrétienne ;
Mais si ma voix toujours, en s’élevant vers vous,
Demandait une place au ciel pour mon époux,
Ah ! vous avez trop tôt exaucé ma prière,
Et pour lui je rêvais une longue carrière…
» Encor, si j’avais pu dans mes bras le presser,
Lui porter nos enfants,,les voir le caresser !
Si je pouvais ; du moins, au tombeau de ses pères,
Arroser de mes pleurs ses reliques si chères !
Mais non ! tous mes espoirs, vous me les avez pris.
Ah ! qu’au moins votre ciel, Seigneur, en soit le prix.
Son baptême de sang double mes espérances :
Il a droit au bonheur après tant de souffrances.
» Oui, si nous l’ attendions, enfants, il nous attend ;
Nous lui tendions les bras, c’est lui qui nous les tend…
Clisson, nous te suivrons. Oh puisse bientôt poindre
Le jour qui doit là-haut tous enfin nous rejoindre !
Nous irons te porter… au céleste séjour
Les baisers. amassés ici pour ton retour. »
Et les enfants, contre eux serrant leur pauvre mère,
Disaient en sanglotant : « Bénissez-nous, ô père ! »
VII. – LA MALÉDICTION.
Jeanne, à genoux, parlait d’une si douce voix,
Qu’on eût cru que ses pleurs baigneraient seuls sa croix ;
Mais se levant soudain, convulsive, enfiévrée,
L’œil ardent de colère et la joue empourprée :
—- « Ah ! lâche que je suis, je me laisse attendrir !
J’ai ma besogne à faire avant que de mourir…
Mes fils, relevez-vous. Voyez sur cette porte
Cette tête si pâle et qu’une lance porte.
La reconnaissez-vous, enfants ?… Non, n’est-ce pas ?
Vous ignorez combien nous change le trépas. »
—- « C’est donc, crie Olivier, la tête de mon père !
Et qui me la fait voir, c’est le doigt de ma mère !
Oh ! si d’un poids trop lourd tu veux me soulager,
Mère, dis-moi qu’ici nous venons le venger. »
—- « Oui, tu m’as bien comprise, Olivier : oui, sans doute,
Clisson sera vengé ; mais que son fils m’écoute,
Afin de bien savoir à qui doivent nos coups
Faire payer le sang d’un père et d’un époux. »
Alors Jeanne à ses fils retrace en traits de flamme
Les horribles tableaux qui lui déchirent l’âme :
Sa voix leur peint Clisson, au milieu du tournoi,
Arrêté sous les yeux et par l’ordre du Roi ;
Flétri du nom de traître et, sans preuve plus ample,
Traîné, chargé de fers, dans les cachots du Temple ;
Appliqué, lui baron, à l’affreux chevalet ;
Jugé sur l’échafaud devant le Châtelet ;
Condamné, dégradé, dépouillé de ses armes ;
Souillé de tant d’affronts qu’il en verse des larmes ;
Déchu de sa noblesse et privé de ses biens ;
Tombé dans la roture, ainsi que tous les siens ;
Sentant crouler sous lui sa maison tout entière ;
Puis, sous un long drap noir et sur une civière,
Emporté dans l’église et là, jouet du sort,
Écoutant, lui vivant, prier Dieu pour lui mort ;
Puis, car l’on veut flétrir son corps comme son âme,
Traîné dans tout Paris sur une claie infâme,
Jusqu’au marché fatal qu’on nomme les Champeaux,
Et là, livrant sa tête au fer des trois bourreaux ;
Puis, pour mettre le comble à tant d’ignominie,
Car tout cadavre a droit à la terre bénie,
Servant, sur deux gibets ! de pâture au vautour,
Le corps à Montfaucon, la tête à Sauvetour.
Pendant ce long récit, à son insu barbare,
Jeanne d’aucun détail ne s’est montrée avare ;
Seulement elle dit parfois : « Vais-je trop loin ? »
Herblain répond toujours : « Non, car j’en fus témoin. »
Guillaume sanglotait, en regardant la lance ;
Olivier frissonnant écoutait en silence ;
Mais quand Jeanne se tut, il dit : « Est-ce enfin tout ?
Mère, mets là ta main et sens mon cœur qui bout.
Oh ! je crains que d’horreur en mon sein il n’éclate,
Car mon père peut croire, hélas! notre âme ingrate :
Voilà déjà huit jours qu’ils ont pu l’outrager,
Et nous n’avons encor rien fait pour le venger ! »
—- « Si Dieu ne trompe point demain mon espérance,
Demain se lèvera le jour de la vengeance.
Pardonne mon retard, pauvre époux adoré ;
Tu le sais, mon seul crime est d’avoir ignoré.
Mais le retard n’a fait qu’accumuler ma haine ;
Tremblez, lâches, tremblez, car la mesure est pleine :
Le châtiment sur vous est enfin suspendu,
Et vous ne perdrez rien pour l’avoir attendu.
» Clisson vous a maudits sur l’échafaud infâme :
Eh bien ! je vous maudis à mon tour, moi sa femme.
» Délateurs de Clisson, Philippe de Valois,
Vous juges, vous bourreaux, et toi Charles de Blois,
Tout ce qui sur la terre a pris part au supplice,
Comme auteur, comme acteur, instrument ou complice,
Ceux qui s’assocîront à ce que l’on a fait,
Ceux qui m’empêcheront de venger le forfait :
Soyez maudits, au nom de toute la nature,
Maudits par Dieu, maudits par chaque créature ;
Maudits dans tous les lieux où vous vous trouverez,
A la ville, à l’armée, aux champs où vous fuirez ;
Maudits dans vos maisons et maudits à l’église ;
Maudits par l’ouragan et maudits par la brise,
Par les astres des nuits comme par le soleil ;
Maudits pendant le jour, maudits dans le sommeil ;
Maudits dans vos plaisirs, maudits sur votre couche,
Maudits dans les baisers cueillis par votre bouche,
Maudits dans vos enfants, maudits dans vos amours ;
Maudits dans tous vos biens, maudits, maudits toujours ;
De la plante des pieds au sommet de vos têtes ;
Dans tout ce qu’ici-bas vous rêvez ou vous faites ;
Maudits dans votre soif, maudits dans votre faim,
Maudits, maudits partout. Que vous dirai-je enfin?
Maudits dans votre corps et maudits dans votre âme !
Que rien n’y reste sain, que tout y soit infâme ;
Que votre nom à tous soit un objet d’horreur ;
Que pour vous prier Dieu devienne une terreur ;
Et, quand sur votre front luira l’heure dernière,
Qu’aucun prêtre pour vous ne dise de prière ;
Que vos corps, repoussés loin, bien loin des chrétiens,
Aillent pourrir à l’air où pourrissent les chiens ;
Puis, quand vous monterez vers le juge suprême,
Que, dans sa majesté, Jésus, Jésus lui-même !
Se lève contre vous et vous plonge à l’instant
Dans les feux éternels, où Judas vous attend ! »
Lorsque Jeanne se tut, haletante et brisée,
Sa coupe de fureur n’était pas épuisée ;
Elle avait encor soif de malédictions :
Le volcan préparait d’autres explosions.
Jeanne était à la fois effrayante et sublime :
On eût dit Némésis foulant aux pieds le crime.
Sa joue était en feu , ses yeux étincelaient
Et sur son front crispé ses veines se gonflaient.
Elle allait et venait à grands pas sur la place,
Et son silence même exhalait la menace.
Ainsi, lorsque mugit la tempête aux cent voix,
Secouant nos maisons, des fondements aux toits,
En vain ses hurlements cessent par intervalles :
L’oreille épouvantée attend d’autres rafales.
Guillaume, que glaçaient ces accents surhumains,
Pleurait, en se voilant de ses petites mains ;
Olivier restait droit, mais sa face était blême,
En répondant Amen au terrible anathème.
Plus prévoyant, Herblain tremblait d’un double effroi.
Jeanne avait un écho dans son cœur plein de foi :
Il croyait, à ses cris, voir s’entr’ouvrir l’abîme
Qui devait dévorer tous les auteurs du crime ;
Son bras avec bonheur les eût précipités
Dans ces feux éternels, hélas ! trop mérités ;
Mais ses projets vengeurs, sa douleur les oublie,
En voyant sa maîtresse au bord de la folie.
O Jésus, ô Marie, ô saints martyrs, vous tous,
Holocaustes sacrés du céleste courroux,
Protégez la raison de cette pauvre femme :
Ses fils n’ont plus, hélas ! d’autre abri que son âme.
Chaque instant accroissait son exaltation ;
On entendait siffler sa respiration,
Et sur ses nobles traits, contractés par le spasme,
Passait tantôt l’éclair d’un sombre enthousiasme,
Tantôt l’affreux rictus d’un sourire cruel :
Doublé reflet confus des enfers et du ciel.
VIII. L’APPEL A LA VENGEANCE.
Voulant arracher Jeanne à cette horrible phase
Qui creuse la démence à côté de l’extase,
Herblain prend par la main les deux pauvres enfants
Et s’éloigne avec eux de ces lieux effrayants.
Jeanne, à pas lents, les suit, comme hors d’elle-même…
Herblain a donc sauvé la maîtresse qu’il aime !
Loin du hideux tableau qui semblait la charmer,
La fièvre de son sang va bientôt se calmer…
Il ne veut pas éteindre en elle toute haine ;
La vengeance lui plaît, mais complète et prochaine :
Pour ne pas dissiper au hasard leur courroux,
Il faut que la raison en dirige les coups.
Jeanne des grands ormeaux atteignait la lisière,
Quand, s’arrêtant soudain, l’œil brûlant de colère :
—- « Qui donc ose, dit-elle avec emportement,
Abandonner ces lieux sans mon commandement ? »
—- « Madame, dit Herblain d’un ton plein de tristesse,
Vous avez jusqu’au bout tenu votre promesse,
En confiant ici votre vengeance à Dieu ;
Partons. » —- « Je ne pars pas sans accomplir mon vœu.
Crois-tu que nous soyons venus sur cette place,
Rien que pour voir ces traits dont la pâleur me glace,
Ou lancer devant eux mes malédictions ?…
Si Dieu n’exauçait pas mes imprécations
Et, qui sait ? si j’allais mourir de ma souffrance,
Avant d’avoir cueilli les fruits de ma vengeance !
Certe, à ma part du ciel je devrais dire adieu,
Car sur mon lit de mort ma voix maudirait Dieu…
Et comme ils riraient tous de mes menaces vaines !
Ce qu’il me faut, Herblain, c’est le sang de leurs veines,
Leur ruine complète et leur plein déshonneur.
» Oh ! qu’ils ont été fous de briser mon bonheur !
Ils ne connaissaient pas Jeanne de Belleville !
Mais je vous ferai voir, troupe odieuse et vile,
Qui servez d’instrument aux colères d’un roi,
Que, comme lui, je peux inspirer quelque effroi.
La loi du talion, voilà ma seule règle.
L’outrage est l’épervier, mais la vengeance est l’aigle.
Que gagnez-vous à fuir ? ma serre a le vol prompt
Et suspendra partout la mort sur votre front.
Je vous ai signalés aux colères célestes,
Mais j’aiderai le Ciel à disperser vos restes ;
Oui, je prendrai ma part dans votre châtiment…
On ne m’attaque pas, lâches, impunément.
» Si longtemps que mon sang coulera dans ma veine,
Ma main saura suffire aux conseils de ma haine ;
Et, si la mort un jour, car il faut tout prévoir,
M’empêchait d’accomplir jusqu’au bout mon devoir,
Comme il faut jusqu’au bout que mon œuvre s’achève,
A des bras dévoués je léguerai mon glaive ;
Mais je veux qu’un serment, les liant envers moi,
De vos trépas leur fasse une implacable loi…
Votre crime a volé ses traits à la Justice :
La Justice indignée attend votre supplice. »
Jeanne s’était calmée et parlait lentement ;
Mais ce calme effrayait plus que l’emportement :
La raison à son but allait guider la haine.
—- « Pour bien remplir mes vœux, reprit la châtelaine,
Enfants, c’est à vous seuls que je puis me fier :
Ton cœur comprend le mien, n’est-ce pas, Olivier ?
Votre frère, le fils de Blanche de Bouville ,
A, pour nous aider, l’âme ou trop faible ou trop vile ;
Aussi n’est-ce qu’à vous que Clisson a remis
Le droit de le venger de tous ses ennemis.
Vous ne tromperez pas, enfants, son espérance :
Venez donc avec moi jurer haine à la France. »
—- « Madame, dit alors Herblain, en s’avançant,
Vous savez que pour vous je verserais mon sang ;
Votre courroux est saint, votre vengeance auguste :
Mais le bras qui punit doit toujours rester juste.
La France est étrangère au crime de son roi ;
Le fils du Roi lui-même en a frémi d’effroi :
Le duc de Normandie, oui, je l’ai vu, Madame,
La honte sur le front, le désespoir dans l’âme,
Et comme un suppliant se traînant à genoux,
Je l’ai vu demander grâce pour votre époux. »
—- « Mes fils de leur serment jugeront les limites ,
Mais que m’importe, Herblain, tout ce que vous me dites ?
Devant mon mari mort, la France n’est pour moi
Qu’un corps sans volonté dont la tête est le Roi :
Je frapperai le corps pour atteindre la tête…
Mon bras est prêt : malheur à quiconque m’arrête ! »
Et Jeanne, s’élançant vers la sinistre tour,
Franchit, avec ses fils, le pont de Sauvetour ;
Et là, levant la main vers les pâles reliques
Que la lune éclairait de ses rayons obliques :
—- « Par ces témoins trop sûrs d’un crime détesté ;
Par son front, autrefois si plein de majesté,
Ses yeux, clos à jamais, hélas ! et bientôt vides,
Son long visage blême et ses lèvres livides ;
Par ce qu’outrage ici la pluie ou l’aquilon,
Et par ce qui là-bas pourrit à Montfaucon,
Son cœur loyal, foyer d’ineffables tendresses,
Ses mains, dont votre front sent encor les caresses ;
Par tous les souvenirs qui tressaillent en nous,
Aujourd’hui si cruels et naguère si doux !
Jurez haine éternelle et guerre inexorable
A quiconque prit part à ce meurtre exécrable. »
—- « Nous le jurons ! » —- « Jurez que prières ni pleurs,
Avant d’être vengés, ne fléchiront vos cœurs. »
« Nous le jurons ! » « Jurez que, malgré paix ou trèves,
Si son titre royal le dérobe à vos glaives,
Vous combattrez toujours Philippe de Valois. »
—- « Nous le jurons! » —- « Jurez qu’à ce Charles de Blois
Qui tient notre Bretagne à la France asservie,
Vos bras disputeront sa couronne et sa vie. »
« Nous le jurons ! » « Enfants, ces deux-là, je les hais ;
Pourtant à les frapper ma haine hésite ; mais.
Jurez d’exterminer sans pitié ces vingt juges,
Violateurs du droit, de l’honneur vils transfuges. »
—- « Nous le jurons ! » —- « Jurez d’exécrer tout repos,
Avant que d’avoir vu blanchir à l’air leurs os. »
— « Nous le jurons ! »
—- « C’est bien. L’ombre de votre père
Écoute ces serments… que reçoit votre mère.
Si jamais l’un de vous osait les transgresser,
Puisse son déshonneur contre lui se dresser !
Moi-même, pour lui faire encore un destin pire,
Du fond de mon tombeau je viendrais le maudire »
—- « Oh ! s’écrie Olivier, oh ! c’est nous outrager,
De croire qu’un de nous hésite à le venger.
Toute ma vie, hélas! si longtemps qu’elle dure,
J’aurai devant les yeux cette pâle figure ;
Et pour les assassins l’on craindrait mon pardon !
Mais quel ignoble cœur, mère, me crois-tu donc ? »
—- « Que ta force réponde à ton âme hardie !
Comme en un champ de chaume où passe l’incendie,
Qu’à ses traces de cendre on suive ton courroux :
Sois la flamme, eux la paille, et consume-les tous. »
—- « Madame, j’ai pris part à toutes vos souffrances,
Je veux ma part aussi de toutes vos vengeances,
Dit le vieil écuyer, debout devant la tour ;
Ce qu’ont juré vos fils, je le jure à mon tour.
» Chers restes de mon maître, ô tête vénérée,
Toi qui nous sers d’autel pour la haine jurée,
Toi qui savais jadis que jamais je ne mens,
Tu m’admets, n’est-ce pas? en tiers à ces serments? »
—- « Oh ! dit Jeanne, dont l’œil, de pleurs humide, brille,
Herblain depuis longtemps est de notre famille. »
Et tous les quatre ont dit, en étendant la main :
« Oui, nous te vengerons, Clisson, et dès demain. »
Sous ces explosions d’impitoyable haine,
La nature restait impassible et sereine ;
Les étoiles brillaient doucement dans les cieux
Et jamais plus d’azur n’a réjoui les yeux.
IX. LES CONFIDENCES DANGEREUSES.
Après que ce serment d’énergie effrayante
A dévoué leur vie à leur œuvre sanglante,
Herblain, Jeanne et ses fils ont rejoint le bateau,
Qui, dénoué, se laisse aller au fil de l’eau ;
Et, doublant l’angle aigu de l’Ile Gloriette,
Dont la berge empierrée est déserte et muette,
Sur la Prairie au Duc il les a déposés.
—- « Oh! dit un des rameurs, nos bras sont reposés;
Nous aurions pu, Madame, et sans reprendre haleine,
Monter ce bras de Loire et de la Madeleine
Gagner le pont de bois, que vous voyez d’ici :
Votre chemin serait de moitié raccourci. »
—- « L’île est moins dangereuse et nous irons plus vite.
Vous, chez quelque pêcheur allez chercher un gîte,
Puis remontez demain, par la Sèvre, à Clisson ;
Mais que de mon voyage on n’ait aucun soupçon. »
Pendant que le canot s’élance vers la Fosse,
Sous son double aviron qui s’abaisse et se hausse,
Jeanne et ceux qu’un serment à sa haine a liés
Longent le bord du fleuve et ses hauts peupliers.
Les enfants vont devant; Olivier a l’air sombre,
Mais Guillaume s’amuse à marcher sur son ombre.
Herblain, se voyant seul avec Jeanne, lui dit :
« Le bras voudrait frapper dès que la voix maudit,
Et vous devez trouver vos vengeances bien lentes,
S’il vous faut les venir chercher demain à Nantes.
Eh bien, rassurez-vous : chez Guéneuf, des ce soir,
Des armes s’offriront à votre désespoir. »
—- « Loin de me rassurer, vieil Herblain, tu m alarmes;
Car, pour que mes amis m’aient préparé des armes,
Il faut que mes malheurs soient déjà bien connus.
Or, si nos ennemis sont aussi prévenus,
Dans mes mains sont brisés ces projets de vengeance
Dont mon cœur savourait l’effroyable espérance :
Montrelais le félon pourra donc m’échapper,
Quand je comptais si bien dès demain le frapper! »
« Château-Thébaud est loin de la tour abhorrée
Et l’affreuse nouvelle y doit être ignorée :
Laissez donc l’arc viser le but auquel il tend.
Si l’ami qui, ce soir, chez Guéneuf nous attend
Est si bien informé, c’est qu’il avait, pour l’être,
Des raisons que n’a pas ce menteur et ce traître. »
Herblain raconte alors, tout en pressant le pas,
L’offre que Malestroit lui fit de ses soldats ;
Et Jeanne frémissait d’une sinistre joie,
En sentant sous son pied déjà trembler sa proie.
Le long récit avait abrégé le chemin ;
On était sur les Ponts : Jeanne prit par la main
Chacun de ses enfants, et leur rapide marche
Du dernier pont bientôt franchit la dernière arche.
Du long retard d’Herblain Guéneuf impatient,
L’attendait dans la rue, écoutant et veillant.
Comme il avait appris la vérité fatale,
De noirs projets gonflaient sa poitrine loyale,
Et vers Nantes parfois il étendait le poing ;
Mais quand, auprès d’ Herblain, qu’il reconnut de loin,
Il vit, entre ses fils, la pâle et chère dame,
Sa douleur n’y tint plus et jaillit de son âme.
Courant au-devant d’elle et tombant à genoux :
—- « Ah! Madame, dit-il, que j’ai pleuré pour vous!
Quel malheur! quel malheur!… Je refusais d’y croire ;
Mais la chose est trop vraie. Oh! l’effrayante histoire! »
—- « Guéneuf, le temps des pleurs est maintenant passé
Et c’est du sang que veut notre cher trépassé.
Dans la chambre secrète un seigneur doit m’attendre ? »
—- « Il n’attendait qu’ Herblain. »
—- « C’est bien ; je vais m’y rendre.
Dans un quart d’heure au plus, tiens-moi deux chevaux prêts
Mais écarte de nous tous regards indiscrets…
» Mes deux filles demain arriveront à Nantes
Et tu les conduiras chez une de leurs tantes :
Je ne puis les lier à mon sort incertain ;
Quant à mes fils, Guéneuf, ils suivront mon destin.
Guide-nous maintenant à la chambre secrète. »
Jeanne entre dans l’auberge et, comme Herblain s’apprête
A gravir après elle un étroit escalier
Qu’une lampe éclairait faiblement, l’hôtelier
Lui fait un signe : il faut que dans la salle il reste ;
Puis, voyant le vieillard hésiter sur son geste :
—- « Demeurez, dit-il bas, car je vais revenir ;
J’ai d’un grave mystère à vous entretenir. »
—- « Malestroit, dit Herblain, sur les plans qu’il médite,
S’il est seul avec vous, sera plus explicite ;
Laissez-moi donc, Madame, ici quelques instants. »
Sitôt qu’il eut conduit Jeanne et les deux enfants,
L’hôtelier vers Herblain descendit à la hâte :
—- « Notre horizon, fit-il, de tous côtés se gâte ;
Ce n’était pas assez du meurtre de Clisson :
Chacun veut de ses biens s’adjuger un tronçon. «
—- « Je ne t’ai pas compris, Guéneuf, que veux-tu dire ? »
—- « Deux hommes ce matin, Dieu puisse les maudire!
Deux hommes sont venus au Grand Lion d’argent,
Deux vieillards, deux seigneurs, tous deux se rengorgeant
Dans leurs riches habits tissus d’or et de soie,
Et nous jetant au nez leur insolente joie.
Herblain, rien qu’à les voir, c’était à les haïr,
Et ma haine, je crois, a failli se trahir.
Oh ! si mon front encore avait porté le casque !
Mais un bon hôtelier doit savoir prendre un masque :
Un air rébarbatif éloigne les chalands.
J’ai fait le gracieux avec ces insolents,
Sauf à porter ma grâce en compte à leur mémoire. »
—- « Guéneuf, au nom du Christ, abrége ton histoire. »
—- « Ne vous effrayez pas de vains épouvantails ;
Tout à l’heure c’est vous qui voudrez des détails,
Car, Herblain, mon secret, je le répète, est grave.
» Donc, en buvant mes vins, les meilleurs de ma cave,
Ces hommes parlaient, bas mais souvent, de Clisson…
Il passe en mon esprit je ne sais quel soupçon :
—-Vous êtes, messeigneurs, très-mal dans cette chambre,
Parmi tous ces manants… qui ne sentent pas l’ambre ;
J’ai là-haut un retrait, ma foi ! fort bien meublé :
On y cause, on y boit, sans peur d’être troublé.
Ces beutiers m’en voudraient offrir de grosses sommes,
Mais ce logis n’est fait que pour des gentilshommes…
» Déjà vous devinez où je les ai conduits ? »
—- « Et de ta politesse as-tu cueilli les fruits? »
—- « Oui, mais je doute, Herblain, que la moisson vous plaise.
» Quand ils se sont vus seuls, assis bien à leur aise,
Dans cette riche chambre, aux sourds lambris de bois,
Tous deux, sans plus de gêne, ont élevé la voix
Et, le vin déliant de plus en plus leurs langues,
S’ils ne se livraient pas à de longues harangues,
Je puis, mon cher Herblain, jurer que leurs discours
Étaient bien éloquents, quoiqu’ils fussent bien courts. »
—- « Mais tu me fais, Guéneuf, mourir d’impatience ;
Madame et Malestroit accusent mon absence. »
—- « De ces hommes, l’un est châtelain de Touffou,
Et l’autre… Devinez. » —- « Veux-tu me rendre fou ?
L’autre.? »
—- « Eh bien, l’autre, c’est. Je vous le donne en mille.
Et dire que mon toit put lui servir d’asile !
Mais Dieu pour le punir m’envoya mon soupçon. «
—- « Parle donc! L’autre.? »
—- « Est un des juges de Clisson ! »
—- « Et ton lâche poignard n’a pas frappé ce traître !
Que venait faire ici l’assassin de mon maître ? »
—- « Il disait que le Roi, pour payer dignement
La part, la large part qu’il prit au jugement,
Lui promet, en pur don, sauf les lois féodales,
Un des fiefs de Clisson tombés aux mains royales ;
Il vient donc de Paris voir, de ses propres yeux,
Celui de tous ces fiefs qui lui sourit le mieux :
Et son ami l’aidait dans le choix qu’il doit faire…
« Oh! ne me lancez pas ces regards de colère,
Herblain; si j’ai laissé sortir ces deux félons,
Leurs infâmes espoirs ne seront pas bien longs…
En les frappant ici, je pouvais compromettre
Tous les plans concertés pour venger notre maître :
J’étais sûr que ce soir vous deviez revenir,
Et tous deux, n’est-ce pas? vous saurez les punir. »
—- « Oui, c’est Dieu qui l’envoie et qui le prend au piège.
Mais, parle-donc, Guéneuf ; où le retrouverai-je? »
—- « Il doit passer la nuit de demain à Touffou. »
—- « Cet homme expirera demain sous mon genou. »
L’énergique vieillard rejoignit sa maîtresse.
Sur la part de chacun dans l’oeuvre vengeresse,
Entre elle et Malestroit tout était convenu,
Et, malgré son récit, leur plan fut maintenu ;
Mais au drame sanglant en germe dans ce pacte,
On jura d’ajouter les terreurs d’un autre acte…
C’est l’heure du départ; on se presse la main,
Et, comme à Sauvetour, chacun dit : « A demain ! »
CINQUIÈME PARTIE : LA VENGEANCE.
I. CHATEAU-THÉBAUD.
Vous que la ville ennuie avec son vain tumulte ;
Vous qui de la nature avez gardé le culte ;
Vous qui, las d’un art faux, recherchez en tout lieu
Les sublimes tableaux peints par la main de Dieu ;
Vous dont la poésie est partout la compagne :
Venez tous, ô rêveurs, venez dans ma Bretagne,
Et, vers quelque horizon que vous portent vos pas,
Les sites enchantés ne vous manqueront pas.
Oh ! sans doute, il est doux, je le sais par moi-même,
De se choisir pour guide un poëte qu’on aime,
De réciter ses vers dans les champs qu’il décrit
Et de vivre avec lui du cœur ou de l’esprit ;
Mais c’est un tort de voir avec les yeux d’un autre,
Car nulle émotion ne vaut pour nous la nôtre :
Cueillons donc nos plaisirs, pour les avoir complets,
Et préférons toujours les rayons aux reflets.
D’ailleurs, songez-y bien, la gloire a ses caprices ;
Moins humble, j’aurais pu dire : ses injustices !
L’homme le plus connu , le lieu le mieux chanté
N’est pas toujours celui qui l’aurait mérité.
Allez donc devant vous, comme à la découverte,
Savourant chaque vue à vos regards offerte ;
Puis, quand vous rentrerez un jour dans ce doux nid
Auquel un fil secret, même au loin, vous unit.
Fouillez aux souvenirs rapportés du voyage :
Parmi tous ces tableaux, le plus cher paysage,
Celui qui brillera du ton le plus doré,
Portera quelque nom tout à fait ignoré.
J’ai dans bien des pays traîné ma vie errante,
Eh bien ! après des ans nombreux, presque quarante !
De tous mes souvenirs peut-être le plus beau,
C’est toi, bourg sans renom, bourg de Château-Thébaud .
Sur son coteau brûlant, formé de blocs énormes,
Variant de grosseur, de hauteur et de formes ;
Au lieu même où l’église et son svelte clocher
Semblent braver l’abîme; oui, sur ce haut rocher
Qui forme sur le vide un étroit promontoire,
Se dressait, dans ces temps dont je conte l’histoire,
Un manoir, déjà vieux, ceint dans tous ses détours
De hauts murs crénelés, où se renflaient six tours,
Dont l’ombre protégeait quelques humbles demeures.
Sur une de ces tours, depuis de longues heures,
Un homme, dont le coude aux créneaux s’appuyait,
Semblait suivre des yeux la Maine qui fuyait,
Tour à tour blanche ou glauque, ici prompte, ici lente,
Aux caprices du lit où son onde serpente,
Là sur de gros cailloux, là sur un sable fin,
Mais charmante toujours et gazouillant sans fin.
Fraîches eaux, gais vallons, arbres aux bras robustes,
Grands rochers escarpés, nus ou chargés d’arbustes,
Bruyère à la fleur rose, ajoncs à la fleur d’or,
Gazons verts où l’on rêve, ombre épaisse où l’on dort,
O détails ravissants, dont, malgré tant d’années,
Sous cet aride amas d’illusions fanées,
Je garde un souvenir si vivace et si doux,
Cet homme sur sa tour ne songeait pas à vous.
Sur le vaste horizon si son œil se promène,
S’il épie avec soin les détours de la Maine,
C’est qu’au loin il entend la trompe des veneurs,
Les abois de la meute et les cris des piqueurs ;
C’est qu’il a vu parfois passer, dans les clairières,
De grands chiens noirs, sui vis de fuyantes crinières.
Tous les riches seigneurs sont absents du pays,
Les uns pour Hennebont, les autres pour Paris :
Qui donc mène aujourd’hui cette joyeuse chasse
Qui, depuis ce matin, de sa gaîté l’agace ?
Ces barons, que le Ciel comble de ses bienfaits,
Ses exploits n’ont-ils pas égalé leurs hauts faits ?
N’a-t-il donc pas comme eux risqué cent fois sa vie ?
Et l’on vient s’étonner qu’il soit rongé d’envie,
Lui qui sous leurs dédains courbe toujours le front.
Ah ! ces affronts secrets, ses soldats les paîront !
Las d’observer de loin, en se mordant la lèvre,
La chasse, qui restait sur les bords de la Sèvre
Et que les bois touffus lui cachaient trop souvent,
Le Galois de La Heuse, en maugréant, descend ;
Et tout soldat qu’il trouve est sûr d’un dur reproche.
Il lui semble bientôt que le cor se rapproche :
Il sort, et voit des serfs attroupés dans le bourg,
Autour d’un paysan qui revient du labour.
Il écoute et surprend une étrange nouvelle :
—- « C’est, et j’en suis certain, car j’ai passé près d’elle
Dans la Pièce aux Genêts qui mène au Grand Pâtis,
La dame de Clisson qui chasse avec ses fils. »
—- « Alors, dit un jeune homme, avec un ton de haine,
Noble et vilain n’ont pas même sang dans la veine,
Et monsieur le curé défend avec raison
Du serf à son seigneur toute comparaison ;
Car, chez nous autres serfs, on trouverait infâme
De voir aux yeux de tous s’ébaudir une femme,
Lorsque de son mari, tué par le bourreau,
La tête est à pourrir au-dessus d’un créneau. »
—- « Pouvez-vous insulter la noble châtelaine
Qui de tant de bontés fut pour nous toujours pleine ?
Dit une jeune femme à ce jacque futur.
Si ce qu’on vous a dit hier, en ville, est sûr,
L’effroyable malheur dont elle est accablée
Doit nous rendre indulgents pour sa raison troublée :
C’est la folie, hélas ! qui l’entraîne au plaisir.
Pauvre dame ! pour elle il vaudrait mieux mourir.
Nous la verrons bientôt descendre dans la fosse. »
—- « Non, reprit un vieillard, car sa nouvelle est fausse.
On a dû la connaître à Clisson comme ici,
Et quand la châtelaine aujourd’hui chasse ainsi,
C’est pour mieux démentir la calomnie infâme.
» Si la folie avait frappé la pauvre femme,
Au lieu de la laisser errer sur le coteau,
On l’eût, c’est évident, retenue au château.
On devrait t’arracher ta langue de vipère,
Mauvais gars, toujours prêt à mal dire, à mal faire,
Car ton récit n’a pas un grain de vérité.
» Le jour même où tu dis, ô menteur effronté,
Que du baron à Nante on exposait la tête,
On célébrait pour lui la plus brillante fête,
Et la fête a duré pendant toute la nuit…
Et ce que je dis, moi, ce n’est pas un vain bruit.
De grands feux ont là-bas brillé jusqu’à l’aurore
Et le soleil lui-même a pu les voir encore…
» Mais, tenez ! voyez-vous passer son blanc coursier ?
Elle tient sur son poing son gentil épervier.
Évidemment, vers nous la chasse se dirige. »
A ces mots Le Galois ressent comme un vertige :
Oh! si Jeanne pouvait s’arrêter au château,
Il verrait donc mûrir son espoir le plus beau !
Et, le cœur agité d’émotions diverses,
Il rentre dans le fort et fait baisser les herses.
A ce même moment, la dame de Clisson,
A son vif épervier ôtant le chaperon,
Disait : « Que dans les airs ton essor se déploie,
Et Dieu puisse à tous deux nous livrer notre proie ! »
II. LA SURPRISE.
Jeanne et ses officiers, gravissant le coteau,
Venaient d’atteindre enfin la porte du château.
La herse était baissée et neuf soldats de garde,
Debout, tenaient au poing, quatre la hallebarde,
Les autres l’arbalète, et tous semblaient vouloir
Défendre à tout venant le seuil du vieux manoir.
Sous leurs. sourcils froncés brille une flamme morne.
Herblain, portant la lèvre à sa trompe de corne,
S’apprêtait à sonner un solennel appel
A l’hospitalité des maîtres du castel,
Quand on vit, à travers la grille de la porte,
S’avancer dans la cour, en tête d’une escorte,
Un homme aux cheveux gris, mais au port élégant,
Qui marchait le front haut et d’un pas arrogant.
Sa cotte blasonnée et sa brillante armure,
L’orgueil de son regard , l’orgueil de son allure,
Tout lui sert de héraut pour proclamer son rang.
Pourtant, il fait effort pour se montrer galant.
Et son visage brun, d’ordinaire farouche,
Semble comme éclairé du souris de sa bouche.
Quoique vieux, ses exploits ne l’ont fait qu’écuyer ;
Mais qu’un puissant baron daigne un jour l’appuyer,
Il peut rêver l’honneur de la chevalerie,
Et d’avance il s’essaie à la galanterie.
D’un noble chevalier c’est la première loi :
Oui, bien servir son Dieu, sa patrie et son roi,
N’est qu’un devoir commun aux plus vulgaires âmes ;
Mais le vrai chevalier sait seul servir les dames.
Donc, le vieux commandant de l’antique manoir,
Du but longtemps révé voyant poindre l’espoir,
N’avait fermé son seuil devant la châtelaine,
Qu’il regardait d’en haut s’avancer dans la plaine,
Que pour la recevoir avec plus d’apparat,
Dans toute sa puissance et dans tout son éclat.
D’un pas majestueux devançant son escorte,
Le Galois fait hausser la herse de la porte
Et, prenant à la main son riche bicoquet,
Fait à Jeanne un salut gracieux et coquet :
—- « Noble dame, dit-il, vraiment ma honte est grande
De voir qu’en un castel où La Heuse commande,
La dame de Clisson ait pu devant ses pas
Trouver le seuil fermé par de grossiers soldats.
» Miracle de beauté, parlez : que puis-je faire
Pour calmer sans retard votre juste colère ?
Car, Madame, malgré vos efforts gracieux,
Des éclairs de courroux s’échappent de vos yeux. »
—- « Emportés malgré nous par l’ardeur de la chasse
Et d’un grand cerf dix cors suivant trop loin la trace,
Mes officiers et moi nous sommes harassés.
Voyez ! nos chevaux même à ce point sont lassés,
Que, si de mon château nous reprenions la route,
Plus d’un, frappé de mort, s’abattrait sans nul doute ;
Aussi, mes compagnons n’ont-ils pas hésité
A venir faire appel à l’hospitalité
D’un chevalier qu’on dit aussi galant que brave. »
—- « Madame, commandez, La Heuse est votre esclave.
Épouse d’un baron qu’aime le fils du Roi,
Merci, cent fois merci d’avoir compté sur moi.
Le cœur d’un chevalier bat dans cette poitrine
Et devant la beauté, devant vous je m’incline…
Et pourtant, je ne suis qu’un modeste écuyer !
» La Heuse rougirait de vous faire payer
L’hospitalier accueil qu’il vous offre avec joie ;
Mais si la déité qui passe sur ma voie
A mon faible mérite accordait son appui,
Jamais jour plus heureux dans mon ciel n’aurait lui. »
Tout en disant ces mots, l’emphatique La Heuse
A Jeanne, qui restait sombre et silencieuse,
Avait offert ses soins pour quitter l’étrier
Et glisser mollement de son haut destrier ;
Puis, du noble animal prenant en main la bride :
—- « Châtelaine, dit-il, souffrez que je vous guide,
A travers les détours de ce vaste manoir,
Vers la salle d’honneur qui doit vous recevoir.
Ce castel est fameux par plus d’un haut fait d’armes,
Mais jamais ses vieux murs n’avaient vu tant de charmes. »
D’un sourire contraint payant ce bon accueil,
Jeanne du fort maudit a dépassé le seuil.
Sur ses pas, les seigneurs qui lui servent d’escorte
Franchissent, deux par deux, l’étroite et sombre porte,
Et, devant leurs chevaux, en secret excités,
Qui se cabrent et font des bonds courts et heurtés,
Ils poussent à dessein, mais comme par mégarde,
En dehors de l’arceau les neuf soldats de garde.
A peine dans la cour, leur chef donne un signal :
Tous, en cercle rangés, ont sauté de cheval
Et, plus prompts que l’autour, dont l’aile se déploie,
Puis qui tombe soudain comme un plomb sur sa proie,
Sur les soldats surpris ils se sont élancés
Et, d’un genou nerveux les tenant terrassés,
Leur appliquent au cœur la pointe de leur arme,
Les menaçant de mort au moindre cri d’alarme.
Énervés par ce choc imprévu, les soldats
Se laissent bâillonner et lier pieds et bras,
Avant qu’un cri d’appel ait pu se faire entendre
Et sans qu’aucun d’entre eux essaie à se défendre.
Pendant ce temps, Herblain et deux ou trois seigneurs,
Qui portent comme lui la trompe des veneurs,
Font retentir les bois d’un joyeux air de chasse.
C’est sans doute un signal qui traverse l’espace,
Car, d’un ravin creusé dans les flancs du coteau,
Bientôt des bruits de pas montent vers le château.
III. – LE GALOIS DE LA HEUSE.
La Heuse a voulu fuir et tirer son épée ;
Mais sa double espérance est à la fois trompée :
Quatre bras vigoureux ont enlacé son corps
Et rendent impuissants sa rage et ses efforts.
Après qu’on a lié ses mains, on le désarme.
Le vieux soldat ne peut retenir une larme :
O honte ! ô désespoir ! vainement son regard
Parcourt avidement le cercle du rempart ;
Tout est désert, les tours, le mur et la courtine ;
Car lui-même, oublieux de toute discipline
Et ne prenant conseil que de son fol orgueil,
Il a, pour faire à Jeanne un plus splendide accueil,
Disposé ses soldats aux abords de la salle
Où devait s’étaler la scène triomphale.
Quoique désespéré, La Heuse a du sang-froid
Et, pour gagner du temps, sait cacher son effroi :
—- « Châtelaine, dit-il, non, je ne veux pas croire
Que de votre grand nom vous oubliiez la gloire.
Les Clisson n’ont jamais fait actes de bandits,
Et vous n’avez point part au crime ici commis.
Si vous aviez voulu de La Heuse la perte,
La Heuse aurait péri, mais par la force ouverte.
Ces hommes ont forfait à votre volonté
Et vous allez nous rendre à tous la liberté. »
—- « Vassal, dans tes liens cesse donc de te tordre.
Mes officiers n’ont fait qu’exécuter mon ordre ;
C’est moi seule, entends-tu ? moi, Jeanne de Clisson,
Qui viens dans ce château punir la trahison. »
—- « Eh bien donc, honte à vous ! car la chose est infâme :
Vous souillez votre nom et vous damnez votre âme.
Mais non; je mets un frein à mon cœur irrité.
Madame, écoutez-moi, voici la vérité.
» Vous voyez, j’ai vécu de nombreuses années,
Et mes illusions, si j’en eus, sont fanées ;
J’ai passé les trois quarts de mes jours dans les camps,
Et dans nos temps troublés les crimes sont fréquents ;
La Heuse n’a donc plus de ces pudeurs farouches
Que font pâmer d’effroi les actes un peu louches :
Il sait que certain fait dont on est révolté
Peut, à qui réfléchit, offrir un beau côté.
Je suis donc indulgent pour la force et la ruse :
Qu’on s’en serve, et parfois même qu’on en abuse,
Pourvu qu’on réussisse, eh! mon Dieu, c’est très-bien,
Puisque la fin, dit-on, ennoblit le moyen.
Mais il est des forfaits si monstrueux, Madame,
Que, si blasé qu’on soit, ils vous soulèvent l’âme.
» Le vôtre est de ceux-là , Madame; songez-y !
Quand, sur votre signal, ces hommes m’ont saisi,
Qui vous avait ouvert les murs de cette enceinte ?
C’était, rougissez-en, l’hospitalité sainte.
Ah ! vous ne songiez pas à cette énormité,
De violer les lois de l’hospitalité !
» Vous n’aviez pas bien vu le fond de votre crime.
Votre haine m’avait désigné pour victime,
Et, comme un vieux soldat, connu par son grand cœur,
Pouvait lutter longtemps. et demeurer vainqueur,
Vous avez demandé le succès à la ruse.
» Eh bien, sur mon honneur! La Heuse vous excuse ;
Il vous admire même. Oui, quelqu’un d’aguerri
N’aurait pas de mon toit sollicité l’abri ;
Mais votre âme novice a commis cette faute…
Vous ne pouvez plus rien sur moi : je suis votre hôte !
» Allons, repentez-vous d’un crime inachevé,
Le Galois oublîra que vous l’avez rêvé ;
Du, je vous le prédis, tous les lieux, tous les âges,
Peuples civilisés et peuplades sauvages,
L’univers tout entier crîra, sur mon signal :
Le bras qui frappe un hôte est un bras déloyal. »
Jeanne, dont un sourire amer plisse la bouche,
Marche droit à La Heuse et dit, d’un ton farouche
Qui lui fait jusqu’aux os courir un long frisson :
« Est-ce qu’on s’est montré loyal envers Clisson ?
Et pourtant il était l’hôte du roi de France. »
La Heuse a tout compris, le crime et sa vengeance :
« Oh ! dit-il, en poussant un sourd rugissement,
Dieu m’avait donc frappé d’un triple aveuglement ?
Le récit de ce serf était trop véritable!…
Mais si l’histoire est vraie, elle est épouvantable.
Quoi ! son époux est mort de la main du bourreau ;
Nantes et Montfaucon n’en ont plus qu’un lambeau ;
Les corbeaux et les chiens du reste ont fait leur proie :
Et j’ai vu resplendir hier ses feux de joie !
Et la voici qui chasse en pompeux appareil !
Et l’or de sa parure éclate en plein soleil !
Mais la femme n’est donc que mensonge et que feinte,
Car celle-ci portait le masque d’une sainte…
« Ah ! je m’emporte à tort et vous avez raison ; Oui, je devais m’attendre à votre trahison : La trahison sied bien à la veuve d’un traître.
» Mais de moi l’on se raille un peu trop tôt peut-être ;
Car ce château, par toi si lâchement surpris,
O femme sans foi, tremble, il n’est pas encor pris.
J’ai de nombreux soldats, et si, dans ma démence,
Je les ai dispersés pour fêter ta présence,
A mon premier appel ils vont se réunir
Et sauront vous chasser, traîtres, et vous punir.
» On ne réussit pas tous les crimes qu’on tente ;
Nous sommes plus de cent et vous êtes quarante.
Or, si tes beaux seigneurs cachent avec tant d’art,
Sous leurs habits brillants, leur dague ou leur poignard,
Mes soldats sont armés de bonnes arbalètes
Et leur carquois n’ont pas épuisé leurs sagettes :
Ils pourraient à plaisir vous tuer tous de loin ;
Mais il leur suffira de leur épée au poing. »
La Heuse avait repris toute son assurance
Et son front vaniteux rayonnait d’espérance ;
C’est que la garnison, instruite du danger,
Montait de toute part sur les tours se ranger.
Chaque instant des soldats voyait croître le nombre,
Et bientôt la muraille eut sa bordure sombre
D’hommes couverts d’acier, vigoureux, aguerris,
Et dont l’ardeur guerrière éclatait en longs cris.
La Heuse les montrant d’un regard fier à Jeanne :
—- « Quoi ! c’est donc sans profit que votre âme se damne ?
Les traîtres n’ont jamais que des triomphes courts.
Vous avez trop longtemps écouté mes discours ;
C’est de votre côté qu’ont passé les alarmes.
Voyez-vous mes soldats qui préparent leurs armes ?
Les viretons sont prêts et les arcs sont tendus :
Un seul signe de moi, vous êtes tous perdus.
» Allons, ne mettez pas ma colère à l’épreuve.
Je veux bien pardonner un caprice de veuve :
Le désespoir vous a mis la fièvre au cerveau ;
Mais le jeu n’est pas sûr autant qu’il est nouveau…
La Heuse n’aime pas à se voir pris au piège,
Et puisque ma pitié, Madame, vous protège,
Hâtez-vous donc de fuir, vous et vos gens,… sinon
Je pourrais avant peu retirer mon pardon. »
Pendant qu’il s’enivrait de sa menace folle,
Jeanne, le regardant sans dire une parole,
Lui montrait, à travers la porte du château,
Plus de trois cents soldats qui montaient le coteau,
Bien armés et tout noirs de corselets de mailles.
Et La Heuse sentit se glacer ses entrailles ;
L’espoir qu’il conservait, aux lèvres plus qu’au cœur,
Il le vit s’envoler avec un ris moqueur.
IV. LE FLÉAU DE DIEU.
Péan de Malestroit, qui commandait les troupes,
Prit soin de partager ses soldats en deux groupes :
L’un d’eux, formant ceinture aux murs du vieux manoir,
A tout essai de fuite enleva tout espoir ;
L’autre vint se ranger près de la châtelaine.
Les rangs étaient serrés : pourtant la cour fut pleine,
Et les captifs tremblaient devant les yeux ardents
De ces deux cents bandits armés jusques aux dents.
Olivier, par le bras traînant son jeune frère,
S’était, avec Herblain, placé près de sa mère.
Quand au poste assigné chacun eut pris son rang,
Un silence se fit, un silence effrayant :
Chacun , les yeux fixés sur les regards de Jeanne,
Attend l’arrêt fatal qui sauve ou qui condamne.
Jeanne reste impassible à force de souffrir ;
Mais Le Galois comprend qu’il n’a plus qu’à mourir.
Quoiqu’il eût dans le cœur des sentiments d’esclave,
En face d’un public Le Galois était brave
Et, devant le péril, dès qu’il était certain,
Son front se redressait et devenait hautain.
Si c’est d’un noble orgueil que naît le vrai courage,
La vanité souvent en reproduit l’image ;
Mais on les reconnaît aisément à ce trait,
Que l’un veut des témoins, quand l’autre est toujours prêt.
—- « Châtelaine, dit-il, qui m’as volé mes armes,
Tu peux faire couler mon sang, mais non mes larmes.
Tout à l’heure j’ai cru, dans mon aveuglement,
Que ton attaque était un premier mouvement,
Un accès de fureur, un désir de vengeance
Éclos presque au hasard d’un excès de souffrance ;
Mais à présent je vois, à tes combinaisons,
Que tu n’es pas novice en l’art des trahisons.
Égorge-moi donc vite et m’épargne l’injure
De disputer ma vie à ton âme parjure.
Tu dois être parfaite, et la déloyauté
A sans doute chez toi pour sœur la cruauté. »
Olivier, brandissant de ses deux poings sa hache,
S’élançait pour frapper à grands coups le bravache ;
Mais Jeanne le retint de la main et de l’œil :
—- « Laisse, enfant ; ce serait trop flatter son orgueil.
Cet homme doit périr, mais de la mort d’un traître.
» Vil chien, toujours courbé sur les traces d’un maître,
Tais-toi, si tu ne veux rude et prompt châtiment.
Tout à l’heure ta voix me flattait bassement :
Tu me croyais puissante, et ta lâche nature
Attendait de ma main quelque grasse pâture ;
Mais Jeanne de Clisson ne peut plus rien pour toi ;
Je suis une proscrite : allons, insulte-moi…
» Ah ! tu baisses les yeux et gardes le silence !
Ah ! la terreur enchaîne enfin ton insolence!
Tu fais bien de trembler, car nuls secours humains
Ne sauraient désormais t’arracher de mes mains. »
—- « Implorer ta pitié serait prière vaine ;
Mais, du moins, par quel crime ai-je attiré ta haine ? »
—- « Ton crime ! oh ! tu le sais, lâche, aussi bien que moi :
C’est d’avoir préparé le crime de ton roi.
« Quand à mon noble époux Édouard d’Angleterre,
Devant toute sa cour, en plein jour, sans mystère,
Rendit la liberté, sans vouloir de rançon,
Qui donc osa parler tout bas de trahison ?
» Ah ! tu rougis !… Tu vois qu’on m’a bien renseignée :
C’est d’ici que partit la flèche empoisonnée. »
– « Officier de fortune et vivant loin des cours,
De quel poids près du prince ont été mes discours ? »
—- « Sur ta part au forfait je ne suis pas trompée :
Je te connais ; tu vends ton sang et ton épée
A qui les veut, pourvu qu’il t’en donne un bon prix.
Seul, tu n’aurais donc droit qu’à mon profond mépris ;
On ne va pas chercher un serpent dans la vase,
Et ce n’est qu’en passant que mon talon t’écrase :
Ton venin ne pouvait atteindre mon époux.
Je cherche ici quelqu’un plus digne de mes coups.
» Regnaud de Montrelais , seigneur de ce domaine,
Désireux d’assouvir son envie et sa haine,
Et dans ses noirs projets encouragé par toi,
S’est fait le délateur de Clisson près du Roi.
Eh bien! contre la mort il n’a pas de refuge ;
J’amène les témoins, les bourreaux et le juge :
Herblain et Malestroit, mes deux témoins sont là ;
Le juge, le voici ; les bourreaux, les voilà.
» Soldats, j’ai trop longtemps retardé ma vengeance.
Ce château tout entier tombe en votre puissance :
Caves, bijoux, trésors, ici tout est à vous ;
Hommes, femmes, enfants, je vous les livre tous.
Sur eux pèse un arrêt de mort irrévocable :
J’ai fait à mon mari serment d’être implacable.
» Mais écoutez, soldats : j’ai fait un autre vœu,
Que je saurai tenir aussi, j’en jure Dieu.
Femme, je veux respect- à la pudeur des femmes :
La mort, mais pas l’outrage, ou malheur aux infâmes !
Ils seront à l’instant traînés dans cette cour
Et fouettés sans merci, puis pendus haut et court. »
Malestroit s’approchant de Jeanne, à qui la fièvre
Mettait l’éclair aux yeux et l’écume à la lèvre :
—- « Votre arrêt m’est sacré, si sévère qu’il soit,
Et, pour l’exécuter, comptez sur Malestroit.
Un grand cœur ne saurait supporter une offense
Et punir rentre encor dans le droit de défense ;
Mais je ne puis frapper qui ne se défend pas.
« Laissez-moi délier les mains de ces soldats,
Et que, l’épée au poing, ils disputent leur vie.
Qu’on dise, en racontant notre haine assouvie :
Entre eux et l’ennemi le péril fut égal,
Et dans sa cruauté leur bras resta loyal.
» La cruauté n’a rien, Madame, qui me blesse :
Le sang ne tache pas les mains de la noblesse.
Le châtiment vengeur, je le veux tout entier
Et pas un combattant n’obtiendra de quartier ;
Mais pourquoi donc souiller votre sainte vengeance ?
Les femmes, les enfants ont droit à l’indulgence.
Leur sang nous maudirait s’il coulait sous nos coups,
Car la Justice en pleurs se jette entre eux et nous. »
—- « Au volcan qui flamboie, à l’ouragan qui gronde,
A la mer qui se tord sur sa couche profonde,
A ces fièvres d’Asie aux souffles empestés,
A la flamme qui court à travers les cités,
Au fleuve débordé dévastant ses rivages,
Allez donc demander raison de leurs ravages !
Allez donc leur parler de justice et de lois !
Et tous vous répondront ce que vous dit ma voix :
» Nous, les fléaux de Dieu, nous, les choses sinistres,
Des colères du Ciel nous sommes les ministres ;
Si nous avons la force, à lui la volonté.
Quand les crimes du monde ont lassé sa bonté,
Dieu dit à l’un de nous, parfois à tous ensemble :
Allez! Et nous allons! Tout s’humilie et tremble ;
Car nous semons partout, sans pitié, sans remord,
Les pleurs et les sanglots, l’épouvante et la mort :
Et si nous écrasons, où nous pousse le Maître,
Des femmes, des enfants, des innocents peut-être !
Que nous importe à nous? cela regarde Dieu…
» Que tout périsse ici par le fer ou le feu :
J’ai beau sentir en moi crier ma conscience, J
e ne puis pardonner, car je suis la Vengeance. »
V. PÉAN DE MALESTROIT.
Pendant que Jeanne, en proie à sa fièvre de sang,
Prononçait cet arrêt cruel, mais innocent,
Car la raison a fui de son âme exaltée,
Un homme au grand galop gravissait la montée.
La poussière couvrait son long surcot de deuil
Et son cheval tomba mort, en touchant le seuil.
Tous les regards vers lui se tournent en silence.
L’homme, se dégageant, vers Malestroit s’élance,
Le serre dans ses bras et, le couvrant de pleurs,
Reste longtemps sans voix, courbé sous ses douleurs.
Malestroit, s’arrachant enfin à cette étreinte :
—- « Mon beau cousin, dit-il, d’un ton tremblant de crainte,
Qui peut faire pleurer un preux si renommé ? »
—- « Plus d’espoir ! plus d’espoir!… le crime est consommé.
Nos plus sanglants projets deviennent légitimes :
Nous avons à venger dix nouvelles victimes . «
—- « Quoi ! mon père?. mon frère ? »
—- « Hélas ! ils ne sont plus !
Eux et leurs compagnons, on les a traînés nus,
De leur prison du Temple au marché de la Halle.
Tous , oui, tous! sont tombés sous la hache fatale ;
Puis Philippe a fait pendre à d’infâmes gibets
Leurs cadavres sanglants, de la tête incomplets…
» Ce n’était pas assez de cette horrible fête ;
La vengeance du Roi n’était pas satisfaite :
Après avoir frappé par deux fois ta maison,
Voici ce qu’il a fait pour flétrir ton blason.
» Henri de Malestroit , ton oncle, homme d’église,
Conseiller de l’hôtel, vieillard à barbe grise,
Le Valois abhorré, mettant sa tête à prix,
L’a fait prendre en Bretagne et conduire à Paris ;
Et, ne pouvant encor le livrer au supplice,
Car sur un clerc l’évêque a seul droit de justice,
Dans un vil tombereau, sur un ais en travers,
Il l’a fait promener en cotte et sous des fers ;
Puis, lorsque le prélat, trop docile à la crainte,
A dégradé son clerc de sa qualité sainte,
Le Roi l’a de nouveau fait montrer dans Paris,
Sur une ignoble échelle, insigne de mépris.
» Le peuple, soudoyé, sur ton oncle se rue,
Et l’incessant affront le suit de rue en rue.
Le guet à son secours vient enfin, mais trop tard ;
Les pierres et la boue ont tué le vieillard. »
Pendant ce long récit, dont la source est trop sûre
Et dont chaque détail lui fait une blessure,
Malestroit, dédaigneux de tous respects humains,
Pleurait comme un enfant, le front entre les mains.
Chacun avec effroi le contemple en silence ;
La force refoulée a plus de violence,
Et chacun a compris que cet homme de fer,
Quand ses pleurs cesseront, les fera payer cher.
Jeanne, le cœur ému, du chevalier s’approche :
—- « Mon front rougit encor de ton sanglant reproche,
Mais je ne t’en veux plus, dit-elle avec douceur ;
Ta douleur de la mienne est désormais la sœur…
» Quand à nos deux maisons le Roi fait même offense.
Des complices du Roi prendras-tu la défense ?
Ah! tu peux sans remords répandre tout leur sang,
Car qui sert le Valois ne peut être innocent. »
Malestroit, à ces mots, qui frappent son oreille
Comme un son de clairon, de sa torpeur s’éveille.
Son front s’est relevé, tout chargé de courroux ;
Son regard foudroyant cherche où porter ses coups.
Le souvenir renaît en lui, mais encor vague…
Soudain, il pousse un cri, tire, en fureur, sa dague,
Et court sur Le Galois, la main levée… Horreur!
Chacun, jusqu’aux bandits, a frémi de terreur ;
Jeanne, Jeanne elle-même a détourné la vue,
En voyant au soleil briller la lame nue.
La Heuse, frissonnant et les bras désarmés,
Se courbe, et, malgré lui, ses yeux se sont fermés :
Tout son sang va jaillir sous l’arme vengeresse…
O magnanimité ! la dague, qui s’abaisse,
Respecte sa poitrine et… tranche ses liens !
—- « Va-t-en, lui dit Péan, va rejoindre les tiens ;
Je ne répondrais pas longtemps de ma colère,
Vil suppôt du tyran qui m’a tué mon père! »
Puis il court tour à tour à chacun des captifs,
Qui, couchés sur le sol, tremblaient, plus morts que vifs,
Et, trompant leur terreur par sa miséricorde,
Arrache leur bâillon et coupe en deux la corde
Dont on avait lié leurs jambes et leurs bras :
—- « Fuyez, je n’ai jamais frappé d’hommes à bas.
Rejoignez vos amis, mais sachez vous défendre,
Car, en fait de pitié, nul n’en doit plus attendre :
Le soldat pour punir vaudra bien le bourreau. »
Et, replongeant alors son poignard au fourreau,
Il tire son épée et dans l’air la balance,
En criant par trois fois : « Vengeance ! amis, vengeance ! »
Les bandits, quoique sourds aux sentiments humains,
Admirent ce grand cœur et lui battent des mains.
Olivier, s’élançant d’à côté de sa mère
Vers Péan, dont le front resplendit de lumière, Saisit avec transport son pesant gantelet Et le baise, en disant : « Oh! voilà qui me plaît !
Mon père eût seul pu faire une action plus belle :
Malestroit, vous serez mon maître et mon modèle. »
Déposant un baiser sur le front de l’enfant,
Qui lance alors vers Jeanne un regard triomphant :
—- « Fils de Clisson, d’en haut ton père te contemple ;
Tu n’as, pour être grand, qu’à suivre son exemple.
Le meilleur d’entre nous n’est pas digne de lui,
Mais tu peux à jamais compter sur mon appui. »
Et Malestroit ajoute, en montrant la muraille :
« C’est trop parler ! Voici l’heure de la bataille.
Il faut que ces gens-là meurent jusqu’aux derniers ;
Donc, soldats, à l’assaut ! et pas de prisonniers ! »
Agitant son épée, il s’élance à leur tête,
Et l’on entend mugir comme un bruit de tempête.
VI. L’ÉVASION.
Je ne décrirai pas ce combat furieux ;
Non, de ces flots de sang je détourne les yeux :
Je ne sais pas chanter ce que mon cœur condamne.
Le massacre touchait à sa fin, lorsque Jeanne,
Qui bravait le péril à côté de ses fils,
Entend hors de l’enceinte éclater de grands cris.
Elle sort, elle court. et voit avec surprise
Une corde qui flotte à la muraille grise,
Et, le long de la corde, un homme qui descend,
Les habits déchirés et tout rougis de sang.
Les flèches et les traits volent comme la grêle :
Leur sifflement aigu sans fin se renouvelle
Et fait autour de lui tourbillonner la mort ;
Mais il semble avoir fait un pacte avec le Sort.
Il descend, et n’a pas une seule blessure ;
Il descend, et son cœur qui tremblait se rassure :
A son œil abaissé le sol paraît prochain.
Plus qu’un dernier effort : son salut est certain…
Et sa voix bénit Dieu de sa miséricorde !
Quelqu’un sur le rempart vient de couper la corde…
La Heuse, car c’est lui que Jeanne voit fuyant,
Jette un grand cri de rage et tombe, en tournoyant.
Il reste sur le sol, étendu, sans haleine.
Dix à douze bandits, pleins de joie et de haine,
S’élancent d’un seul bond vers lui, pour l’achever…
Mais soudain Le Galois vient de se relever.
Aussi prompt que l’éclair, il traverse la foule
Et, traînant le tronçon de la corde, l’enroule
Au roc que vers la Maine il voyait se dresser,
La lance dans le vide et s’y laisse glisser.
Le voici qui franchit la rivière à la nage :
Un nuage de traits le poursuit au passage ;
Mais aucun ne l’atteint, et, sous les bois touffus,
Il disparaît aux yeux de ses vainqueurs confus.
Malestroit, de retour, dit : « Je vais le poursuivre. »
—- « Non, répond Jeanne; il a gagné le droit de vivre.
L’heure de son trépas n’a pas encor sonné ;
Mais qu’il tremble toujours : il n’est pas pardonné.
Si le Ciel lui ménage un lambeau d’existence,
Le Ciel le livrera plus tard à ma vengeance .
J’attends patiemment : le traître m’est promis…
» Mais que sont devenus nos autres ennemis ?
De tous ceux qui vivaient dans cette forteresse
Et qu’avait condamnés ma haine vengeresse,
Combien ont survécu ? » —- « Madame, pas un seul ! »
—- « Eh bien donc, que le feu leur serve de linceul.
» Oui, que des Montrelais l’odieuse tanière,
Sous la flamme et le pic s’écroulant pierre à pierre,
Disparaisse, à ce point que la postérité
Doute que ce manoir ait jamais existé .
» De sa destruction faites-vous une fête,
Braves soldats; fouillez des caves jusqu’au faîte ;
Payez-vous votre sang par un riche butin ;
Que le reste du jour ne soit qu’un long festin.
Quels que soient vos plaisirs, ne craignez aucun blâme ;
Mais qu’on voie à la nuit ce château tout en flamme,
Et que mes ennemis, regardant l’horizon,
Disent : La France a tort de toucher à Clisson.
» Malestroit, présidez à l’œuvre expiatoire ;
Mais, lorsque sur le ciel s’étendra la nuit noire,
Venez me retrouver, sans bruit… vous savez où ? »
—- « Madame, nous serons à minuit à Touffou. »
VII. LE CHATEAU DE TOUFFOU.
Il fait nuit, nuit profonde, et la voûte étoilée
Sous un épais nuage est aux trois quarts voilée.
Si les quelques rayons dans l’atmosphère épars
Laissent du noir château distinguer les remparts,
La forêt qui l’entoure est complétement sombre,
Et sa masse confuse au loin se perd dans l’ombre.
Tout dans ses profondeurs se tait; pas d’autre bruit
Que les pas indistincts d’un animal qui fuit,
Quelque branchage mort qui craque et tombe à terre,
Et, par moments, la voix du hibou solitaire.
Le vent du soir lui-même a cessé de souffler.
Dans ce calme profond, que rien ne vient troubler,
Pas même un frôlement du feuillage immobile,
Le château de Touffou s’est endormi tranquille.
Le guet, qui veille, a l’air de ne rien redouter…
Mais vous, dont l’œil sait voir et l’oreille écouter,
Ne vous semble-t-il pas, sous l’abri des grands chênes,
Entendre murmurer comme des voix humaines ?
Ne vous semble-t-il pas, près des halliers touffus,
Voir briller par instants comme des glaives nus ?
J’ai dit que dans le fort, comme sous la futaie,
Tout est silencieux et noir ; la chose est vraie :
Ses grands murs à créneaux et son groupe de tours
Ne découpent dans l’air que de vagues contours ;
Pas un seul mouvement n’anime son enceinte
Et la garnison dort, libre de toute crainte.
Mais le haut donjon jette, au milieu de la nuit,
Dans l’ombre une clarté, dans le silence un bruit.
C’est que sa grande salle éclate de lumières,
Et deux hommes assis y boivent à pleins verres,
Entrechoquant les vœux, les rires et les chants.
Tous deux sont des vieillards, car leurs cheveux sont blancs ;
Tous deux sont des soldats, car on voit aux murailles
Pendre deux casques d’or et deux cottes de mailles.
Et j’ajouterai, moi, qui surprends leurs discours :
Tous deux sont des brigands vernis du fard des cours.
Pendant que le donjon resplendit et s’égaie,
Voici ce qui tout bas se dit sous la futaie :
« A travers les rameaux déjà la lune luit,
Herblain : il ne doit pas être loin de minuit.
L’homme qui du château doit nous livrer la porte,
Semble bien retarder son signal ; mais qu’importe ?
Malestroit m’est fidèle et vient : j’entends là-bas
Résonner le pas sourd de ses trois cents soldats,
Et j’aime autant, Herblain, devoir à l’escalade
Le sang qu’à mes désirs marchande l’embuscade.
» Mais veilles-y ; je veux tous ici les frapper :
Que pas un cette fois ne puisse m’échapper.
Mort à tous ! sauf au Juge. A moi seule sa vie !
» O ma vengeance, enfin Dieu t’a donc bien servie ! »
« A vos ordres, Madame, on se conformera
Et de vos ennemis aucun n’échappera. »
Aux clartés du foyer, dont les flammes dansantes
Projettent dans les cours des lueurs rougissantes ;
Aux splendeurs des flambeaux sur la table allumés ;
Au choc des verres pleins d’hypocras parfumés ;
Sous l’excitation d’une ambition folle
Qu’un succès imprévu pousse dans l’hyperbole,
Et qui croit voir un fruit pendre à chaque bourgeon,
Voici ce qui tout haut se dit dans le donjon :
« Il m’a fallu ramper assez longtemps dans l’ombre.
Mes blessures, dont Dieu seul connaît bien le nombre,
Que m’ont-elles valu ? le rang de chevalier :
C’est-à-dire un vain titre avec un vain collier.
» Le fief, qui donne seul ici-bas la puissance,
L’or, qui de tout désir fait une jouissance,
Je les ai poursuivis au prix de tout mon sang ;
On me les refusait quand j’étais innocent.
Mais, cher maître, aujourd’hui que j’ai vendu mon âme
Et que j’ai pris ma part d’un jugement infâme,
Je vais être baron, je vais rouler sur l’or :
Ma fortune en plein ciel peut prendre un libre essor.
» Trouvant à le servir ma conscience prête,
Le Roi veut largement me payer une tête
Que j’aurais fait tomber gratis bien volontiers,
Tant j’étais las de voir ses fastueux lauriers.
Je vais de ce héros partager la dépouille…
» Oh ! l’or ne garde pas la tache qui le souille :
Qui me verra puissant me dira vertueux,
Et tous les fronts pour moi seront respectueux ;
Tu peux donc t’attacher sans crainte à ma fortune…
Ce n’est pas le remords qui, d’ailleurs, t’importune :
Pour se juger, nos cœurs se connaissent assez
Et nos exploits communs n’en sont pas effacés.
» Puisque, jusqu’à présent jaloux de ton mérite,
Le sort t’a, dans ses dons, fait la part si petite,
Que, malgré cinquante ans de souffrance et d’effort,
Tu n’es que châtelain d’un assez triste fort,
Beau comptable du Duc, collecteur de ses tailles ,
Coupons-nous tous les deux des habits à nos tailles.
» Que le Roi d’un grand fief me nomme le seigneur,
Et moi de mon château je te fais gouverneur.
Nous y vivrons tous deux en compagnons d’enfance,
Et ton chef n’aura pas pour toi trop d’arrogance.
» Donc, de tous ces beaux fiefs que le Roi peut céder,
Cite-moi le meilleur ; je vais le demander. »
VIII. L’EMBUSCADE.
Du chàteau, dont au loin la lune étendait l’ombre,
Un homme, à pas furtifs, gagna la forêt sombre.
C’était un vieux soldat de Clisson, et sa mort
De servir les Français lui faisait un remord ;
C’est donc de bonne foi que, ce soir, il croit n’être
Qu’un serviteur loyal qui va venger son maître.
Quand il eut dépassé la lisière du bois,
De quelque oiseau des nuits il imita la voix…
Le cri se répéta sans retard sur sa droite.
Alors, d’un pas plus prompt suivant la sente étroite,
Il rejoint bientôt Jeanne au rendez-vous connu :
—- « Si j’ai, Madame, omis le signal convenu,
C’est que dans le donjon notre châtelain veille,
Et mon signal eût pu monter à son oreille ;
Mais la porte est ouverte et vous pouvez entrer.
Venez venger la mort qui nous fait tous pleurer. »
Un soldat, du donjon gravissant la spirale,
Heurtait au même instant la porte de la salle.
Le châtelain l’ouvrit et dit d’un ton bourru :
« Qui donc vient nous troubler ?… Insolent, que veux-tu ? »
—- « Voyez donc comme à l’Est tout l’horizon flamboie ;
Quelque grand incendie y dévore sa proie.
Quels jets de flamme !… Oh ! non, je ne me trompe pas :
C’est bien Château-Thébaud qui brûle ainsi là-bas.
Faut-il sonner l’alarme et courir à leur aide ? »
« Oh ! quel excès de zèle aujourd’hui te possède !
J’aime à voir un chrétien surgir dans un ribaud ;
Mais, mon cher, laisse en paix brûler Château-Thébaud.
On le rebâtira : les Montrelais sont riches.
Si Satan prend plaisir à leur jouer des niches,
Est-ce ma faute à moi ? Pourquoi me déranger,
Quand mon fort de Touffou ne court aucun danger ?
Si tu viens m’assourdir de vétilles pareilles,
Je te fais au gibet clouer par les oreilles. »
Ah ! si, de la nature alors trompant les lois,
La muette forêt eût pu prendre une voix,
Elle eût poussé dans l’air des clameurs effarées,
En voyant la Ruine et la Mort conjurées
S’apprêter à franchir, dans cette nuit, le seuil
Du vieux château qui fut si longtemps son orgueil.
C’est qu’à flots incessants, par la poterne ouverte,
Des hommes pénétraient dans l’enceinte déserte !
Ces hommes marchaient tous d’un pas silencieux,
Mais dans l’ombre brillaient leurs armes et leurs veux.
N’en comptez pas le nombre : oh ! c’est toute une armée
Qui surprend et saisit la place inalarmée ;
La troupe envahissante emplit déjà les cours,
Et les tours, et les murs. il en entre toujours.
Des postes ont été placés à chaque issue :
La lutte est impossible et la fuite déçue…
Mais qui songe à la lutte, et qui donc cherche à fuir ?
Les lits de camp sont pleins : chacun est à dormir.
Seigneur, prenez pitié de ces âmes tremblantes
Qui, laissant ici-bas leurs dépouilles sanglantes,
Ont passé dans la mort à travers le sommeil
Et dans l’éternité vont trouver le réveil.
Que votre tribunal, dans vos sphères si hautes,
Ne soit pas, ô Seigneur, sans pitié pour leurs fautes :
Ces hommes n’ont pas eu le temps du repentir,
Tant, ô mon Dieu, la Mort fut prompte a. les saisir !
IX. UNE APPARITION.
Pendant que ta vengeance, ô Jeanne, fait son œuvre,
Terrible, mais muette, ainsi que la couleuvre
Qui, la nuit, s’est glissée au nid d’un pauvre oiseau.
On voit briller toujours le donjon du château.
Pas un bruit n’est venu, traversant les ténèbres,
Y porter le soupçon de ces scènes funèbres ;
Le guet, qui veillait seul, fut lui-même surpris :
Sa chute dans la douve a prévenu ses cris.
La fête, toutefois, touche enfin à son terme :
—- « Ma tête a des vapeurs et mon pied n’est plus ferme,
A dit le châtelain, qui vient de se lever.
A nos futurs honneurs allons gaîment rêver :
Il est tard, le feu meurt, les flambeaux vont s’éteindre.
Tout excès de plaisir à notre âge est à craindre :
A quoi me servirait d’être riche et puissant,
Si j’allais par avance appauvrir trop mon sang ? »
—- « Mon ami, la sagesse a parlé par ta bouche :
De ma santé le soin autant que toi me touche ;
Mais, puisque j’ai choisi, docile à ta leçon,
Pour mon cadeau du Roi le château de Clisson,
Remplis, remplis ma coupe, ô mon bon camarade.
Offre à ton vieux seigneur sa dernière rasade.
C’est bien. Ton hypocras est vraiment excellent,
Et j’en réjouirai le château qui m’attend…
Conviens que je t’ai dit une admirable histoire ;
Fêtons-la… Je ne puis boire seul à ma gloire :
Verse, verse à pleins bords, ami, fais-moi raison,
Et buvons tous les deux… au sire de Clisson. »
Comme il disait ces mots, en élevant son verre,
Les yeux sur son destin rayonnant de lumière,
La porte avec fracas s’ouvrit, et, sur le seuil,
Une femme apparut, en longs habits de deuil
Et tenant par la main ses deux fils. Cette femme
Se taisait, mais ses yeux lançaient des jets de flamme,
Et jamais front mortel n’eut plus de majesté.
Les vieillards, devinant presque la vérité,
Restaient le front baissé devant l’étrange groupe,
Et de leur main tremblante avait glissé leur coupe.
Enfin le châtelain de Touffou s’enhardit
Et, quoique pâle encore, il fait un pas et dit :
« O sombres visions, êtes-vous des fantômes
Échappés à minuit des lugubres royaumes ?
Je ne sais, mais je vais bientôt, le glaive en main,
Voir si de votre cœur coule du sang humain. »
Jeanne s’avance et garde un dédaigneux silence.
Sa troupe de seigneurs derrière elle s’élance
Et, s’alignant aux murs, attend, l’épée au poing.
Les vieillards ont cherché refuge dans un coin,
Les cheveux hérissés, la figure hagarde,
Sous l’œil fascinateur qui toujours les regarde.
Soudain, à la croisée un d’eux court comme un fou,
L’ouvre et s’écrie : « A moi, garnison de Touffou !
Venez ! à votre chef venez prêter main-forte. »
« Ta garnison ! lui dit un seigneur, elle est morte.
Nous l’avons tout entière égorgée, et, vous deux,
Pour être encor vivants, n’en valez guère mieux :
Votre mort ne dépend que d’un mot ou d’un signe. »
—- « C’est mensonge odieux ou trahison insigne,
Car nul bruit de combat jusqu’à nous n’est monté ;
Non, le fort de Touffou n’est pas encor dompté…
S’il l’était, vous seriez des assassins infâmes. »
Comme il parlait encor, des tourbillons de flammes,
Qui des caves montaient jusqu’au sommet des tours,
De leurs rouges splendeurs ont éclairé les cours…
Et garder quelque espoir serait de la démence,
Car, après de grands cris, suivis d’un rire immense,
On entend tournoyer la ronde des vainqueurs.
Le sang des deux vieillards se figeait dans leurs coeurs :
—- « Mais qui donc êtes-vous et quel but vous amène ?
La guerre qui renaît, le pillage ou la haine ? »
Jeanne ne répond pas, mais son œil obstiné
Des deux amis tremblants ne s’est pas détourné ;
On dirait qu’elle éprouve une secrète joie
A sentir se débattre et palpiter sa proie.
Mais son regard de feu soudain s’avive encor ;
Sa vengeance trop lente est pour elle un remord :
Elle a cru voir passer dans la nuit étoilée
L’ombre de son époux, sanglante et mutilée,
Qui lui crie, en montrant les lâches que voilà :
« Je suis mort de la main d’un de ces hommes-là. »
Ces deux hommes vont donc mourir, mais pas ensemble.
Que celui qui jugea Clisson pâlisse et tremble ;
Car mieux vaudrait pour lui les tourments d’un damné,
Que le supplice auquel Jeanne l’a condamné.
X. LES DEUX AMIS.
La châtelaine étend le bras vers les coupables,
Et leur arrêt se lit dans ses yeux implacables.
Bourrelés de remords et d’épouvante fous,
Ces deux anciens soldats sont tombés à genoux ;
Du geste et du regard ils implorent leur grâce.
Le moins lâche des deux, bégayant à voix basse :
—- « O Madame, dit-il, pour mourir, qu’ai-je fait?
Pour m’en justifier, dites-moi mon forfait »
Jeanne, croisant les bras, en face d’eux s’avance :
—- « Pour oser discuter avec moi ma vengeance,
Votre impudence est rare et ne se comprend pas.
J’ai fait jusqu’au dernier massacrer vos soldats,
Et pourtant ils n’avaient, pour tomber mes victimes,
Que le tort inconnu du contact de vos crimes ;
Et vous, qui savez trop ce que vous m’avez fait,
Vous dont la langue tremble en parlant de forfait,
Vous croyez me fléchir par de vaines paroles ?
Étouffez dans vos cœurs vos espérances folles.
Vous rougirez de vous en apprenant mon nom :
Osez donc implorer la veuve de Clisson ! »
Le châtelain se traîne à genoux devant Jeanne :
—- « Ce n’est pas moi, dit-il, que votre nom condamne,
C’est cet homme, Madame, et, vous le savez bien,
Dans le crime à punir, moi je ne fus pour rien.
Quand cet homme à Touffou vint chercher un refuge,
De Clisson j’ignorais qu’il eût été le juge ;
Je l’aurais, sans cela, croyez-en mon serment,
Comme un traître qu’il est, chassé honteusement. »
—- « Oh ! ne le croyez pas, Madame, c’est un lâche.
S’il n’a pas partagé la douloureuse tâche
Que m’avait imposée un ordre de mon roi
Et que je n’ai remplie, hélas! qu’avec effroi,
O mon Dieu, faut-il donc qu’un tel forfait me souille ?
C’est lui qui, de Clisson me montrant la dépouille,
A mes cupidités voulait donner l’éveil ;
Mais j’ai rejeté loin son odieux conseil,
Car c’est assez d’avoir, et je m’en désespère,
Sans dépouiller vos fils, fait condamner leur père. »
—- « Le couard ! sous mon toit pourquoi l’ai-je abrité ?
Tu mens impudemment… Voici la vérité.
Oui, devant vous je veux, Madame, le confondre :
Lorsque votre courroux est sur nous venu fondre,
Cet homme, en le disant j’éprouve un long frisson,
Cet homme se nommait le sire de Clisson. »
Olivier à ces mots a blêmi de colère :
—- « Quelle honte pour nous, quelle honte, ô mon père,
Qu’un pareil homme ait pu, ne fût-ce qu’un instant,
Parer sa lâcheté de ton nom éclatant ! »
—- « Oh ! la honte, dit Jeanne, est pour le roi de France,
S’il connut et permit une telle espérance. »
Puis, lanant à plein cœur son indignation :
—- « C’est assez vous vautrer dans votre abjection.
Votre assaut de bassesse est sans but et me lasse ;
La femme de Clisson ne peut vous faire grâce.
Rappelez-vous l’auberge où tous deux, hier soir,
Vous dérouliez le plan de votre infâme espoir.
» Péan de Malestroit, je vous livre cet homme :
Qu’il meure par le fer ainsi qu’un gentilhomme,
C’est bien ; mais quand j’irai vous retrouver là-bas.
Que son âme ait rejoint l’âme de ses soldats. »
Le châtelain essaie en vain de se défendre ;
On l’entoure, on l’entraîne, on le force à descendre
L’escalier tortueux, dont les derniers degrés
Sont d’un rouge reflet vivement éclairés.
A peine a-t-il passé l’ogive de la porte,
Péan et les seigneurs qui lui prêtent main-forte
Livrent le malheureux aux soldats, et bientôt
Retentit un grand cri, suivi d’un sourd sanglot…
Malestroit remontant dit à Jeanne : « Madame,
Sa faute est expiée et Dieu juge son âme. »
L’autre vieillard qui tremble, incertain de son sort,
Attend à deux genoux, aussi blême qu’un mort.
Jeanne, tout absorbée en un sombre silence,
Semble en ses profondeurs sonder sa conscience ;
Vers le ciel tout à coup elle élève la main.
Et son œil resplendit d’un éclat surhumain.
Tous les seigneurs rangés dans la salle autour d’elle
Pressentent quelque scène atroce et solennelle.
—- « Dieu juste, Dieu vengeur, dit Jeanne, jusqu’ici,
Quand ma voix prononça des arrêts sans merci,
J’ai senti dans mon cœur des révoltes secrètes :
Le pardon eût souvent trouvé mes lèvres prêtes,
Si je n’avais pas craint de te désobéir…
Car je ne suis pas faite, ô mon Dieu, pour haïr.
» Mais lorsque le hasard, ou plutôt ta justice,
Voulant sans doute au crime égaler le supplice,
Amène de si loin et jette en mon pouvoir
Un de ceux dont l’arrêt me voue au désespoir ;
En face de cet homme, aussi lâche que fourbe,
Dont le front à mes pieds s’humilie et se courbe :
La haine, dans mon sein allumant tous ses feux,
Fait un souhait de mort de chacun de mes vœux,
Et je n’éprouve plus ni pitié ni scrupule.
J’attise avec bonheur la flamme qui me brûle ;
Mais parmi les tourments, même les plus cruels,
Qu’ait jamais inventés la fureur des mortels,
Je n’en trouve pas un qui plaise à ma vengeance.
» Oh ! que n’ai-je ma part de ta toute-puissance,
Et, fondant en un seul tous les maux de l’enfer,
C’est ce supplice-là que cet homme eût souffert! »
XI. UN ARRÊT POSTHUME.
Jeanne, en disant ces mots, semblait lancer la foudre.
Le Juge épouvanté, se traînant dans la poudre,
Criait, en soulevant ses maigres bras tremblants :
—- « Madame , ayez pitié d’un homme à cheveux blancs. »
—- « L’honneur de la vieillesse, oh ! c’est moi qui le venge :
Tes cheveux sont souillés et de sang et de fange.
Oui, tout ce qui commande ici-bas nos respects,
Tu l’as déshonoré par tes vices abjects,
O vieillard sans vergogne, ô soldat sans vaillance,
Chevalier sans honneur, juge sans conscience…
Que dis-je ? un juge ! oh ! non , tu n’es qu’un assassin. »
Et Jeanne alors, tirant un poignard de son sein :
—- « Clisson, ô mon époux, si loyal et si brave,
Je rougis de t’offrir le sang de cet esclave :
La victime est, hélas ! trop peu digne de toi,
Mais ne vois dans sa mort qu’un gage de ma foi. »
Et Jeanne, d’une main convulsive et peu sûre,
A saisi du vieillard la blanche chevelure,
Pendant que l’autre bras lève sur lui le fer :
—- « Je devrais te plonger sans pitié dans l’enfer ;
Mais, chrétienne, je veux en toi respecter l’âme
Que Dieu te donna pure et que tu fis infâme.
Lave donc ton forfait dans un dernier remord
Et prie… Oui, mais sois court, car j’ai soif de ta mort. »
Et le Juge, essayant ses dernières défenses,
Cria : « Pardonnez-nous, ô mon Dieu, nos offenses,
Comme nous pardonnons à qui nous offensa. »
Sur la face de Jeanne un nuage passa.
Repoussant du vieillard la chevelure blanche
Et jetant son poignard au loin, son front se penche.
Soudain se redressant : —- « Je ne puis pourtant pas,
Cher Olivier, laisser impuni ton trépas !
Être juste, ô mon Dieu, n’est pas être cruelle ;
Tu reçus mes serments et j’y serai fidèle :
Des préceptes sacrés cet homme abuse en vain ;
Il n’en mourra pas moins, s’il échappe à ma main.
» Péan de Malestroit, âme droite et loyale,
Et vous, nobles seigneurs, vous tous qu’en cette salle
Rassemble autour de moi l’espoir du châtiment :
Lorsque luira le jour du dernier jugement,
Quand nous comparaîtrons au tribunal suprême,
Devenez mes témoins, ô compagnons que j’aime ;
Que je vous trouve encor debout à mon côté.
» Et si quelqu’un m’osait taxer de cruauté,
Oh ! dites, pour m’aider à subir mon épreuve :
Dieu juste , de Clisson nous avons vu la veuve
Sous son poignard levé tenir son assassin,
Et son poignard tomba sans lui percer le sein.
» Ne va pas te bercer d’une espérance vaine,
Vil complice du Roi ; je conserve ma haine,
Et tes lâches efforts, traître, pour l’apaiser,
Bien loin de l’amortir, n’ont fait que l’aiguiser.
» Oh ! oui, si je renonce à me faire ton juge,
Peut-être, ô chevalier, n’est-ce qu’un subterfuge :
Clisson a dès longtemps disposé de ton sort ;
Ce n’est plus moi, mais lui qui te condamne à mort.
» O toi qui vis mourir ton maître, Herblain, avance,
Et de Clisson mourant redis-lui la sentence. »
Au fond de ses terreurs le vieillard retombé
Cachait entre ses mains son front pâle et courbé.
Il ferme en vain les yeux ; une ombre vengeresse
De ses yeux clos se raille et devant lui se dresse…
Et puis tout s’éclaircit, tout redevient vivant ;
Il revoit le tableau qui le poursuit souvent :
Et le Grand-Châtelet, et sa bruyante place,
Et les deux échafauds se regardant en face,
Et, sur le noir tapis, ce grand et fier baron,
Dont le geste ou la voix lui fait baisser le front…
Pitié, Seigneur, pitié ! car tout s’anime encore :
Voici du condamné la voix grave et sonore.
Non, ce n’est pas Clisson qui parle, c’est Herblain ;
Mais le Juge retrouve un écho dans son sein,
Qui rend aux fiers adieux dont Herblain dit les termes
Leurs accents d’autrefois, si mâles et si fermes.
—- « Vous tous, beaux chevaliers, plus prudents que hardis,
Qui, courbant sous le joug des fronts abâtardis,
Vous laissez atteler aux fonctions de juges,
Hâtez-vous de chercher quelques secrets refuges.
» Je laisserai deux fils, orphelins de par vous ;
Leur mère leur dira : Si je n’ai plus d’époux,
Si vous êtes privés des caresses d’un père,
Si tous nous n’avons plus que honte et que misère,
C’est que vingt chevaliers ont, pour plaire à leur roi,
Pris ses désirs pour règle et ses ordres pour loi ;
Et notre unique ami, leur lâche complaisance
L’a tué, sans pitié, malgré son innocence. »
—- « Ce que disait Clisson, je l’ai dit à mes fils,
Et tous de votre arrêt nous vous gardons le prix…
» Continuez, Herblain, l’immutable sentence. »
Les seigneurs frémissants écoutaient en silence.
—- « Tremblez, beaux chevaliers, car mes fils ont grandi ;
Leur corps est vigoureux et leur cœur est hardi.
Vous leur appartenez ! oui, tous tant que vous êtes !
Sous leurs glaives vengeurs tomberont vos vingt têtes.
Vous vous cachez en vain : ils vous reconnaîtront
Aux taches de mon sang qui marquent votre front. »
—- « Je suis, dit Olivier, bien jeune; mais peut-être
Ai-je un bras assez fort pour châtier ce traître :
Ma hache sur son cou va bientôt s’essayer,
Car ta dette, mon père, oh ! je veux la payer. »
—- « Sois béni, noble enfant, de ta colère sainte ;
Mais étouffe en ton cœur et l’injure et la plainte :
Connaissons les arrêts par ton père dictés
Et qui tous, quels qu’ils soient, seront exécutés.
» Tu nous fais bien souffrir, Herblain; n’importe, achève.
—- « Grâce ! grâce! Madame… Ah! quel horrible rêve ! »
—- « Un rêve ! oh ! non, hélas! tout n’est que trop réel.
Mais poursuis donc, Herblain, cet arrêt solennel. »
—- « Jouissez de ma honte et n’en soyez pas sobres ;
Car votre mort à vous sera pleine d’opprobres
A ce point, que vos fils, honnis et dépouillés,
Rougiront de porter des blasons trop souillés.
Ne pouvant les laver, malgré toutes leurs larmes,
Ils quitteront vos noms, ils quitteront vos armes.
Personne ne saura quels vous avez été ;
L’on ne connaîtra plus que votre lâcheté…
L’oubli vous offrira ses ignobles refuges :
En racontant ma mort, si l’on cherche mes juges,
L’Histoire répondra, dans ses justes dédains :
On ne sait plus les noms de ces vingt assassins ! »
Le Juge se roulait d’effroi dans la poussière.
Olivier se jetant dans les bras de sa mère :
—- « Pauvre mère adorée, oh! que tu dois souffrir!
Cet homme, tu l’as dit, cet homme va mourir ;
Mais mon père a légué ma vie à sa vengeance :
Laisse-moi disposer seul de son existence.
Je sais comment lui faire expier son forfait ;
Sa honte nous paîra le mal qu’il nous a fait.
Mère, ici restez donc avec mon jeune frère,
Et tous deux priez Dieu pour l’âme de mon père…
» Vous, Malestroit, traînez cet homme dans la cour,
Et qu’il maudisse l’heure où son œil vit le jour. »
Brisé par la douleur qui l’accable et le navre,
Le vieillard s’est laissé porter comme un cadavre.
XII. LES ROUTIERS EN GAIETÉ.
Au milieu de la cour flamboyaient de grands feux,
Qui roulaient sur le ciel leurs tourbillons fumeux,
Et des flancs du fort même, où brûlait l’incendie,
Jaillissait une flamme incessamment grandie.
Les routiers tout sanglants, qui, depuis le matin,
Se gorgeaient sans mesure et de cidre et de vin,
Près des larges brasiers formant différents groupes,
Aux tonneaux défoncés puisaient à pleines coupes.
L’ivresse et la gaîté leur servant d’échansons,
C’étaient des rires fous et de folles chansons ;
Puis, les mains s’enchaînant tout à coup pour la ronde,
La danse tournoyait, hurlante et furibonde.
Aussi, quand le vieillard, dans la cour descendu
Vit la ronde infernale, il se sentit perdu.
—- « Herblain, dit Olivier, fais retentir ta trompe ;
Il faut que cette orgie à l’instant s’interrompe.
Tâche qu’autour de moi tous viennent se ranger,
Car ce sont ces démons qui doivent nous venger. »
Aux sons du cor d’Herblain la ronde s’est rompue ;
Les routiers, redoutant une attaque imprévue,
Accourent et, formant un cercle aux rangs nombreux,
La main sur leurs poignards, l’interrogent des yeux.
Olivier, s’élançant sur un degré de pierre,
Étend le bras et dit, d’une voix haute et fière :
« Vous n’êtes menacés, amis, d’aucun danger
Et, si de vos plaisirs je viens vous déranger.
C’est que je vous apporte une nouvelle joie…
Oui, battez tous des mains, car voici votre proie.
Cet homme, qui se tord lâchement à mes pieds
Et cache en ses genoux ses traits terrifiés,
A commis un forfait d’une nature telle,
Qu’il faut pour le punir une peine nouvelle.
La mort n’y suffit pas : ce prévaricateur
Doit voir souiller son nom d’un complet déshonneur.
» Vous pouvez mesurer son méfait à ce signe,
D’entendre ainsi parler, sans que le ciel s’indigne,
Sans que la foudre gronde et que l’éclair ait lui.
Un enfant, comme moi, d’un vieillard, comme lui.
» Aidez-nous donc, amis, à châtier son crime.
Pourvu que vous gardiez la vie à la victime,
Versez-lui sans mesure et la honte et l’affront ;
Oui, qu’il en soit sali des pieds jusques au front…
Cet homme est un jouet que je vous abandonne.
» La bourse que voici, pleine d’or, je la donne,
En prix, à ceux de vous qui sauront inventer
Quelque outrage qu’on n’ait jamais osé tenter. »
Un hourra de bonheur accueille la harangue.
Tel qu’un tigre, qui suit des yeux et de la langue
La biche sur laquelle il s’apprête à bondir,
Tel de chaque soldat on voit l’œil resplendir,
A l’espoir de gagner la bourse d’or promise.
Le vieillard, pantelant sous cette convoitise,
Crie, en faisant pour fuir un inutile effort :
« Je ne demande plus pour grâce que la mort. »
—- « Allons, dit Olivier, commencez son supplice ;
Quoi que vous puissiez faire, il n’aura que justice. »
Je ne souillerai pas, ô lecteurs, votre esprit
Du détail des horreurs que cet homme souffrit.
L’injure, les souffiets, les crachats à la face
Ne sont de ses tourments que la simple préface :
Non content des affronts dans l’Histoire enfouis,
Pour lui l’on inventa des affronts inouïs ;
Et, pour trouver l’outrage ou sanglant ou grotesque,
Fiez-vous, ô lecteurs, à cette soldatesque
Qui se gorge de vin et veut se gorger d’or !
—- «Oh ! grâce ! grâce! assez ! » —- « Non ! dit l’enfant. Encor !»
Et le supplice atroce alors se renouvelle,
Aux applaudissements de la bande cruelle.
La troupe est gaie et veut varier son plaisir :
On dépouille cet homme, on le force à courir ;
Et chacun le poursuit; et quiconque l’attrape,
Du plat de son épée ou de son pied le frappe…
Si l’haleine lui manque et qu’il s’arrête un peu,
On lui jette, en riant, des tisons tout en feu.
A voir ces grands brasiers aux clartés fantastiques,
Ce vieillard nu, qui court, sous les cris frénétiques
De tous ces hommes noirs à sa suite acharnés,
L’épouvante vous gagne et l’on songe aux damnés.
Le Ciel, vengeur du crime, ô sombre châtelaine,
A-t-il donc exaucé le souhait de ta haine,
Et cet homme va-t-il souffrir de ces bandits
Tous les maux qu’a vus Dante et qu’il nous a redits ?
Après avoir deux fois fait le tour de l’enceinte,
Sous l’excitation nerveuse de la crainte,
L’infortuné vieillard, par la course épuisé,
Le corps couvert de sang, haletant et brisé,
Glisse aux pieds d’Olivier sur ses jambes pliantes,
Et, tendant vers l’enfant ses deux mains suppliantes,
S’écrie : « Ah ! par pitié, donnez-moi donc la mort ! »
L’impitoyable enfant répète : « Encor ! encor ! »
Le supplice du Juge à ces mots recommence.
L’ivresse et la gaîté vont jusqu’à la démence,
Et les routiers, cédant à leurs instincts pervers,
Inventent des affronts qu’ignorent les enfers.
C’est que dans les excès de la horde infernale,
Dieu fait régner encore une règle morale ;
Ici, l’on foule aux pieds toute loi, tout devoir :
Oui, bandits, les démons rougiraient de vous voir !
Olivier, indigné de tant d’ignominie,
Crie aux bourreaux : « Assez! la torture est finie » ;
Et leur jetant, de loin, sa bourse pleine d’or :
—- « Partagez, leur dit-il, entre vous ce trésor.
Cette bourse est à vous, puisque je l’ai promise ;
Mais vous avez franchi la limite permise :
Au lieu de n’outrager que ce vieillard sans foi,
Vos ignobles ébats m’offensent aussi, moi
Pour châtier un crime, il n’en faut pas commettre,
Et je vous punirais, si j’étais votre maître.
Vous osez murmurer! Oh! je ne vous crains pas.
Le premier qui m’insulte est près de son trépas :
Oui, craignez le courroux qui dans mon sein s’amasse.
» Lâchez donc ce vieillard : Olivier lui fait grâce.
Tous ses torts envers nous ne sont pas effacés,
Mais il est temps qu’il meure : il a souffert assez…
» Qu’entre deux vils pourceaux au gibet on le pende.
La différence entre eux n’est pas déjà si grande !
» Meurtriers de mon père, ô juges exécrés,
Vous méritez sa peine et vous la subirez. »
Comme un dogue dompté grogne sans oser mordre,
Les bandits frémissants ont exécuté l’ordre,
Et ce qu’il contenait encor de cruauté
Les consolait un peu du plaisir avorté.
Bientôt du haut donjon l’enfant gagnant le faîte
Put dire : « Descendez, mère; justice est faite. »
Au souffle du matin le ciel s’est épuré
Et mainte étoile d’or brille au dôme azuré ;
Des astres de la nuit la pâle-souveraine
Verse les flots d’argent de sa clarté sereine.
Mais depuis quelque temps, sous l’ombre des grands bois,
On entendait gémir de lamentables voix.
Est-ce au vent de la nuit la feuille qui se froisse ?
Non, la brise n’a pas de ces longs cris d’angoisse.
Ce sont, ô Dieu vengeur, les voix des trépassés…
Tous, jusqu’à Malestroit, sentent leurs cœurs glacés ;
Jeanne seule et son fils n’éprouvent nulle crainte :
Ils ont fait leur devoir et leur vengeance est sainte.
XIII. PEN-MARC’H.
D’où vient donc la terreur qui règne dans Pen-Marc’h
La mer est basse. On voit, comme dans un grand parc
Où dort un troupeau noir de bêtes monstrueuses,
On voit, couchés aux bords des passes tortueuses,
Des groupes inégaux de rochers, dont les flancs,
Frappés par le soleil, sont tout étincelants.
Sous le vert goëmon qui leur sert de crinière,
Immobiles, muets et baignés de lumière,
Ces monstres sous-marins, ces horribles rescifs,
Comme des ours domptés semblent inoffensifs ;
Mais leur aspect hideux vous glace et vous repousse.
Pourtant cette soirée est charmante, et si douce
Que les regards, séduits par sa tiède clarté,
Prêtent à chaque objet un reflet de beauté.
Non, la sérénité du jour n’est qu’apparente :
Sous ce calme trompeur la nature est souffrante.
L’azur éclate au ciel, mais l’air est étouffant.
La mer s’est endormie au soleil, et le vent
De son aile légère en ride à peine l’onde ;
Mais dans son lourd sommeil la mer sourdement gronde,
Comme un volcan trop plein où bout la lave en feu.
Des bords de l’horizon, tout à l’heure si bleu,
D’épais nuages gris montent, montent sans cesse,
Et, jetant un linceul sur le soleil qui baisse,
Font, à ce jour doré qui plaît tant au regard,
Succéder brusquement un jour morne et blafard ;
Et les oiseaux de mer, qui pressentent l’orage,
Regagnent, en criant, les rochers du rivage.
Ces oiseaux ont raison : oui, c’est bien l’ouragan
Qui vient avec le flux et gonfle l’Océan.
Avez-vous vu là-bas trembler un éclair pâle ?
Entendez-vous ces bruits roulant comme un sourd râle ?
Oui, c’est bien l’ouragan; mais il est encor loin.
Eh! qu’importe où qu’il soit? Je suis votre témoin,
O pêcheurs de Pen-Marc’h, dignes fils des vieux Celtes,
Dont un cœur indompté fait battre les flancs sveltes :
Ni les vents mugissants, ni la mer en fureur,
Ni le tonnerre en feu n’ont pour vous de terreur.
Vous avez vu cent fois au granit de vos côtes
Se heurter, en hurlant, les vagues les plus hautes ;
Et qu’est-il résulté de tant d’orgueilleux chocs,
Sinon un peu d’écume au sommet de vos rocs ?
Leurs massifs éternels, gardant la même forme,
Bravent tous les assauts de l’Océan énorme ;
Et l’Océan vaincu, furieux, rugissant,
Se tord de désespoir de se voir impuissant.
Or, les Bretons, témoins de ces jeux redoutables,
Sont, comme leurs rochers, devenus indomptables.
Lorsque les éléments mêlent, dans leurs complots,
Les colères de l’air aux colères des flots,
Si le pêcheur breton croit, parfois, que l’orage
Peut dépasser sa force et non pas son courage,
Il rentre en sa cabane et, fermant les volets,
Il répare, en sifflant, les trous de ses filets,
Pendant que, dans un coin, ses filles et leur mère
Pour quelque cher absent disent une prière,
Et, s’il tonne trop fort, font à sainte Anne un vœu.
Donc, malgré ce ciel noir qui se teinte de feu,
Ce n’est pas l’ouragan qui trouble le village :
Un enfant rougirait d’avoir peur de l’orage.
XIV. LES PIRATES.
D’où vient donc la terreur qui règne dans Pen-Marc’h?
C’est qu’un homme, plus prompt que la flèche d’un arc,
Surmenant son cheval , qui de sueur ruisselle,
Vient d’apporter au bourg une horrible nouvelle.
—- « Hâtez-vous, criait-il, de fuir vers Pont-l’Abbé,
Avant que le malheur ne soit sur vous tombé.
Hâtez-vous, hâtez-vous ! Sur nous tous la mort plane. »
A ces lugubres cris chacun fuit sa cabane ;
On entoure cet homme, on le force à parler :
—- « Qu’avez-vous donc, Yvon, et qui vous fait trembler?
Un fou peut seul pousser des clameurs aussi folles. »
—- « Oh ! les fous ferment seuls l’oreille à mes paroles.
« Sur la côte, hier soir, ont paru trois vaisseaux,
Dont la proue et la poupe ont de vastes châteaux ;
On n’en saurait douter, ce sont trois nefs de guerre. »
—- « Ces grands naufs de combat ne nous émeuvent guère,
Car monseigneur de France et monseigneur de Blois
En ont fait naviguer sous nos yeux bien des fois. »
—- « Mais à la pavesade ainsi que sur la hune,
D’où descend jusqu’au pont la large voile brune,
On ne voit, et mon œil s’en est bien convaincu,
Ni du Roi ni du Duc briller le noble écu.
Un grand lion d’argent, effrayant de menace,
Sur un fond tout rougi de sang a pris leur place. »
—- « Nous ne comprenons pas ; Yvon, soyez plus clair :
A côté de la foudre allumez donc l’éclair. »
—- « Ces navires, qu’entoure une terreur si grande,
C’est Jeanne de Clisson qui tous trois les commande.
—- « Pour la première fois nous entendons ce nom. »
—- « Vous ne connaissez pas la dame de Clisson ! ! !
Puisse Dieu vous laisser longtemps votre ignorance !
La dame de Clisson prend pour nom : la Vengeance.
» Oh ! vous la connaîtrez bientôt… trop tôt, hélas !
Car, tenez ! ses trois nefs apparaissent là-bas. »
Et cet homme, aux pêcheurs montrant du doigt les vagues,
Leur signalait au loin trois points blancs, encor vagues.
D’autres que des pêcheurs auraient pris ces points blancs
Pour des flocons d’écume ou pour des goëlands ;
Mais aux yeux des marins la distance est sans voiles,
Et tous ont reconnu dans ces trois points trois voiles.
—- « Hâtez-vous, dit Yvon, fuyez vers Pont-l’Abbé,
Avant que le malheur ne soit sur vous tombé.
Hâtez-vous, hâtez-vous ! Sur nous tous la mort plane. »
—- « Expliquez-nous au moins pourquoi fuir votre Jeanne. »
—- « Vous êtes insensés de perdre ainsi le temps.
Ces vaisseaux, que la mer retient là-bas flottants,
Vont, croyez-en Yvon, dès que l’eau sera haute,
Aborder sans retard et piller cette côte. »
—- « Oh ! bien fou qui voudrait aborder à Pen-Marc’h :
L’écueil nous défend mieux que l’arbalète ou l’arc.
Aussi, quand dans nos cœurs faillirait le courage,
Venir nous attaquer, c’est chercher le naufrage. »
« Je ne sais quels sorciers pilotent ces vaisseaux,
Mais la mer n’a pour eux que de faciles eaux.
A travers les rescifs ils trouvent une voie
Et partout d’un vol sûr ils vont saisir leur proie. »
Les femmes, les enfants commençaient à trembler,
Et l’on vit plus d’un front de marin se troubler.
—- « Eh ! qu’est-ce donc enfin que cette châtelaine ?
Quel malheur dans son âme allume tant de haine ? »
—- « Naguère son époux fût, par ordre du Roi,
Mis à mort à Paris, je ne sais trop pourquoi ;
Mais que son trépas fût plus ou moins légitime,
Jeanne s’est fait serment de venger la victime.
» Assemblant des soldats autour d’elle à prix d’or,
Dans plus de dix châteaux elle a porté la mort.
Pour atteindre à coup sûr l’ennemi qu’elle accuse,
A défaut de la force elle employait la ruse :
Mais entrée au château, quel qu’en fût le moyen,
Femmes, enfants, vieillards, elle n’épargnait rien.
» Quand le duc de Bretagne, aidé du roi de France,
L’eut fait par ses soldats traquer à toute outrance,
Et qu’elle ne crut plus pouvoir parer leurs coups,
Rassemblant ses trésors et vendant ses bijoux,
Jeanne alors équipa trois grandes nefs de guerre,
Et, plus terrible encor peut-être que sur terre,
Ravagea sans pitié, de La Rochelle à Caen,
Bien des bourgs sans défense au bord de l’Océan.
» Ah ! depuis les Normands, dont la terrible histoire,
L’hiver, fait au foyer frémir tout l’auditoire,
Jamais aucun forban , jamais aucun Anglais
N’a semé sur ses pas des maux aussi complets.
Ce n’est pas une femme, oh ! non, c’est une hyène.
» Pourtant elle se croit, dit-on, bonne chrétienne :
Quand sa main fait courir la flamme dans les bourgs,
L’église et les moustiers sont épargnés toujours ;
Mais tout le reste, hélas ! n’obtient jamais de grâce.
La ruine et le sang marquent partout sa trace.
» Je n’exagère rien; non, non! J’ai traversé
Un des malheureux bourgs où Jeanne avait passé :
J’ai vu partout des corps d’enfants, de femmes, d’hommes,
Les pommiers abattus encor chargés de pommes,
Les cabanes sans toits, et les riches manoirs
N’offrant plus que des murs ébréchés et tout noirs.
» L’auteur de tous ces maux que j’ose à peine dire,
Cette femme sans cœur, Dieu devrait la maudire :
Eh bien, non ! l’on dirait qu’il veut la protéger,
Car sa main devant elle écarte tout danger.
Non contents de braver l’écueil et la tempête,
Ses vaisseaux se sont fait du combat une fête.
» En vain le roi de France et monseigneur de Blois
Ont voulu mettre un terme à tant d’affreux exploits,
Jeanne esquive leurs coups et se rit de leurs flottes.
Maîtresse de la mer par ses hardis pilotes,
Elle combat ou fuit selon ce qui lui plaît ;
Mais, quand elle combat, le désastre est complet :
Pour complice elle prend le vent, l’écueil ou l’ombre…
Tout vaisseau qu’elle attaque, il faut qu’il brûle ou sombre. »
XV. LA PROCESSION.
Soudain, les yeux hagards et les bras étendus :
—- « Insensés, crie Yvon, oh ! nous sommes perdus !
De nos trop longs discours nous paîrons cher la faute ;
La Torche au loin rugit et la mer devient haute…
Jeanne avance; oui, l’œil peut compter tous ses soldats,
Et vos remparts d’écueils ne vous sauveront pas. »
La marée, en effet, montait, et montait vite.
La vague en grossissant roule et se précipite,
Puis, déchirant ses flancs aux rocs silencieux,
Hurle de sa blessure et bondit vers les cieux.
Mais le rescif soutient une inégale lutte ;
La masse d’eau, qui croît et que rien ne rebute,
S’acharnant sur l’écueil, à chaque instant moins haut,
L’engloutit tout entier sous un dernier assaut :
Quelque bouillonnement signale encor sa place,
Mais l’eau grossit toujours, et la trace s’efface.
La mer a triomphé de tous ces vains efforts
Qui voulaient l’empêcher d’atteindre enfin ses bords ;
Elle a tout couvert, sauf quelque pointe isolée.
Et, dans cette étendue, immense et désolée,
Sur laquelle s’abaisse un ciel devenu noir
Sous l’aile de l’orage encor plus que du soir,
On voit de Jeanne au loin s’avancer les nefs brunes,
Fourmillant de soldats du pont jusques aux hunes.
Dans cet air embrasé le vent ne souffle pas
Et la voile à gros plis fasie autour des mâts ;
Qu’importe, si la mer qui, déjà se fait haute,
Suffit seule à pousser ces nefs jusqu’à la côte.
Les femmes, les enfants, l’œil fixé sur les flots,
Jettent des cris d’effroi mêlés de longs sanglots.
Eux-mêmes, ces marins, vantés pour leur courage,
Qui, vingt fois, sans pâlir ont défié l’orage
Et qui, lorsque l’Anglais sur leurs côtes descend,
De tout se font une arme et n’ont pas peur du sang :
L’épouvante à présent circule dans leurs veines
Et leur projet de lutte expire en clameurs vaines.
Ceux-ci, stupéfiés, regardent l’horizon ;
Ceux-là, d’un bras hâtif dépouillant leur maison,
Jettent sur la charrette, où le tas s’amoncelle,
Le lit et le bahut, le linge et la vaisselle ;
D’autres à leurs enfants prêtent leur dos courbé.
—- « Hâtez-vous, crie Yvon, de fuir vers Pont-l’Abbé.
Hâtez-vous, hâtez-vous ! Sur nous tous la mort plane…
Car près de Kérity voici les nefs de Jeanne ! »
—- « Oh ! non, ne fuyez pas ! Pour fuir, il est trop tard,
A crié d’un ton grave une voix de vieillard.
La châtelaine et ceux qu’à sa suite elle entraîne
Dans ce bourg sans défense assouviraient leur haine
Sur vos femmes, vos fils et ces pauvres aïeuls,
Que votre lâche fuite ici laisserait seuls. »
—- « Eh ! monsieur le recteur, que pouvons-nous donc faire ?
—- « La peur est, mes enfants, mauvaise conseillère ;
Vous-mêmes vous seriez bientôt sans doute atteints,
Et du sang des fuyards vos ajoncs seraient teints.
Confions donc à Dieu le soin de nous défendre.
Yvon, —- à votre insu j’ai pu d’ici l’entendre,
Et votre vieux curé ne tremblait que pour vous,
Yvon n’a-t-il pas dit qu’en vengeant son époux,
Dans les cruels excès où l’emportait sa haine,
La dame de Clisson voulait rester chrétienne ?
Eh bien ! au-devant d’elle allons avec la croix,
Et que Dieu prête force aux accents de nos voix. »
Il s’éloigne, et bientôt le son aigu des cloches
Tinte au-dessus du choc des flots contre les roches
Et des sourds grondements du tonnerre lointain.
Docile à cet appel que lui jette l’airain,
Le peuple de Pen-Marc’h a couru vers l’église,
Qui perce le ciel noir de sa large tour grise.
Tous, même les enfants, oui, tous ces cœurs brisés
Par un élan de foi semblent électrisés :
Le péril qu’ils fuyaient désormais les attire,
Et le trépas n’est plus, pour eux, que le martyre.
Au milieu de l’église, on voit le vieux curé,
Les cheveux blancs couverts du noir bonnet carré ,
Vêtu d’un long surplis , qui flotte sur les hanches,
Et suivi des enfants de chœur en robes blanches :
Un jeune clerc, debout devant eux, tient la croix.
Le recteur, qui déjà priait à basse voix,
Fait un signe ; un pêcheur à la blonde crinière
Va de l’armoire en buis retirer la bannière :
Dans l’ordre accoutumé chacun a pris son rang,
Et le cortège sort de l’église, en chantant.
Derrière lui s’allonge à flots pressés la foule,
Et la procession vers la mer se déroule.
Perçant enfin les murs de sa noire prison,
Le soleil descendait tout rouge à l’horizon
Et colorait au loin, de ses sanglantes flammes,
Les nuages du ciel et la crête des lames,
Des lames qui montaient toujours en grandissant
Et faisaient trembler l’air d’un bruit assourdissant.
Les éclairs commençaient à devenir moins pâles,
Et des vents opposés se heurtaient, par rafales.
Sous ce ciel orageux, sur ce sol désolé,
Où tout, jusqu’à l’ajonc, ne croît qu’étiolé ;
Le long de cette mer toujours blanche d’écume
Et que, même en été, couvre un voile de brume ;
En face de ces nefs que le flux pousse au port
Et qui vont y vomir le pillage et la mort :
Le peuple de Pen-Marc’h, qui lentement défile,
A le même air pieux, le même pas tranquille,
Que lorsqu’en un beau jour, sur les rochers à sec,
Le prêtre va bénir la coupe du varech.
Si parfois le pêcheur, aux cheveux blonds, qui porte
La bannière, la sent trembler dans sa main forte,
Oh ! ce n’est pas l’effroi qui fait mollir ses nerfs,
C’est quelque coup de vent qui passe dans les airs.
Les femmes, les enfants, oubliant leur angoissa
Et confiant leur sort aux saints de la paroisse,
Mêlent leurs douces voix aux voix des matelots
Et font monter au ciel des chants purs de sanglots.
Vainement la rafale et la mer en furie
Opposent leur fracas à ce peuple qui prie ;
Dieu saura distinguer tous ces bruits confondus,
Et les accents du cœur seront seuls entendus.
Mais la procession, qui vers la mer serpente,
Au milieu de la route à l’insensible pente
Voit soudain accourir, sous ses regards surpris,
Une foule affolée et poussant de grands cris.
Du port de Kérity c’est la peuplade en larmes
Qui fuit les nefs de Jeanne et ses soldats en armes :
—- « Les voilà ! les voilà ! Fuyez, s’il en est temps !
Comme leur étendard leurs glaives sont sanglants. »
Dans les rangs qui priaient la terreur se propage :
Chacun tourne le dos à l’odieux rivage ;
Femmes , enfants, marins , le peuple tout entier
Se trouble et de Pen-Marc’h remonte le sentier…
Le vieux curé s’élance et, devançant la foule,
Lui barre le chemin et de l’œil la refoule :
—- « Quiconque porte ici le cœur d’un vrai chrétien,
Qu’il suive cette croix et ne redoute rien. »
Il dit ; toutes terreurs par la foi sont bannies,
Et la foule reprend le chant des litanies.
XVI. L’ÉPÉE ET LA CROIX.
Cependant les vaisseaux par Jeanne commandés,
A travers les écueils habilement guidés
Et se riant du flot qui sous eux se courrouce,
Ont atteint Kérity, grâce au flux qui les pousse.
Chaque nef accostant à la ligne des quais,
Les soldats, glaive en main, sont bientôt débarqués.
Tout le bourg est muet, chaque rue est déserte
Et partout des maisons bâille la porte ouverte ;
Mais sur la route au loin l’oreille entend le bruit
Et des cris et des pas de la foule qui fuit.
— « Puisque sans se lasser Dieu veut que mon bras frappe,
Poursuivons-les, dit Jeanne, et que pas un n’échappe.
Mon cœur frémit d’horreur de verser tant de sang
Et je voudrais au moins épargner l’innocent ;
Mais cet Ange vengeur qui sur moi toujours plane
Au rôle de bourreau, malgré moi, me condamne. »
A sa suite entraînant sa bande de soldats
Et le jeune Olivier, qui ne la quitte pas,
La dame de Clisson, brandissant son épée,
Gravit d’un pas hâtif la voyette escarpée
Qui rejoint le chemin de Pen-Marc’h, d’où parfois
Le vent à son oreille apporte un bruit de voix.
Chose étrange! ces voix, qui semblaient tout à l’heure
Les cris et les sanglots d’une foule qui pleure,
Ont subitement pris un accent solennel,
Et l’on dirait des chants qui montent vers le ciel.
Non, Jeanne est le jouet de rêves fantastiques :
Sur ces bords désolés d’où viendraient ces cantiques ?
Partout où jusqu’ici Jeanne porta ses pas,
Les hommes sanglotaient, mais ils ne chantaient pas.
L’on dit. serait-ce vrai ? que, sur l’horrible plage ,
Les spectres des marins qu’engloutit le naufrage
Reviennent quelquefois, sur deux files rangés.
Criant : « Souvenez-vous des pauvres naufragés. »
Oh ! leurs voix n’auraient pas cette douceur si vague !
C’est le souffle du vent ou le bruit de la vague…
Mais Jeanne fait en vain appel à sa raison ;
Ses nerfs surexcitas vibrent d’émotion
Et son œil anxieux cherche au loin des fantômes,
Car il lui vient toujours, toujours des chants de psaumes ;
Et ces chants, chaque pas semble les rapprocher.
Ecoutez ! On dirait que l’on entend marcher.
Tout à coup le chemin a fait un détour brusque
Et laisse au loin courir les yeux que rien n’offusque.
Le sentier sinueux montre dans ses replis
La bannière, la croix, et le prêtre en surplis,
Et les enfants de chœur, et la masse mouvante
De la procession, qui s’avance et qui chante.
Jeanne et son jeune fils ont tous deux tressailli,
Et d’un secret effroi leur cœur est assailli ;
Mais la peur sur leur front n’a pas osé paraitre,
Et leur âme vaillante est prompte à se remettre.
Jeanne, se retournant, regarde ses soldats :
Ils paraissent surpris, mais ne s’émeuvent pas.
— « Quel étrange pouvoir de la baie où nous sommes !
J’ai cru, dit-elle… Oh ! non, ce ne sont que des hommes.
Au vil Charles de Blois ces hommes sont soumis ;
C’est vous dire, soldats, qu’ils sont nos ennemis.
Puisqu’ils viennent braver ici notre vengeance,
Qu’ils reoivent le prix de leur folle arrogance.
Frappez-les sans pitié, frappez-les sans remord :
Tout partisan de Blois a mérité la mort. »
Les forbans, répondant à ce cri de colère,
Qui réveille en sursaut leur instinct sanguinaire,
Ont tiré leur épée et poussent un cri, tel
Que les oiseaux de mer s’envolent dans le ciel.
Tombant à deux genoux, la foule résignée
Se prépare à mourir… Mais, la face indignée,
Le recteur, arrachant des mains du clerc la croix,
Court à Jeanne et lui dit d’une tonnante voix :
« A genoux, vous aussi, si vous êtes chrétienne !
Quoi ! vous osez parler de vengeance et de haine
Devant le Fils de Dieu mort sur la croix pour vous !
Châtelaine implacable, à genoux ! à genoux !
» Vous qu’on connut jadis si clémente et si bonne,
Priez, priez le Ciel qu’il oublie ou pardonne
Ces scènes de massacre, où vous vous complaisez,
Mais qui feront horreur à vos sens apaisés.
Une aveugle colère aujourd’hui vous emporte
Et vous croyez en vous toute pitié bien morte :
Si violent que fût le feu qui l’entretint,
La plus grande fureur, Madame, un jour s’éteint.
Quand cette passion, par Satan allumée,
Ne vous troublera plus l’âme de sa fumée,
Chaque objet reprendra son vrai jour à vos yeux,
Et vos exploits sanglants vous seront odieux :
Votre remords sera votre enfer qui commence.
« Eh bien ! rachetez-vous par un trait de clémence :
Dieu promet le pardon à qui sait pardonner.
Ces gens que vous voyez à vos pieds frissonner
Et qui vont vous maudire à leur heure dernière,
Au nom de Jésus-Christ faites-leur grâce entière ;
Et nos voix, s’élevant vers le Seigneur pour vous,
Vous aideront peut-être à fléchir son courroux. »
— « Qui donc réclame ici, prêtre, ton indulgence ?
Je ne dois qu’à Dieu seul compte de ma vengeance.
C’est lui, lui qui m’a mis cette épée à la main,
Lui qui dans ma poitrine a fait mon cœur d’airain ;
Et, comme cette mer qui sur ces rocs se brise,
La prière à mes pieds en vains sanglots s’épuise.
La voix du Ciel me parle et livre à mon courroux
Tous les sujets de ceux qui m’ont pris mon époux…
Oui, tous ! Et ne va pas m’accuser d’être injuste ;
Du Juge souverain je suis l’exemple auguste :
Comme Adam nous souilla du vice originel,
Du crime de ses chefs le peuple est criminel.
» Et pourtant, je fais grâce à cette foule en larmes.
» Tes ouailles n’ont rien à craindre de nos armes,
Vieux recteur; si je reste insensible à ta voix,
Je n’égorge jamais ceux qu’abrite la croix.
» Soldats, dans le fourreau remettez votre épée,
Et votre soif d’argent ne sera pas trompée.
Non, vous n’y perdrez rien ; la dame de Clisson
Sur ses propres trésors vous paîra leur rançon. »
XVII.– LA FLOTTE DUCALE.
Autour de Jeanne, hélas! un murmure s’élève ;
Les forbans hésitaient à rengaîner leur glaive.
Si ces hommes sans lois étaient altérés d’or,
L’horrible soif du sang les brûlait plus encor ;
Plusieurs même laissaient, en regardant les femmes,
Briller l’ignoble feu de leurs désirs infâmes…
Et le peuple, par Jeanne un moment rassuré,
Tremblait, et ses terreurs gagnaient le vieux curé.
La crainte de la mort, aisément il l’affronte ;
Mais la mort n’est plus seule : auprès d’elle est la honte!
Et contre le péril qu’il rougit d’entrevoir,
Sa prière vers Dieu monte, mais sans espoir.
Oh! ne vous laissez pas tromper par l’apparence ;
Qui prie a toujours droit de garder l’espérance :
Dieu connaît mieux que nous nos moyens de salut.
Cette fois encor, Dieu sur Satan prévalut.
En voyant mépriser sa voix, la châtelaine
Marche à l’un des soldats, et, calme, mais hautaine :
— « J’aimerais à savoir qui brave ici ma loi,
Dit-elle avec dédain; vieux Bleizvôr, est-ce toi ? »
Le forban interdit cache au fourreau son glaive.
Tous l’imitent en hâte, et de leurs rangs s’élève,
Au choc électrisant de l’admiration,
Un cri d’enthousiasme et de soumission.
Jeanne, sur les bandits reprenant son empire,
Peut d’un mot ou d’un geste à son gré les conduire,
Et, rougissant d’un tort qu’il veut faire oublier,
Le plus rétif devient le plus prompt à plier.
Les soldats sont mêlés à la foule qui tremble,
Et bientôt on les voit causer et rire ensemble.
— « Oh ! dit le vieux curé, vers Jeanne s’avançant,
Nos pleurs, nos pleurs de joie effacent bien du sang.
Votre bras cueille ici sa plus belle victoire :
Pour qui sait mesurer la véritable gloire,
Mieux vaut sauver Pen-Marc’h que détruire Ilium .
» Allons à Kérity chanter le Te Deum :
A nos cris de bonheur et de reconnaissance,
Dieu ne se souviendra que de votre clémence
Et fera refleurir votre antique maison. »
Jeanne n’écoutait pas ; ses yeux à l’horizon,
Où le soleil couché laissait sa rouge trace,
Regardaient huit points noirs grandissant dans l’espace…
Et de ses longs sourcils se heurtait le double arc.
Sur l’ordre du recteur, le peuple de Pen-Marc’h,
S’alignant de nouveau derrière sa bannière
Et remplissant le ciel du chant de sa prière,
Descend, d’un pas prudent et souvent ralenti,
Le sentier raboteux qui mène à Kérity.
La troupe des marins s’est mêlée à la foule,
Et dans un même lit ce double fleuve coule ;
Mais on a beau les voir marcher du même pas,
Le peuple et les forbans ne se confondent pas :
Ainsi la Loire, à l’angle où l’Erdre vient se perdre,
Distingue ses flots verts des eaux noires de l’Erdre.
Jeanne marche à côté du prêtre, mais ses yeux
Fixés sur l’horizon, demeurent soucieux.
Quand ce qu’elle regarde est devenu visible,
Tournant vers le vieillard son visage terrible :
— « Prêtre, je ne veux pas croire à ta trahison,
Sinon je reviendrais t’en demander raison ;
Mais suis mon doigt : là-bas, ne vois-tu pas ces voiles ?
Ce sont huit grands vaisseaux courant à pleines toiles ;
Le vent les pousse à nous avec rapidité.
Ces vaisseaux, quels sont-ils ? Dis-moi la vérité. »
— « Pour mes yeux affaiblis la distance est trop grande ;
Est-ce flotte de guerre, est-ce flotte marchande ?
Surtout, quel est son but? sur ma foi de chrétien,
Madame, je l’ignore et ne devine rien. »
— « Eh bien ! ce but secret, moi je vais te l’apprendre.
On a su qu’à Pen-Marc’h ce soir j’allais descendre,
Et ces vaisseaux, dont trois sont bretons, cinq français,
Viennent de ces écueils barrer tous les accès,
Et, comme des poissons pris au fond d’une nasse,
Ils pensent nous tenir enfin dans cette impasse.
» Pour leur succès, recteur, ne va pas prier Dieu
Car je suis seule encor maîtresse dans ce lieu…
Et contre ma pitié mon vœu faussé proteste ! »
Or, les soldats de Jeanne, ayant suivi son geste,
Avaient, comme elle, vu, sur le flot écumant,
Les huit nefs, dont le mât croît à chaque moment ;
Et leur instinct, trop sûr, à l’instant leur révèle
Les périls que pour eux cette flotte recèle.
Alors, tirant l’épée et poussant de grands cris :
— « Vengeons-nous, disent-ils, car nous sommes trahis. »
La foule, à ces clameurs palpitant d’épouvante,
S’enfuit dans tous les sens ou se presse, tremblante,
Autour du vieux curé, qui, d’un signe éperdu,
Montre à Jeanne le Christ à la croix suspendu.
Dominant de la voix le sourd ressac des vagues,
Jeanne crie : « Aux fourreaux les glaives et les dagues !
J’ai promis de sauver ce peuple du trépas,
Et les dons que j’ai faits, je ne les reprends pas…
Remontez vers Pen-Marc’h, avec votre bannière
Et cette croix, à qui vous devez la lumière. »
Puis, d’une voix plus basse, elle ajoute : « O vieillard,
Partez vite ; pour vous j’ai peur de tout retard.
» Quant à vous, compagnons , je sais votre courage ;
Vous ne craignez pas plus l’ennemi que l’orage :
Ce n’est pas nous ici que menace la mort…
Hâtons-nous seulement de gagner notre bord,
Et si ces huit vaisseaux osent toucher aux nôtres,
Eh bien ! ils sombreront comme ont sombré tant d’autres. »
Les forbans exaltés poussent à l’unisson
Un hourra triomphal pour Jeanne de Clisson ;
Puis rejoignent leurs nefs, dans le port amarrées
Et qui pour le départ sont bientôt préparées.
XVIII. – L’INCENDIE.
La nuit était tombée, et de rares éclairs
Offraient seuls leurs lueurs pour guide sur ces mers ;
Mais, bercés dès l’enfance au milieu de ces passes,
Dont ils sauraient nommer les roches les plus basses,
Les pilotes de Jeanne, au timon attentifs,
Finissent par sortir les trois nefs des rescifs,
Avant que les vaisseaux de Bretagne et de France
Aient pu les y cerner, suivant leur espérance.
Il était temps, grand temps ! oui, car ces huit vaisseaux,
Dont la prudence avait éteint tous les fanaux,
Quand un bleuâtre éclair coupait la voûte bleue,
Apparaissaient tout noirs, à moins d’un quart de lieue.
Profitant de la nuit, Jeanne pousse en avant
Et s’assure bientôt l’avantage du vent.
On lance alors en mer une étroite nacelle,
Où sous l’huile et la poix l’étoupe s’amoncelle ;
Un marin résolu glisse dans ce brûlot,
Puis, s’aidant de la rame, et du vent, et du flot,
Vers la nef amirale en silence le guide
Et l’accroche à ses flancs par un grappin solide.
Il allume la mèche et, dans les flots plongeant,
Revient, inaperçu, vers son bord, en nageant.
Bientôt sur le brûlot, puis sur la nef, éclate
L’incendie, et le ciel noir devient écarlate.
Les marins sur le pont courent épouvantés ;
Pour éteindre le feu mille efforts sont tentés;
Mais le vent sans pitié l’attise et le propage.
Le chef, hurlant d’effroi comme son équipage,
Des sept autres vaisseaux implore le secours.
Tous restent à l’écart… La nef brûle toujours.
Le long de chaque mât et de chaque manœuvre,
La flamme court et siffle, ainsi qu’une couleuvre ;
Elle poursuit partout et mord les matelots,
Qui, les habits en feu, se jettent dans les flots,
Dans les flots où la Mort, qui s’acharne, les noie.
La grande nef n’est plus qu’un brasier qui flamboie.
La mouvante splendeur de l’immense flambeau
Fait saillir sur le ciel un effrayant tableau :
Pour premier plan, la mer, une mer écumante
Sous les souffles du vent, qui se change en tourmente ;
Ici, les hauts rescifs, dont les formes font peur ;
Là, les sept grands vaisseaux, où, frappé de stupeur,
L’équipage, immobile, en silence regarde
La flamme, tour à tour rougeoyante ou blafarde ;
Au fond, les nefs de Jeanne, et les sombres bandits
Applaudissant des mains et poussant de longs cris ;
Puis en face, couverts d’une anxieuse foule,
Les rochers de Pen-Marc’h, où se brise la houle.
C’est affreux, n’est-ce pas? Oh! ce n’est rien encor :
Dieu va de sa colère épuiser le trésor.
SIXIÈME PARTIE : L’EXPIATION
I. LA TEMPÊTE.
NON, marins, Dieu n’est pas l’auteur de votre perte.
Acharnés sur la proie à votre haine offerte,
Vous avez dédaigné ses avertissements,
Et votre expérience, et vos pressentiments ;
Car vous connaissiez bien les signes de l’orage,
Et c’est de parti pris qu’aux risques du naufrage,
Vous avez follement affronté ces écueils,
Dont le nom redoutable évoque tant de deuils.
Eh bien ! il est trop tard pour réparer la faute
Qui poussa vos vaisseaux vers cette horrible côte ;
La mer et les brisants vous ont à leur merci ;
Votre sort, quel qu’il soit, il faut l’attendre ici…
L’heure est suprême : en hâte on amène les voiles
Et, sur tous les vaisseaux, laissés à sec de toiles,
Les châteaux et les mâts dominent seuls le pont ;
Puis, dans l’espoir douteux de trouver un bon fond,
Chaque nef plonge aux flots ses ancres les meilleures.
L’orage, qui planait depuis de longues heures,
Comme pour mieux choisir au loin, du haut des deux,
Les navires qu’il doit foudroyer de ses feux,
L’orage a fait son choix et, dans sa course aveugle,
Semble un taureau blessé qui bondit et qui beugle.
La pluie et les grêlons s’entrechoquent dans l’air
Et le ciel enflammé n’est plus qu’un vaste éclair,
Où le tonnerre roule, entre le double gouffre,
Son bruit de fer qui claque et son odeur de soufre.
La mer, grosse déjà, la mer, se soulevant,
En flots tumultueux s’élance et suit le vent.
Défiant les assauts de leur double colère
Et s’enivrant de bruit comme un coursier de guerre,
Le grand cap de Pen-Marc’h, le Cheval de granit,
Sous l’embrun qui le couvre, avec orgueil hennit,
Et son cri triomphal, que la bourrasque emporte,
Sème au loin la terreur dans l’âme la plus forte …
Grâce aux solides dents de leurs ancres de fer,
Qui trompent les efforts des vents et de la mer,
Les nefs ont tenu bon, et la rafale passe.
Rien n’a souffert à bord, sauf quelque mât qui casse ;
L’espérance est rentrée au cœur des matelots…
Mais tout reste effrayant, et le ciel et les flots.
Cette accalmie, hélas ! n’est qu’une courte trève
Un grain plus violent à l’horizon se lève ;
Le noir tourbillon d’air accourt en tournoyant,
Et la meute des flots le suit en aboyant.
Sur les vaisseaux de Blois, comme sur ceux de Jeanne,
Les marins ont compris que le Ciel les condamne !
Et, tombant à genoux, chacun, pour dernier don,
Demande, non la vie, hélas ! mais le pardon.
Courte fut la prière et courte fut l’attente :
Rien n’a pu résister où passa la tourmente ;
Sous cette masse d’eau, sous cette masse d’air,
Le péril et la mort n’ont duré qu’un éclair.
Les pêcheurs de Pen-Marc’h, dont la foule croissante,
Bravant sur les rochers la vague bondissante,
Immobile d’effroi contemplait, en priant,
La mer qu’illuminait le vaisseau flamboyant.
Les pêcheurs de Pen-Marc’h, lorsqu’éclata l’orage,
Avaient pour la plupart regagné leur village ;
Mais le prudent recteur, dont le cœur généreux
S’élançait au-devant de tous les malheureux,
Retenant près de lui les marins les plus braves :
— « De nos devoirs, dit-il, chrétiens, soyons esclave
Et que la charité nous trouve prêts toujours.
On peut avoir ici besoin de nos secours :
Pendant tout l’ouragan restons donc où nous sommes…
Qu’importe un peu de pluie à qui sauve des hommes ? »
« Oh ! monsieur le recteur, comptez, comptez sur nous ;
Quoi que vous ordonniez, nous obéirons tous. »
Et malgré le tonnerre, et la pluie, et la grêle.
Sous ces éclairs sans fin dont le réseau se mêle,
Au milieu du fracas de la houle et des vents,
Sur ces rocs escarpés que le pied croit mouvants,
Ce groupe de chrétiens, que la pitié rassemble.
Est debout à son poste, et pas un cœur ne tremble…
Ou si quelqu’un a peur, lorsque la foudre a lui,
Vous savez, ô mon Dieu, que ce n’est pas pour lui.
Quand fondit sur les nefs la première rafale,
Comprenant le péril, le curé devint pâle :
— « Prions pour eux, dit-il, car les voilà perdus,
Si du Seigneur nos vœux ne sont pas entendus.
Le calme qui va suivre est un calme perfide :
Ce nuage qui monte au fond du ciel livide,
C’est cet horrible grain que vous connaissez trop.
Devançant l’aigle au vol, le cheval au galop,
Il franchit l’horizon d’un seul coup de son aile,
Et la mort est partout sa compagne fidèle. »
Les pêcheurs regardaient le même coin des cieux
Que le prêtre observait d’un regard anxieux,
Et, voyant accourir la nue aux sombres lignes,
D’un geste involontaire aux nefs faisaient des signes.
Quand soudain sur le sol ils furent renversés,
Au choc impétueux des airs bouleversés.
Un effroyable bruit, le bruit de cent tempêtes,
Passait d’un vol rapide au-dessus de leurs têtes…
L’irrésistible grain ne dura qu’un moment,
Mais le cap frémissait dans son ébranlement.
Lorsqu’enfin les pêcheurs meurtris se relevèrent,
Que sur l’onde et le ciel leurs regards se fixèrent,
Un spectacle nouveau frappa leurs yeux surpris,
Et l’épouvante à tous arracha de grands cris.
Vers Pont-l’Abbé courait un sombre et lourd nuage ;
Mais au-dessus des flots, au-dessus du rivage.
Le ciel avait été nettoyé par le grain
Et les astres brillaient dans son azur serein ;
La mer s’était calmée en partie, et la houle
Commençait d’aplanir son pli qui se déroule…
Mais, hélas ! et voici d’où venaient les terreurs
Qui sur les hauts rochers étreignaient tous les cœurs :
Derrière les écueils, dont les masses muettes
Découpent sur le ciel leurs sombres silhouettes,
Que ne colore plus le grand navire éteint ;
A l’endroit où les nefs dressaient dans le lointain,
Sur le balancement de leurs carènes brunes,
Et leurs doubles châteaux, et leurs mâts, et leurs hunes,
Et de leurs longs haubans le fil aérien,
L’œil s’efforce de voir et n’aperçoit plus rien.
II. LE CONVOI FUNÈBRE.
L’horizon reste vide, oui, complétement vide.
Chacun croit se tromper et, d’un regard avide,
Sur ces vastes déserts, d’un clin d’œil parcourus,
Cherche inutilement les vaisseaux disparus.
Quoi ! Seigneur, devant vous aucun n’a trouvé grâce
Et les dix ont sombré, sans laisser une trace!
Non!… Le vieux curé jette un cri, parti du cœur,
Où perce un peu de joie et beaucoup de terreur.
Son regard , rapproché par hasard du rivage,
Voit entre les rescifs les preuves du naufrage.
C’est un amas confus de planches et de mâts,
De voiles en rouleaux, de quilles en éclats,
Et, parmi ces débris, d’innombrables cadavres,
Ballottés par les flots sur ces plages sans havres.
— « Dieu soit béni ! dit-il, car plus d’un naufragé
A ce désastre affreux peut avoir surnagé.
Que le meilleur coureur d’entre vous nous précède ;
Qu’il aille leur crier qu’on arrive à leur aide.
Suivons-le tous de près… Vous, allez, mes amis,
Réveiller dans le bourg les pêcheurs endormis ;
Qu’ils accourent, pourvus de falots et de corde.
Puis, pour que le Ciel fasse aux morts miséricorde,
Loïc, va dans l’église et fais sonner les glas. »
Et le bon vieux recteur part et marche à grands pas.
Sa charité lui sert de bâton de voyage,
Et le premier de tous il atteint le rivage.
O noble et saint vieillard, que n’ai-je su ton nom,
Pour l’entourer d’amour et d’admiration ?
Mais que te font les prix que ce bas monde donne ?
Ton front désire un nimbe et non une couronne.
Quoique moins fort, l’orage avait recommencé,
Et les rochers, battus par le flot courroucé,
Rendirent aux pêcheurs leurs recherches funèbres
Bien dures, au milieu des épaisses ténèbres.
Pendant toute la nuit, on vit au bord des flots
Des ombres se croiser, qui portaient des falots…
La mer ne lâcha pas une seule victime :
On arracha sans doute aux fureurs de l’abîme,
Au prix de grands périls, des centaines de corps ;
Mais le glas eut raison de sonner pour les morts.
Quand parurent à l’Est les premiers feux de l’aube,
Quand, le jour éclairant ce que la nuit dérobe,
On put compter enfin, sur le sable étendus,
Les cadavres saignants, livides, demi-nus ;
En voyant tous ces corps dont l’orage a pris l’âme,
Le curé dit : « Il manque et l’enfant et la femme !
Mes amis, cette femme hier sauva vos jours,
Et l’enfant est son fils… Cherchons, cherchons toujours.
Puisque leur vie, hélas ! est à jamais éteinte,
Que tous les deux au moins dorment en terre sainte. »
Et le pauvre vieillard, versant des pleurs amers,
Côtoya bien longtemps le flot bruyant des mers,
Cherchant, cherchant toujours et l’enfant et la femme.
Lorsque l’espoir enfin disparut de son âme :
— « Emportons à Pen-Marc’h, dit-il, ces pauvres corps ;
Nous chanterons sur eux la grand’messe des morts ;
Puis , comme par l’orage unis par la prière,
Ils iront reposer dans notre cimetière.
» Mais ici, mes amis, prions, à deux genoux,
Pour la femme au grand cœur qui prit pitié de nous.
S’il faut que l’Océan garde, hélas ! sa dépouille,
Et qu’un impur poisson la dévore et la souille,
Si son corps ne doit pas dormir cnseveli,
Que ses bienfaits du moins échappent à l’oubli.
» Oui, mes enfants, je veux, dans notre pauvre église ;
Je veux faire graver sur une pierre grise,
Pour que nos descendants puissent bénir son nom :
Pen-Marc’h fut épargné par Jeanne de Clisson. »
Et comme il précédait le cortège lugubre
Qui montait vers le bourg, sous l’air vif et salubre,
On le vit s’arrêter brusquement bien des fois,
Et faire, en soupirant, le signe de la croix.
Mais soudain le vieillard se tourna vers les vagues ;
Dans ses regards flottaient des espérances vagues,
Et, murmurant un nom terrible, mais chéri :
« Est-il bien sûr, dit-il, qu’ici tout ait péri ? »
III. LE FIDÈLE KERGOFF.
Non, tout n’a pas péri ! Jeanne est encor vivante :
Un frêle esquif l’emporte au gré de la tourmente.
Lorsque son vieux pilote, habile et dévoué,
Vit tout effort pour fuir par le vent déjoué,
Quand des signes, trop clairs pour qu’il pût les confondre,
Lui montrèrent au ciel l’ouragan près de fondre,
Il s’approcha de Jeanne et, découvrant son front :
— « Madame, à m’effrayer je ne suis pas bien prompt,
Dit-il, mais au Sud-Ouest un mauvais grain s’apprête
Et nous allons avoir une fière tempête.
» Certes, je ne dis pas de mal de vos vaisseaux :
Tous trois se moquent bien de la fureur des eaux ;
Mais leur masse offre au vent une trop large prise…
Et si près des écueils !… j’ai peur qu’on ne s’y brise.
Le vent qui va souffler n’a pas eu son pareil.
» Si vous vouliez, Madame, écouter un conseil…
Je ne suis qu’un vieux fou , mais, tout près de la poupe,
Vous pouvez voir d’ici pendre cette chaloupe.
Eh bien, nous la ferions descendre sur les flots :
On y ferait ranger quatre bons matelots,
Aussi pleins de vigueur que d’adresse et d’audace,
Puis, vous et vos enfants vous y prendriez place.
» Même, si vous vouliez, sans que ce fût trop plein,
On y pourrait encor loger messire Herblain.
La chaloupe est légère et n’a que peu de quille ;
Vous la verriez nager, plus vive qu’une anguille,
A travers ces brisants, qui hurleraient en vain,
Comme un loup affamé qui voit tromper sa faim. »
Jeanne, l’éclair aux yeux, s’écria : « Sur mon âme ?
Ton offre, vieux Kergoff, est un outrage infâme.
Si, comme tu le dis, nos nefs sont en danger,
La faute en est à moi, car c’est pour me venger
Que, marins et soldats, et toi-même, ô pilote,
Vous avez affronté cette fatale côte ;
Et, fuyant lâchement les maux que j’ai causés,
Je vous laisserais seuls à la mort exposés !
Oh ! jamais les Clisson, jamais les Belleville
N’ont souillé leur honneur d’une tache si vile! »
— « Madame, je vous ai voilé la vérité :
Un retard d’un quart d’heure, et le Ciel irrité,
Lâchant enfin la bride à ce grain qui s’apprête,
Vous aura pour toujours coupé toute retraite.
Restez, mais sachez bien que nous sommes perdus. »
— « Eh bien ! dit Olivier, c’est un motif de plus ;
S’il faut que vous mouriez, nous mourrons tous ensemble :
Mets ta main sur mon cœur et tu verras s’il tremble. »
— « Je te bénis, dit Jeanne, avec un court frisson :
Nous mourrons, Olivier, mais dignes des Clisson.
« Tais-toi, Kergoff; ton sort ou propice ou funeste,
Nous le partagerons, quel qu’il soit, car je reste. »
— « Madame, dit Herblain, tombant à ses genoux,
Songez à vos enfants, songez à votre époux.
Votre époux a reçu vos serments de vengeance,
Et vous n’avez rien fait pour laver son offense.
Vous avez au hasard frappé des innocents,
Mais tous ses meurtriers, hors un seul, sont vivants.
» Si vous ne voulez pas l’entendre vous maudire,
Quand vous l’irez rejoindre, il faut pouvoir lui dire :
Ces juges qu’en mourant tu léguas à mes coups,
Tes juges ne sont plus ; je les ai tués tous…
» Et ses fils, qu’il aimait cent fois plus que lui-même,
Qu’absents, il caressa de son regard suprême
Et qui devaient un jour, relevant sa maison,
D’une splendeur plus grande illustrer son vieux nom,
L’espoir qu’il mit en eux n’est donc qu’une chimère ?
Vous allez les livrer à la mort, vous leur mère !
» Aux offres de Kergoff, allons, résignez-vous,
Au nom de vos enfants, au nom de votre époux. »
Des paroles d’Herblain, du vieil Herblain en larmes,
Jeanne semblait subir à son insu les charmes ;
On lisait dans ses yeux son indécision
Et son sein se gonflait sous son émotion.
Mais, levant tout à coup son regard sur l’orage,
La grandeur du péril lui rendit son courage :
— «Vieux Kergoff, vieil Herblain, du fond du cœur, merci !
Ces bonheurs qu’à mes yeux vous faites luire ici,
Mes deux enfants sauvés, ma vengeance assouvie,
Je les achèterais volontiers de ma vie ;
Mais je ne puis aller jusqu’à la lâcheté !
Tout bonheur qui fait honte est trop cher acheté :
Or, mes fils rougiraient de mon présent funeste.
Pour mourir avec vous, s’il faut mourir, je reste. »
La châtelaine à peine avait lancé ces mots,
La rafale passa, bouleversant les flots.
Les trois vaisseaux de Jeanne et ceux qui leur font face
Bondissent sur la mer, mais sans qu’une ancre casse ;
On entend seulement leurs membrures crier,
Et, d’instinct, les marins se sont mis à prier ;
Jeanne embrasse ses fils, doux objets de son culte…
Quand la courte bourrasque eut éteint son tumulte,
Jeanne, élevant la voix, s’écria : « Mes amis,
Notre Dame a reçu les vœux que je lui fis.
Puisqu’elle a loin de nous écarté la tempête,
Ensemble nous irons lui payer notre dette :
Trois vaisseaux, imitant ceux qu’elle a défendus,
Seront à son autel par nos mains suspendus ;
Et de plus, soyez tous témoins de ma promesse.
J’y ferai tous les ans chanter une grand’messe.
» Chassez donc de vos cœurs toute crainte, ô marins :
Nous reprendrons la mer sous des cieux plus sereins,
En bravant ces vaisseaux qui comptent sur leur nombre. »
IV. LA RÉVOLTE.
Kergoff restait plongé dans un silence sombre ;
Regardant tour à tour et le ciel et la mer,
Le vieillard souriait, mais d’un sourire amer.
Des marins réparaient aux mâts quelques désordres ;
Courant vers eux, tout bas il leur donne des ordres.
On descend la chaloupe en hâte sur les flots,
On y glisse un long coffre ; et quatre matelots
Ont sauté dans l’esquif, qui penche et se balance.
Aussitôt trois marins saisissent en silence
Jeanne et ses deux enfants, qui, surpris tous les trois,
Sont descendus, avant de recouvrer la voix.
Tout cela n’a duré que l’espace d’un geste.
Herblain les a suivis d’un pied encore leste,
Et de la châtelaine embrassant les genoux :
— « Oh ! par grâce, Madame, ayez pitié de nous ;
Ne nous maudissez pas de vous avoir sauvée!
A l’horrible tempête au fond du ciel couvée
Et dont le souffle au loin gonfle déjà les eaux,
Kergoff n’a plus l’espoir d’arracher vos vaisseaux ;
Mais cette barque encor peut atteindre la côte…
» Mon dévoûment m’a fait complice de sa faute :
La maison de Clisson doit survivre à tout prix
Et nous vous en avons disputé les débris,
Fidèles jusqu’au bout,… jusqu’au crime peut-être.
Laissez-moi suivre ici les enfants de mon maître.
Lié par mes serments et mon cœur, j’aime mieux
Avec eux le trépas que le salut loin d’eux. »
Jeanne, qui jusqu’alors fronçait ses sourcils mornes,
Émue à ces accents d’un dévoûment sans bornes,
Embrasse ses deux fils pressés dans son giron,
Et jette au vieil Herblain un regard de pardon.
Le fidèle Kergoff, qui, penché sur la poupe,
D’un regard inquiet plongeait dans la chaloupe,
Voyant l’éclair joyeux dont l’œil de Jeanne a lui,
Cria : « N’aurai-je pas mon pardon comme lui ?
J’attends ici la mort, mais, dans mon infortune,
Mon malheur le plus grand serait votre rancune. »
— « Ah ! dit Jeanne, levant ses regards attendris,
De la fidélité vous méritez le prix,
Car vous m’aimez encor quand je vous abandonne.
Mère, je vous bénis, et chef, je vous pardonne :
Oui, votre violence est sainte devant Dieu.
» Si ce Dieu juste et bon daigne exaucer mon vœu,
Le vœu d’un pauvre cœur qui sanglote et qui souffre,
Non, vous ne serez pas englouti dans ce gouffre ;
Mes dons reconnaissants, mes dons dignes d’un roi,
Vous paîront de sauver mes deux fils,… malgré moi. »
— « Madame, j’ai reçu déjà ma récompense.
» Mais la bonace fuit et l’ouragan commence :
A vos rames, marins, et tâchez d’arriver
A l’îlot de Nona , qui peut seul vous sauver.
» Si le beau temps sur nous par hasard vient à poindre,
Demain à Loc-Tudi nous irons vous rejoindre. »
Et cet homme, si grand, si modeste et si bon,
Attend en paix l’orage, une main au timon.
Pour les marins et lui la mort paraît certaine,
Mais il n’est inquiet que pour la châtelaine
Et, suivant son esquif, grâce au navire en feu,
Il lui jette de loin un éternel adieu.
Les quatre matelots qui conduisaient la barque,
Pressés par les périls qu’au ciel leur œil remarque,
Venaient d’atteindre enfin à l’île de Nona,
Quand l’orage attendu sur les vaisseaux tonna.
Au pied des hauts rescifs la chaloupe tapie
Tourna sur elle-même, ainsi qu’une toupie.
Qui, lasse de ronfler, se balance et s’éteint :
Le timonier pourtant d’un bras fort la maintint.
Le tourbillon de vent, dont la colonne torse,
Déchirée à l’écueil, y perdait de sa force,
En mugissant passa; mais au feu des éclairs,
Dont le choc incessant illuminait les airs,
Jeanne vit tournoyer, comme des feuilles sèches,
Et la nef embrasée, aux ardentes flammèches,
Et les vaisseaux de Blois, et ses propres vaisseaux,
Que le vent emportait en courant sur les eaux.
Et tout cela fuyait comme de grandes ombres,
Tout cela se heurtait pêle-mêle aux rocs sombres
Et, bondissant dans l’air, retombait en débris,
Avec un bruit terrible, où perçaient de grands cris.
V. LES DERNIÈRES IMPRÉCATIONS.
Jeanne, en voyant broyer par l’orage en démence
Les trois nefs qui portaient l’espoir de sa vengeance,
En entendant au loin hurler les cris de mort
De ces pauvres soldats attachés à son sort,
Jeanne a senti saigner son cœur qui se déchire,
Et sous son front brûlant bouillonne le délire.
Debout dans la chaloupe et les cheveux épars,
Au milieu des éclairs pleuvant de toutes parts,
Elle tend vers le ciel ses deux mains menaçantes
Et, dominant des vents les clameurs rugissantes :
« Dieu, que tant de douleurs n’ont pas rassasié,
N’es-tu, comme les rois, qu’un tyran sans pitié ?
Je te savais cruel, mais je te croyais juste,
Et je courbais mon front sous ta colère auguste ;
Mais ta colère éclate en jets capricieux
Et ta foudre au hasard tombe du haut des cieux.
» Ces hommes, écrasés comme au pressoir la grappe,
Ces hommes qu’ont-ils fait pour que ta main les frappe :
Si tu venges le sang dont leurs bras sont trempés :
Je te le dis tout haut, tes coups se sont trompés :
C’est moi qui les guidais, moi seule, à ces massacres.
Tes tardives pitiés sont de vains simulacres :
Ils n’étaient que le glaive, et moi j’étais le bras ;
C’est moi qu’il faut punir… Mais tu ne l’oses pas !
Car, tu le sais trop bien, si je tue et me venge,
N’as-tu pas devant moi fait marcher ton Archange ?
Oui, sous l’éclair sanglant de son épée en feu,
J’exécutais ton ordre, impitoyable Dieu…
» Insensée ! oh ! je viens de m’accuser moi-même.
Pardon, Seigneur, pardon pour ma voix qui blasphème !
Car le coup qui m’atteint, je l’ai trop mérité :
Ma faute a mis la foudre à ton bras irrité.
» Quand la mort de Clisson indignait ta justice.
Lorsque tu me chargeas de venger son supplice,
L’Ange exterminateur a reçu mon serment
D’être de ton courroux l’implacable instrument ;
Et ce serment, je l’ai trahi, quand j’ai fait grâce !
» L’outil qui dans la main se révolte, on le casse.
Vous m’avez châtiée et vous avez bien fait,
Puisqu’à vos volontés, Seigneur, j’avais forfait.
» Mais si votre colère est enfin apaisée,
Si j’échappe aux périls où je suis exposée,
Je jure que ma main, désormais sans merci,
Rachètera la faute, hélas! commise ici. »
Et Jeanne, oh! pardonnons à la pauvre insensée!
Par un geste effrayant compléta sa pensée :
On eût dit que son bras et son poignard sanglants
Frappaient une victime et labouraient ses flancs…
Ce feu, que consumait sa propre violence,
S’éteint, et Jeanne alors se rassied en silence.
— « Mère, dit Olivier, en lui baisant la main,
L’espoir et le soleil reparaîtront demain. »
VI. – LE DÉPART POUR LOC-TUDI.
Jeanne reste insensible à cette voix aimée,
Et pourtant la tempête était déjà calmée :
Le choc des flots semblait moins bruyant et moins dur,
Et l’on voyait au ciel de larges pans d’azur.
Profitant du repos des vents et de la lame,
Les marins ont repris le timon et la rame,
Et la barque, cédant aux avirons luisants,
Vers Kérity glissait à travers les brisants,
Quand Herblain se rapproche et dit d’une voix basse :
« Changez de route, enfants, je vous en prie en grâce.
Nous pourrons attérir de tout autre côté,
Mais aller à Pen-Marc’h, c’est de la cruauté.
» Ne voyez-vous donc pas, tout le long du rivage.
Ces horribles témoins de notre affreux naufrage ?
Et, parmi tant de corps flottants, pas un seul cri
Ne nous promet l’espoir de sauver un ami.
» Hâtons-nous donc de fuir, car ma pauvre maîtresse,
Qui succombe déjà sous le poids qui l’oppresse,
S’il lui fallait revoir ses navires broyés
Et heurter son esquif à ses soldats noyés,
Par ce hideux spectacle à jamais poursuivie,
Ma maîtresse y perdrait la raison ou la vie. »
Émus par le discours d’Herblain, les matelots
Laissent leurs avirons suspendus sur les flots ;
Mais, le cœur encor plein d’un reste d’épouvante
Et craignant un troisième assaut de la tourmente,
Leurs yeux et leurs désirs restent tournés au port
Qu’ils sont certains d’atteindre avec un peu d’effort :
Le timonier hésite à détourner la barre.
— « Votre hésitation, dit Herblain, est barbare.
La dame de Clisson, dans son accablement,
Avait droit de compter sur plus de dévoûment
Et ses bontés pour vous sont mal récompensées.
» Je ne sais pas quel est le fond de vos pensées,
Mais, en sacrifiant à la peur le devoir,
Vous pourriez vous leurrer d’un dangereux espoir.
» Oui, si vous succombez à votre lâche envie,
Le trépas vous attend où vous cherchez la vie,
Car les gens de Pen-Marc’h peuvent se souvenir
Du dessein qui chez eux ce soir vous fit venir.
» Ces vaisseaux de leur duc brisés contre la côte,
Et brisés, songez-y ! par votre seule faute,
Ne doivent pas, non plus, rendre leurs coeurs cléments,
Et vous pourriez payer leurs pleurs de vos tourments.
» Gagnons donc Loc-Tudi, qu’il est aisé d’atteindre.
Pour ma maîtresse et vous, là, rien, plus rien ! à craindre ;
Car Jean de Pont-l’Abbé , de qui dépend ce port,
Est parent des Clisson et l’ami des Montfort,
Et, pour ses deux neveux rendus à ses caresses,
Vous pouvez, à bon droit, compter sur ses largesses. »
Les marins, sans répondre, ont repris l’aviron,
Et la barque a tourné sous la main du patron.
Jeanne, toujours assise et la tête courbée,
Dans son noir désespoir est restée absorbée :
L’éclair peut la frapper ou la mer l’engloutir,
Qu’importe ? elle mourrait sans même le sentir.
Son âme est sans organe et ne vit qu’en soi-même.
Elle songe à ses fils, à ses deux fils qu’elle aime,
Et pourtant elle voit d’un œil indifférent
Olivier et Guillaume à ses côtés pleurant.
Si sa main sur leurs fronts se pose et les caresse,
Son cœur ne transmet plus à ses doigts sa tendresse,
Et sa douleur ignore, hélas! l’ardent baiser
Qu’Olivier lui prodigue en vain pour l’apaiser.
Nul n’a donc entendu, dans le douloureux groupe,
Les conseils échangés à bord de la chaloupe ;
Aussi, quand Olivier, au tournant d’un rocher,
Voit s’éloigner le port qu’il a vu s’approcher :
— « Pourquoi donc avons-nous, dit-il, changé de route ?
Attention ! marins; vous vous trompez sans doute. »
— « Notre route est changée, oui, c’est vrai, mon enfant,
Mais c’est sans nous tromper, dit Herblain triomphant :
Dieu relève parfois ceux que sa main châtie !
» Le Sort n’a contre nous gagné qu’une partie :
La revanche , Olivier, dès demain nous attend :
Pont-l’Abbé nous rendra ce que Pen-Marc’h nous prend. »
Aux paroles d’Herblain, Jeanne en sursaut se lève,
Et son œil lance au loin des éclairs, comme un glaive.
— « Aiglons, ouvrez votre aile et prenez votre essor :
Votre aire, ô mes enfants, Dieu vous la garde encor.
» En vain le roi de France a détruit mes armées ;
En vain sur mes trois nefs les eaux se sont fermées ;
En vain tous mes soutiens dorment au fond des flots,
Sauf un pauvre vieillard et quatre matelots ;
En vain la mer peut-être, et les vents, et les astres,
Combinent leurs fureurs pour de nouveaux désastres :
De leurs succès d’un jour mon courage se rit,
Car je marche, Seigneur, où ta main me conduit.
» Tu m’as comme un devoir imposé la vengeance :
Eh bien ! pour l’accomplir, tu me dois la puissance !
J’ignore pour ce but quels sont tes instruments,
Mais quelqu’un doit m’aider à tenir mes serments.
Est-ce mon cousin Jean, Édouard d’Angleterre
Ou Jeanne de Montfort ? Que me fait ce mystère ?
Peu m’importe celui que le Ciel m’enverra :
L’important est qu’il vienne, et je sais qu’il viendra.
» Allons, ô matelots, courbez-vous sur vos rames :
La mer pour vous aider semble aplanir ses lames.
Je paîrai largement votre dernier effort ;
Ramez donc, et bientôt nous serons dans le port. »
Et les marins ramaient, et ramaient avec force.
Autant que le salut, l’or promis les amorce ;
Mais craignant de heurter l’esquif à quelques rocs,
Ils sortent des brisants et, tournant les Étocs ,
Cherchent en pleine mer, pour leur rapide allure,
Une route plus longue, il est vrai, mais plus sûre…
VII. LE COUP DE VENT.
Le ciel est épuré, les astres radieux :
Aussi, la joie au cœur et le sourire aux yeux,
Herblain et les marins, les enfants et leur mère,
Chacun de son espoir caresse la chimère
Et, découvrant au loin le bourg de Loc-Tudi,
Salue avec transport son clocher qui grandit.
Mais le vent qui fraîchit fait une brusque saute…
La rafale en fureur, qui souffle de la côte,
Frappe en cap la chaloupe et la fait se cabrer :
Chacun tombe, en criant, et s’attend à sombrer ;
Grâce à Dieu ! le marin qui gouverne la barre
L’a virée à propos, et la barque se pare.
Tout péril a cessé ; mais le vent est trop fort
Pour qu’on puisse accoster cette nuit dans le port.
Sans tenter un combat superflu, la chaloupe
Prend le lit de la brise et la reçoit en poupe.
Les matelots, serrant l’inutile aviron,
Cherchent à son essor un frein dans le timon :
Rien ne peut ralentir sa fuite échevelée
Et, suivant tous les plis de la vague gonflée,
Elle monte, descend, remonte et redescend,
Mais avance toujours sous le souffle incessant.
Elle court, elle court, comme un cheval sauvage,
Et l’œil n’aperçoit plus ni rochers ni rivage ;
Elle court, elle court, et, dans l’immensité,
Rien ne mesure plus son vol précipité ;
Elle court, elle court et d’espace s’enivre :
Le nuage et l’oiseau ne pourraient pas la suivre ;
Elle court, elle court pendant toute la nuit,
Vers l’horizon sans borne et qui sans cesse fuit.
Un silence profond régnait dans la chaloupe ;
Pressés autour de Jeanne et ne formant qu’un groupe,
Herblain, les deux enfants et les trois matelots
D’un œil morne et pensif regardaient fuir les flots.
Pour briser, s’il se peut, ces fougues débordées,
On a tenté dix fois de courir des bordées ;
Chaque fois que l’esquif a voulu louvoyer.
Les vagues et le vent ont failli le noyer :
A moitié pleine d’eau, la barque sans ressource
A repris forcément son implacable course,
Sur la mer en fureur et sous le ciel serein,
Comme un char emporté par des chevaux sans frein.
Elle court, elle court toujours droit devant elle ;
On dirait qu’à ses flancs la tempête s’attelle,
Et l’écume jaillit sous ses sauts furibonds :
Et les astres du ciel, seuls témoins de ses bonds,
S’attendant à la voir plonger bientôt sous l’onde,
L’accompagnent au loin de leur pitié profonde.
Quand l’horizon rougit aux lueurs du matin,
La bourrasque et la mer s’apaisèrent enfin,
Et le premier rayon du soleil sur la poupe
Ramena l’espérance à bord de la chaloupe.
Chacun, tourné vers l’astre au grand nimbe enflammé,
Qui faisait resplendir au loin le flot calmé,
Fit du fond de son cœur monter une prière
Vers Celui qui créa la vie et la lumière.
Le désastre du soir, les terreurs de la nuit,
On lui pardonne tout, puisque son soleil luit ;
Car l’avenir se rouvre, et chacun dans son âme
De ses secrets désirs tisse à nouveau la trame.
Mais cet involontaire et doux recueillement
Parmi les naufragés n’a duré qu’un moment.
Chacun, interrogeant le ciel et les eaux bleues,
Se demande où l’on est et de combien de lieues,
Dans sa folle fureur, cet ouragan fatal
A pu les écarter du rivage natal ;
L’espoir est-il permis de le voir encor poindre
Et combien faudra-t-il d’heures pour le rejoindre ?
— « Oh! si le temps est beau, répond le timonier,
Deux jours me suffiront pour vous rapatrier.
La brise a venté dur, mais, si je ne me leurre,
Nous n’avons pas filé plus de sept nœuds à l’heure,
Il nous faudra nager un long bout de chemin,
Mais vous avez du nerf, et la barque à ma main
Obéit bien; aussi, que Dieu nous favorise,
Nous pourrons demain soir prier dans une église. »
Et tous bénirent Dieu, car l’homme est ainsi fait,
Que la fin d’un malheur lui paraît un bienfait.
VIII. – DEUX GAIS REPAS SUR MER.
On préparait déjà le départ, quand Guillaume,
A qui seul le sommeil avait versé son baume,
Sous les tièdes baisers du jour s’éveille enfin
Et, frottant ses grands yeux, s’écrie : « Oh ! que j’ai faim !
Ce n’est pas étonnant, n’est-ce pas, ô ma mère ?
Je suis à jeun depuis une journée entière. »
Jeanne à ces mots pâlit ; c’est que Jeanne à ces mots
A dans leur profondeur mesuré tous ses maux.
— « Madame, crie Herblain, oh! nous avons des vivres! »
— « De quel horible poids, ami, tu me délivres!
Je voyais s’avancer, d’un pas lent, mais certain,
Le monstre sans pitié qu’on appelle la Faim. »
— « Ce secours imprévu, c’est Kergoff qui vous l’offre,
Dit le vieil écuyer, en ouvrant le long coffre.
Ah ! vous avez bien fait, quand vous l’avez quitté,
De le louer tout haut de sa fidélité ;
Car Kergoff, mon complice, oh ! le ciel ait son âme!
Nous venge noblement d’un soupçon trop infâme,
En vous sauvant deux fois, sans penser même à lui,
Du naufrage hier soir, de la faim aujourd’hui. »
— « Je croyais ta blessure, Herblain, cicatrisée :
D’un injuste soupçon je me suis accusée ;
Ne m’en veuille donc plus; tu n’en as pas le droit,
Car je t’aime toujours… N’es-tu pas mon bras droit ? »
Et les yeux du vieillard de bonheur semblaient ivres,
Pendant que devant Jeanne il étalait les vivres,
Les vivres que Kergoff, sans prévoir leurs dangers,
Avait d’un soin hâtif dans le coffre rangés…
Ah! s’il eût soupçonné ce que le Sort prépare,
De ces vivres Kergoff eût été moins avare.
Les marins , en voyant s’entasser devant eux
Et ces mets succulents et ces vins généreux,
Dévorent du regard cette abondante proie
Et font retentir l’air des éclats de leur joie :
Leur appétit, dompté par tant d’émotions,
Se réveille et leur fait sentir ses aiguillons.
Jeanne, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes :
— « Bénissons Dieu qui daigne effacer nos alarmes ;
Mais avant de goûter ses dons inespérés,
Prions-le pour celui qui les a préparés. »
Et tous, Herblain surtout, qui malgré lui sanglote,
Recommandent au Ciel l’âme du vieux pilote ;
Mais vous ne fûtes pas oubliés, vous non plus,
O marins dévoués, ô soldats résolus,
Dont les corps ballottés se heurtent à la côte :
C’est pour vous tous qu’ici chacun prie à voix haute.
Ah ! par ce gai soleil rayonnant dans l’azur,
Sous le souffle attiédi de l’air limpide et pur,
Sur cette mer d’argent qui n’a pas une vague,
Mais où flotte un murmure harmonieux et vague.
En face de ces mets dont l’aspect excitant,
Refoulant dans les cœurs tout regret attristant,
Fait d’un sourire heureux briller chaque visage,
N’était-ce pas, ô Jeanne, un sinistre présage,
D’entendre succéder à de joyeux transports
Les lugubres versets des psaumes pour les morts ?
Lorsqu’à tous ces amis que leur prit la tempête
Les compagnons de Jeanne eurent payé leur dette,
La faim reprit ses droits, et je dois dire, hélas !
Que la gaîté bientôt s’assit à leur repas.
Que celui dont le corps n’a jamais dompté l’âme,
Que cet homme orgueilleux les flétrisse d’un blâme ;
Moi, j’ai beaucoup souffert et je sais que parfois
La faim peut étouffer toutes les autres voix :
Je consens à juger les autres sur moi-même,
Et mon vers indulgent n’aura pas d’anathème.
Gai comme ces oiseaux qui, du haut d’un cyprès,
Gazouillent bruyamment près d’un tertre encor frais,
Olivier, oublieux de la douleur récente,
Livre toute son âme à sa joie innocente ;
Et sa mère sourit d’entendre à chaque instant
Les sonores éclairs de son rire éclatant.
Quand la soif et la faim, par l’air vif aiguisées,
Sentirent toutes deux leurs ardeurs apaisées ;
Quand le coffre eut repris le précieux trésor
Des restes du festin, très-abondants encor,
Le timonier joyeux se rassit à la barre :
— « Qu’à la rame à présent, enfants, l’on se prépare ,
Dit-il à deux marins, dont le visage heureux
Promettait au travail quatre bras vigoureux ;
Si nous voulons revoir demain notre Bretagne,
Partons, amis , partons, et Dieu nous accompagne ! »
Et d’une habile main mettant le cap à l’Est,
Il fit courir l’esquif, malgré son pesant lest.
Sous l’encouragement que l’espoir leur prodigue,
Les matelots ramaient sans craindre la fatigue ;
Le troisième marin les aidait tour à tour,
Et l’on nageait encor lorsque tomba le jour.
— « Il ne faut pas, dit Jeanne, épuiser votre force :
Il est temps que la rame avec la main divorce ;
Nous avons à franchir peut-être un long chemin.
Le repos d’aujourd’hui nous servira demain.
Soupons donc, mais tâchons de ménager nos vivres :
Dieu peut tromper l’espoir dont nos âmes sont ivres.
S’il faisait devant nous fuir trop longtemps le port,
Nos vivres épuisés, oh ! ce serait la mort. »
La chaloupe s’arrête, Herblain rouvre le coffre,
Mais tous n’ont dévoré que la part qu’il leur offre ;
Qu’importe ? ils restent gais, car, s’ils jeûnent, l’espoir
Leur dit qu’ils mangeront à leur faim demain soir.
Faisant mât d’une rame et des cabans pour voiles,
Ils reprennent leur route, aux clartés des étoiles,
Car la brise des nuits, qui vient de se lever,
Veut aider l’aviron, ô Jeanne, à te sauver.
De la pitié du Ciel tendre et nouvelle marque !
Le sommeil oublié descendit sur la barque ;
Et, le front sur les bancs, sauf le marin de quart,
Chacun à ses bienfaits prit une large part
Et, se laissant aller à ses douces amorces,
Par des rêves heureux put réparer ses forces.
IX. LE RIVAGE NATAL!
Quand le matin rendit au ciel l’astre du jour,
Un long cri de bonheur salua son retour.
L’air était toujours pur, la mer toujours tranquille,
Mais le vent rendormi fait la voile inutile.
Après avoir, tout haut, dit sa prière à Dieu
Et pour un prompt retour promis un nouveau vœu,
Jeanne fit par Herblain distribuer des vivres.
Hélas ! il en restait à peine quelques livres,
Et chacun, comparant à son vaste appétit
Le morceau qu’il reçut, le trouva bien petit.
Qu’importe ? l’espérance est toujours leur compagne
Et pour la fin du jour leur promet leur Bretagne ;
Aussi, ne pensant plus qu’au rivage où l’on tend,
On reprend l’aviron et l’on part en chantant.
Chacun vers la patrie ayant l’âme tournée,
Nul ne songe à la faim dans toute la journée ;
On ne sent même pas le besoin du repos.
Quand le chant s’interrompt, c’est pour de gais propos :
Aux amis, retrouvés dans un charmant mirage,
On raconte déjà les détails du naufrage ;
Les désastres soufferts sont des titres d’honneur,
Et la douleur s’efface ou se change en bonheur.
Jeanne, Jeanne elle-même, oubliant sa vengeance,
Se laisse sans efforts aller à l’espérance
Et, voyant ses deux fils qui s’amusent entre eux,
D’un geste et d’un sourire encourage leurs jeux.
Mais lorsque le soleil, sur le point de descendre
Sous le vaste Océan qu’on voit partout s’étendre,
Ne montre encore, au lieu du but que l’on poursuit,
Que la mer qui moutonne et l’horizon qui fuit,
Jeanne sent de nouveau l’effroi lui percer l’âme,
Et, poussant un grand cri sous sa poignante lame,
Jette vers le timon un regard effaré :
— « Notre canot, dit-elle, est-il donc égaré ?
Timonier, tu sais bien ton métier, oui, sans doute.
Mais si nous nous étions, grand Dieu ! trompés de route ! »
Le matelot rougit et parut hésitant :
C’est que le même doute était en lui flottant ;
C’est qu’aussi lui fixait son regard sombre et morne
Sur l’immense désert que l’horizon seul borne.
« Non, je crois être sûr, dit-il, de mon chemin,
Mais nous n’arriverons sans doute que demain. »
A l’effroyable aveu caché sous ces paroles,
Tous les cœurs sont saisis des terreurs les plus folles ;
Jeanne, Olivier, Herblain et jusqu’aux matelots,
Chacun se voit errant au hasard sur les flots.
A quoi se retrouver sur ce grand labyrinthe,
Sillonné tant de fois, sans garder nulle empreinte ?
Il y faudra mourir sans espoir de secours,
Car pas un seul navire, hélas ! dans ces deux jours !
Et de la faim chacun, au fond de ses entrailles,
Sent déjà se serrer les horribles tenailles ;
Mais, sachant qu’on n’a plus presque rien à manger,
Chacun se tait, de peur d’aggraver le danger.
Comme un homme, Olivier s’est armé de courage.
Guillaume, insouciant comme on l’est à son âge,
Saute au cou de sa mère et crie : « Oh ! que j’ai faim »
— « Dormez, nous garderons nos vivres pour demain »,
Répond Jeanne à son fils, qu’elle baigne de larmes ;
Puis, faisant un effort pour cacher ses alarmes :
— « Pourquoi nous effrayer, amis, d’un court retard ?
La terre aura demain notre premier regard ;
Oui, mettons à profit la mer qui se fait haute
Et le soleil naissant nous montrera la côte. »
Pendant que Jeanne endort son fils sur son giron,
Les marins ont repris la barre et l’aviron ;
Et, dans leur désespoir retrempant leur courage,
Pendant toute la nuit ils rament avec rage ;
Et, croyant que la mer seconde leurs efforts,
Leurs muscles affaiblis retrouvent leurs ressorts.
La nuit fut sans sommeil; dans leurs horribles rêves,
A peine échangeaient-ils quelques paroles brèves,
Pendant que leurs regards, tendus sur l’horizon,
S’efforçaient d’en percer la fuyante cloison…
Bonheur inespéré ! Notre Dame et sainte Anne
Acceptent donc enfin les vœux que leur fait Jeanne !
Quand l’ombre moins épaisse éclaircit l’Orient
Et qu’on vit s’éveiller l’aube au front souriant,
Dans ces vagues blancheurs, une masse bleuâtre
Découpa sur le ciel son vaste amphithéâtre.
Sous le léger brouillard qui voile ses contours,
On en suit aisément les pics et les détours.
Remerciez donc Dieu ; vos maux sont à leurs terme !
Un nuage n’a pas cette opacité ferme ;
Les yeux des matelots ne s’y sont pas trompés :
Oui, c’est bien la Bretagne et ses bords escarpés !…
Et, dans l’enivrement du cœur qui se dilate,
La joie en vifs transports sur la chaloupe éclate ;
Et Jeanne, sur son sein pressant ses deux enfants,
Les couvre avec fureur de baisers étouffants.
Bientôt sous le brouillard, qui s’élève et qui fume,
La douce vision disparaît dans la brume ;
Mais qu’importe ? on est sûr que la patrie est là :
Pas un front ne pâlit, pas un cœur ne trembla.
— « Sers-nous à déjeuner, Herblain, dit Jeanne heureuse,
Et fais-nous, cette fois, une part plantureuse. »
« Ah ! répondit Herblain, avec un rire amer,
—Chétifs sont les débris du déjeuner d’hier. »
Herblain avait raison et les parts furent maigres;
Mais l’estomac déçu laissa les cœurs allègres,
Et pas un œil ne vit le spectre de la Faim
Accourir, en criant : « Je les tiens donc enfin ! »
La barque avait repris sa marche dans la brume,
Et le flot qui montait les inondait d’écume ;
Mais tous, de la patrie aspirant le parfum,
Bravaient, sans y songer, et la brume et l’embrun.
Tout à coup le soleil, réchauffant l’atmosphère
Et perçant les vapeurs de ses jets de lumière,
Éclaire au loin les eaux que voilait le brouillard.
Et l’horizon désert s’offre seul au regard.
Où donc sont les rochers ? où donc est le rivage ?
La mer, partout la mer !… Ce n’était qu’un nuage !!!
On se lève, on regarde, on retombe atterré,
D’autant plus malheureux qu’on a plus espéré.
X. LA FAIM.
Dans leur noir désespoir, qu’aucun rayon ne coupe,
Les marins ont cessé de guider la chaloupe :
— « A quoi bon s’épuiser en efforts décevants ?
Comptons sur le hasard des vagues ou des vents. »
Jeanne étouffe sa crainte et dit d’une voix haute :
« Amis, le désespoir est toujours une faute,
Car, pour l’homme de cœur prêt à tout affronter,
Il est peu de périls qu’il ne puisse dompter.
» En vous abandonnant à la merci des vagues,
Vous n’avez plus pour vous que des chances bien vagues,
Et contre vous se dresse, imminent et certain,
Le plus cruel des maux, la soif avec la faim.
Avant de lui livrer votre corps… et votre âme,
Luttez en vrais Bretons, et reprenez la rame :
Et Dieu, récompensant un généreux effort,
Peut faire devant vous bientôt surgir le port. »
Les marins, ranimés par sa chaude parole,
Ont regagné leur poste, et la chaloupe vole.
On rame tout le jour, mais, sous les deux déserts,
Toujours le bleu des flots borné du bleu des airs ;
On rame aussi la nuit, mais, quand paraît l’aurore,
Le même espace vague au loin s’étend encore.
Les marins haletants, épuisés, affamés,
S’acharnent au combat contre ces cieux fermés :
Rien ! l’horizon, qui fuit sous leur regard avide,
L’implacable horizon reste serein et vide,
Et les saints invoqués sont tous demeurés sourds.
Combien Jeanne a souffert pendant ces deux longs jours !
Elle ne souffre pas de sa propre misère ;
Son être tout entier n’est plus qu’un cœur de mère :
Elle souffre en ses fils, qu’elle voir dépérir
Et qu’au prix de sa vie elle voudrait nourrir.
Olivier, de ses maux domptant la violence,
De peur de l’affliger, mord ses poings en silence ;
Mais Guillaume, en pleurant, lui répète sans fin :
— « O ma mère, j’ai soif ! ô ma mère, j’ai faim ! »
Et rien pour apaiser cette faim dévorante !
Jeanne ouvre le long coffre, et sa main délirante
Cherche quelques débris des vivres épuisés :
Rien ! rien que des fragments en poussière brisés.
Qu’importe ? son Guillaume’y peut trouver la vie.
Chaque marin y jette un long regard d’envie,
Et Jeanne entend ces mots, qui font couler ses pleurs :
« Elle aurait dû plutôt songer aux travailleurs. »
Ah! si du dévoûment le lien se relâche,
N’accusons que la faim, qui rend féroce et lâche.
Ces miettes n’ont été qu’un court palliatif,
Et bientôt le besoin se réveille plus vif.
Sentant son estomac en feu qui se resserre,
Le pauvre enfant se jette au giron de sa mère,
En répétant encor son déchirant refrain :
« O ma mère, j’ai soif ! ô ma mère, j’ai faim ! »
Jeanne demande au Ciel quelques magiques charmes,
Pour endormir son fils, qu’elle arrose de larmes :
— « Cher enfant, bois mes pleurs, car je n’ose t’offrir
Mon sang pour t’abreuver, ma chair pour te nourrir. »
Oubliant la douleur qui la brûle et l’enfièvre,
Jeanne calme son fils aux baisers de sa lèvre.
Bercé sur ses genoux, l’enfant dort, mais, hélas!
Son sommeil convulsif ne le soulage pas :
L’invisible vautour le poursuit même en songe
Et, d’un bec acéré, dans ses viscères plonge.
O souvenirs poignants du bonheur envolé,
Pourq uoi donc apparaître à ce cœur désolé ?
La malheureuse mère en pleurant se rappelle
Ces jours déjà lointains, ces jours si doux pour elle,
Où ses bras en berceau provoquaient au sommeil
Son enfant bien-aimé… dans ces temps-là vermeil.
Son beau front, qui d’un ange eût excité l’envie,
Sur le sein palpitant qui lui donna la vie
Mollement reposait, comme il repose encor,
Épanchant ses cheveux en longues boucles d’or ;
Mais son visage calme et sa paisible haleine
Attestaient le bonheur dont son âme était pleine :
Il avait l’incarnat de l’aube à l’Orient
Et, quand il s’éveillait, c’était en souriant.
Maintenant la souffrance, en dormant, le dévore
Et, s’il doit s’éveiller, c’est pour souffrir encore…
Et Jeanne avec terreur, Jeanne suit sur ses traits
De l’horrible fléau les horribles progrès.
Sa joue, où la santé fleurissait, si brillante !
Montre, en se décharnant, sa pommette saillante ;
La maigreur a creusé l’orbite de ses yeux ;
Son teint rose a jauni sous des tons bilieux ;
Sa peau, que les baisers trouvaient jadis si fraîche,
Là se colle à ses os, ici pend flasque et sèche ;
Sa respiration s’exhale avec effort
Et son corps a parfois les frissons de la mort.
Jeanne, désespérée et que le doute ronge,
Ne veut dans ces frissons voir que l’effet d’un songe,
Et, mêlant les baisers à de tendres discours
Des rêves de son fils cherche à changer le cours.
Mais le doute bientôt, hélas! n’est plus possible.
Le sang se refroidit ; l’agonie est visible :
Les rayons du soleil, ses baisers acharnés,
Rien ne peut réchauffer ces membres décharnés.
Pauvre ange, Dieu t’attend au céleste royaume.
Non! Jeanne ne veut pas voir mourir son Guillaume ;
L’élevant vers le ciel d’un bras tremblant d’effroi :
— « Ne me le prenez pas, Seigneur, ou tuez-moi. »
Le doux enfant s’éveille et sourit à sa mère,
Puis, sentant de nouveau l’épouvantable serre,
De sa langue séchée il murmure tout bas :
« Pourquoi donc aujourd’hui ne déjeunons-nous pas ? »
Jeanne fait à son fils les plus folles promesses
Et le voit s’assoupir bientôt sous ses caresses.
Ce n’est pas du sommeil, car son œil, éclatant
Dans sa pâle maigreur, s’entrouvre à chaque instant ;
Mais c’est du calme au moins !… Son pouls n’offre, paisible,
Qu’une ondulation molle et presque insensible.
0 mensonge cruel! ce calme inespéré,
C’est la consomption à son dernier degré !
N’ayant pas obtenu l’aliment qu’il réclame,
Le foyer de la vie est désormais sans flamme ;
Si sous la cendre encor fume un reste de feu,
Il va s’éteindre… à moins d’un miracle de Dieu.
Le miracle se fait!… Le sourire à la lèvre :
— « Qu’on est bien, dit l’enfant, sur les bords de la Sèvre !
Quel bonheur de sentir le vent dans mes cheveux !
Que cette eau paraît fraîche et ces fruits savoureux !
O ma mère, merci de ta charmante fête :
Tu me donnes toujours tout ce que je souhaite.
Mais dis-moi donc comment, après ce long festin,
Je crois avoir encor plus de soif et de faim. »
Et l’enfant étreignit de ses deux bras sa mère :
Mais l’étreinte fut courte… et ce fut la dernière.
Les quatre matelots, au travail occupés
Et de leur propre sort surtout préoccupés,
Ont tous quatre assisté, sans le voir, à ce drame ;
Mais deux cœurs ont compris les douleurs de ton âme,
Pauvre femme ! les cœurs d’Herblain et d’Olivier,
Car tous les deux pour toi se sont mis à prier.
Le noble enfant voudrait s’élancer vers sa mère ;
Mais à l’heure maudite où Jeanne désespère,
Le noble enfant comprend que même son baiser
Torturerait sa mère, au lieu de l’apaiser.
XI. – LE CRI DU REPENTIR.
Jeanne, le cœur saignant du malheur qui la navre,
Restait à deux genoux devant le cher cadavre.
Le marbre n’aurait pas plus d’immobilité
Et l’on dirait la mort, sans son sein agité.
A moins de pénétrer du regard sous son crâne,
Nul ne devinerait tout ce que souffre Jeanne.
La faim qui la dévore, elle n’ y songe pas ;
Non, son âme soutient de plus rudes combats.
Scrutant dans leurs motifs les actes de sa vie,
Elle cherche pourquoi le Ciel l’a poursuivie.
Pour être ainsi frappée en tout ce qu’elle aima,
Pour voir le mal sortir du bien qu’elle sema,
Pour porter le malheur à tout ce qu’elle approche,
Quel est donc le forfait que le Ciel lui reproche ?
Soumise aux lois de Dieu qui traçaient son devoir,
Elle y courut partout où son œil crut les voir,
Sans jamais discuter la mesure prescrite…
Pour un crime inconnu sans doute elle est maudite :
Il est temps d’apaiser le céleste courroux.
C’est trop d’avoir livré son fils et son époux :
Elle seule à présent doit expier son crime,
Ou Dieu va réclamer sa dernière victime.
— « Olivier, cher enfant, Olivier, pense à moi,
Car, Olivier, ta mère aujourd’hui meurt pour toi. »
Et Jeanne, obéissant à sa folle pensée,
S’est, par un bond soudain, vers les flots élancée.
Olivier comme Herblain, voyant son air hagard,
Depuis longtemps déjà la suivaient du regard
Et, lisant sur son front quelques desseins funestes,
Surveillaient avec soin le moindre de ses gestes ;
Aussi ses noirs projets se virent déjoués,
Et Jeanne retomba dans leurs bras dévoués.
Olivier, entourant de ses deux bras sa mère,
Lui dit en sanglotant, mais d’une voix amère :
— « Pour vouloir me quitter, vous ne m’aimez donc plus
De vos soins je sais bien pourquoi j’étais exclus,
Et je vous pardonnais d’être toute à mon frère ;
Mais maintenant ton cœur m’appartient, ô ma mère.
Tu n’en peux disposer sans mon consentement.
Et nous avons tous deux à tenir un serment. »
— « Oh ! ne me parle plus de ce serment féroce,
Dit Jeanne avec terreur; notre vengeance atroce,
Voilà ce qui de Dieu nous a fait châtier ;
Oui, c’est là le forfait que je dois expier.
» Vieil Herblain, cher enfant, merci du fond de l’âme
De m’avoir arrachée au suicide infâme :
Ce n’était pas la mort seulement, mais l’enfer.
Toute la vérité m’a lui dans un éclair :
Près de paraître au pied du tribunal suprême,
Je me suis, ô mon Dieu, fait horreur à moi-même.
Comment aller là-haut implorer ta merci,
Moi qu’on trouva toujours impitoyable ici ?
Les cris du sang, du sang des enfants et des femmes !
Montaient vers ta justice et me vouaient aux flammes.
» Oui, lorsque je suivais le spectre au glaive en feu,
J’avais pris un démon pour l’Archange de Dieu.
Son faux raisonnement m’enlaçait dans ses mailles ;
Mais aujourd’hui mon œil voit tomber ses écailles :
Je comprends maintenant le véritable honneur.
La vengeance, ô mon fils, n’appartient qu’au Seigneur,
Puisque le Seigneur seul est certain d’être juste.
» Le curé de Pen-Marc’h, ce prêtre au front auguste,
M’a dit avec raison — et bien des fois déjà,
O sang que j’ai versé, son arrêt te vengea :
Quand votre passion, par Satan allumée,
Ne vous troublera plus l’âme de sa fumée,
Chaque objet reprendra son vrai jour à vos yeux,
Et vos exploits sanglants vous seront odieux.
» Oui, monstrueux forfaits, oui, vous m’êtes en haine
Et mon pied se fatigue à traîner votre chaîne !
» Jure-moi donc, mon fils, de m’aider désormais
A guérir, s’il se peut, tous les maux que j’ai faits.
Remettons au fourreau le glaive et la colère. »
— « J’ai juré votre mort, assassins de mon père ;
Assassins, vous mourrez, vous mourrez de mon bras :
Olivier de Clisson ne vous pardonne pas.
J’admire la pitié, mais au cœur d’une femme…
Pour racheter sa vie ou pour sauver son âme,
Où qu’il soit, quel qu’il soit, jamais Clisson ne ment :
Donc, puisque j’ai juré, je tiendrai mon serment.
» Mais, en poursuivant seul jusqu’au bout ma vengeance
J’aurai devant les yeux tes conseils de clémence :
Ton fils écoutera, mère, je le promets,
La justice toujours. mais la pitié, jamais
— « Que Dieu seul, ô mon fils, que Dieu seul soit ton juge ;
Mais moi, dans le pardon je cherche mon refuge ;
Et puisse le Seigneur, touché de mon remord,
Oublier mes forfaits et te conduire au port ! »
Et debout, le front haut, la grande châtelaine,
Toute pâle de faim, mais l’âme enfin sereine,
Dans cet immense temple au vaste dôme bleu,
Fit lentement monter ce cantique vers Dieu :
« Béni soit le Seigneur dont la main m’a frappée !
C’est dans mon châtiment que sa clémence a lui.
Plus cruel qu’une hyène à sa cage échappée,
Mon courroux bondissait, brisant tout devant lui.
» Ma face était pour tous un objet d’épouvante,
Et les mères tremblaient en entendant mon nom ;
Car j’étais la Vengeance, incarnée et vivante,
Et, quand on m’implorait, je disais toujours non.
» Mon Dieu n’a pas voulu que je fusse maudite :
Il a lancé sa foudre, et mon courroux n’est plus
Je puis enfin prier, et l’ange qui me quitte
M’attend près de son père au séjour des élus.
» Oh! ce n’est pas la peur, Seigneur, qui m’a domptée
Et qui brise en mes mains les serments que je fis.
Seule en proie à la mort, je l’aurais affrontée,
Mais j’ai voulu sauver le dernier de mes fils.
» Aveugle que j’étais ! veuve, j’ai fait des veuves,
Et, mère, des enfants sont tombés sous mes coups !
De mes longues fureurs j’effacerai les preuves ;
Mes bienfaits passeront où passa mon courroux.
» Des vapeurs de l’enfer j’étais enveloppée,
Mais le souffle d’en haut les dissipe aujourd’hui :
Béni soit le Seigneur dont la main m’a frappée,
Car c’est en me frappant qu’il me rappelle à lui. »
XII. UN HORRIBLE PROJET.
Les marins, fascinés par ces scènes sublimes,
Qui d’un monde inconnu leur découvraient les cimes,
Sentaient leur dévoûment refleurir dans leur sein,
Et leur âme oubliait que leur corps avait faim ;
Mais lorsque reparut le silence morose,
Quand devant son fils mort Jeanne eut repris sa pose,
Le désespoir revint glacer les naufragés…
Et l’aviron glissa des bras découragés.
Las de sonder en vain l’abîme de l’espace
Et n’y trouvant toujours que la même menace,
Leur malheur retomba sur eux de tout son poids
Et l’égoïsme seul fit entendre sa voix.
Laissant donc le hasard maître de la chaloupe,
Tous les quatre à l’arrière ils s’assirent en groupe
Et, livrés tous les quatre aux horreurs de la faim,
Ils cherchèrent entre eux comment y mettre fin.
Je ne sais quel projet traversa leur pensée,
Et la terreur d’Herblain fut peut-être insensée ;
Mais Herblain crut parfois les voir, d’un œil hagard,
Jeter sur Olivier un oblique regard,
Et surprit ce propos, dont le sens était vague,
Mais qui lui fit porter sa main droite à sa dague :
« Dieu nous pardonnerait, car nous mourons de faim ;
Toutefois, attendons encor jusqu’à demain. »
Soudain le timonier s’écrie : « Amis, courage !
Sous le soleil couchant voyez-vous ce nuage ?
Il nous annonce enfin de la pluie et du vent.
Si dans mon vieux métier tout n’est pas décevant,
Ce grain doit nous pousser sûrement à la côte.
La tempête envers nous veut réparer sa faute. »
Le marin ne s’est pas trompé dans son espoir :
La mer se fait houleuse et le ciel devient noir.
On installe une voile en hâte à la chaloupe
Et le vent, qui mugit, bientôt la pousse en poupe.
Comme dans cette nuit, payée, hélas ! si cher,
Elle court, elle court, sous la foudre et l’éclair,
Elle court, elle court, sous la grêle et la pluie,
Elle court, elle court, mais c’est vers la patrie
Cette pluie abondante est, d’ailleurs, un bienfait :
La soif a disparu, la faim même se tait
Et, si quelques douleurs restent inconsolées,
La haine et la discorde au moins sont envolées.
Le tonnerre gronda pendant toute la nuit ;
Mais devant le matin la tempête s’enfuit.
Hélas ! sous le brouillard dont s’est couverte l’aube
Aux regards des marins l’horizon se dérobe.
Personne n’ose plus se livrer à l’espoir…
Et le vieil Herblain songe aux complots d’hier soir.
Se croyant désormais assuré de sa proie,
Le spectre de la Faim pousse un long cri de joie…
Sous les contractions de sa griffe de fer,
Chacun des naufragés sent se tordre sa chair.
Mais bientôt le soleil, dont le disque s’allume,
Fait en molle fumée évanouir la brume
Et, d’un rayon oblique éclairant l’horizon,
Empourpre les blancheurs du rivage breton.
Plus de doute aujourd’hui : ce n’est plus un nuage !
La mer en écumant déferle sur la plage.
Salut à la Bretagne ! oh ! je la reconnais,
Et cette large rade est le port de Morlaix
Le spectre de la Faim, comprenant sa défaite,
S’envole, et tous les cœurs chantent leurs chants de fête.
Tous les cœurs ! oh ! non; Jeanne, hélas ! songe à celui
Qu’Hier a fait mourir, qu’eût fait vivre Aujourd’hui.
Le but est encor loin, mais, quand tout rit dans l’âme,
Le bras avec vigueur sait manier la rame.
On avance j on avance ; et les gais matelots
Ont vu sortir du port quatre élégants canots :
Chacun porte un pennon que décore l’hermine.
C’est Jeanne de Montfort, ma future héroïne !
Qui, trompant les soucis d’un austère destin
Et voulant savourer les charmes du matin,
Vient du jour renaissant admirer le spectacle.
Voyant son Olivier sauvé, par un miracle,
Jeanne pousse un grand cri, qui retentit là-bas…
Puis tombe évanouie, en étendant les bras.
Cet héroïque cœur, qu’aucun malheur ne ploie,
Ce cœur tout maternel s’est brisé sous sa joie.
XIII. LES CONSOLATIONS.
Quand de son long sommeil Jeanne à la fin sortit,
Deux beaux enfants causaient tout bas près de son lit,
Et Jeanne de Montfort, se penchant sur sa couche,
La contemplait, debout, le sourire à la bouche,
Et, lui serrant la main, disait avec douceur :
« Je vous consolerai de vos maux, ô ma sœur.
Votre fils est le mien ; mon fils sera le vôtre…
Et souvent, bien souvent! nous parlerons de l’autre. »
A LA BRETAGNE
Ce long poëme sombre, où coule à flots l’angoisse,
Où l’âme à chaque vers se déchire ou se froisse,
Mais qui se couche enfin dans le calme et l’espoir,
Comme un jour orageux que termine un beau soir,
Je t’offre ce poëme, ô Bretagne adorée :
Je l’écrivis pour toi d’une plume enfiévrée.
L’amitié lui promit qu’il serait ton orgueil ;
Il ne vaut et ne veut qu’un sympathique accueil.
Qu’il l’obtienne, et ma Muse, o ma vieille patrie,
Suivant de loin les pas de l’auteur de MARIE,
Te paîra ton sourire en chantant tes splendeurs,
Noble peuple, illustré par toutes les grandeurs.
NOTES.
Nous croyons avoir consulté à peu près tout ce qui a été écrit sur l’enfance d’Olivier de Clisson; mais, avant d’aborder cette trop longue série de notes, nous nous faisons un devoir de déclarer que l’idée et le plan de notre poëme nous ont été inspirés par l’excellent article que notre savant collègue et ami, M. P. LEVOT, a consacré au connétable dans la Biographie bretonne, tome I, pages 360 à 376.
69 P. 203. « Olivier I » fit enfermer la ville [de Clisson] de murailles. »– OGÉE,I,2I5.
LISTE DES SOUSCRIPTEURS.
La Mairie de Nantes. (6 ex.) La Société Académique de la Loire-Inférieure. (2 ex.) La Bibliothèque de la ville de Nantes.
Le Club du Sport.
Le Cercle Graslin.
Le Cercle du Château.
Le Cercle des Beaux-Arts.
MM.
Joseph Rousse, avocat.
Adolphe Grimaud, à Luçon.
Léon Grimaud, médecin de la Marine, à Brest.
Alfred Lallié, avocat.
Edmond Biré.
Charles Robinot-Bertrand, avocat.
Eugène de la Gournerie.
Mlle Amélie Hubans, professeur.
Mlle de Saint-Aignan.
Prosper Grolleau.
De la Ganry, à Saint-Aignan.
Arthur de la Borderie, à Vitré. (2 ex.)
Charles de Keranflec’h.
Arthur de Biré, directeur du télégraphe, à Beauvais.
Joseph Martineau, notaire.
Jules Forest.
Emmanuel Phelippes-Beaulieux, avocat.
Cie A. de Bremond d’Ars.
Vte Édouard Sioc’han de Kersabiec.
Charles Marionneau.
Abbé Hippolyte Rivalland.
B. Huë, conseiller à la Cour de Rennes.
Charles Bougouin fils.
Abbé François Baudry, vicaire à Chavagnes-en-Paillers.
De Kéridec, ancien représentant, à Hennebont.
Gaultier du Mottay, à Plérin.
Henri Chartier.
Francis Rousselot.
Bon de Wismes.
Marie, receveur principal des postes.
Gellusseau, docteur-médecin.
Donatien Cox.
Abbé Richard, vicaire général.
De Rostaing de Rivas, docteur-médecin.
Mériadec Laënnec.
Émerand de la Rochette.
Vte de la Roche-Saint-André, au château de la Forêt (Vendée).
Stanislas Loiret.
Morel-, tailleur, à Brest.
J.-M. Pitel, professeur.
Henri de Cornulier.
Charles du Chalard, ingénieur de la Marine.
Arthur de l’Isle.
Petitpas, libraire (12 ex.) A. Mahot, docteur-médecin.
A. du Ponceau.
Bellamy, notaire, à Brest.
A. de Mansigny, à Guérande.
Hippolyte Thibeaud père, avocat.
Bon de Girardot, secrétaire général de la Préfecture.
Olivier Merson , à Paris.
P.-J. Garreau. Charpentier, imprimeur.
Biou, juge de paix.
Carissan, juge de paix.
Édouard Dufour, conservateur-adjoint du Muséum.
Pinson, agent-voyer.
Henry Noury.
H. Bruneteau, avocat, conseiller-général.
J. Ioux, arbitre de commerce.
Amédée Gallet.
Alphonse Tigé, docteur-médecin.
Emmanuel Halgan, avocat.
Libaros, libraire. ( 12 ex.)
Ch. Besnard de la Giraudais , avocat, conseiller général. (2 ex.)
Hippolyte de Lorgeril, à Lorgeril (Côtes-du-Nord).
Duvacher, chef d’institution.
Louis Duchemin.
Phelippes-Beaulieux père.
Bon de la Tour du Pin. (2 ex.)
Waldek-Rousseau, avocat, conseiller municipal.
A. Foulon.
Joseph Foulon, docteur-médecin.
Gabriel Gallerand , proviseur du Lycée.
Lechalas, ingénieur en chef des ponts et chaussées.
Ad. Giraudeau, avocat.
Claude de Monti de Rezé, au Fief-Milon (Vendée).
Abbé Charles Lebrun, curé de Sainte-Croix.
Abbé Guilloux, vicaire de Sainte-Croix.
A. Legendre, architecte.
Chotard, professeur à la Faculté des Lettres, à Besançon.
Emile Gautier, receveur des Hospices.
Anthime Ménard, avocat.
P. Levot, à Brest.
Le Guilloux-Pénanros, juge, à Brest.
J. Copillet, à Brest.
Héliès, à Rochefort-sur-Mer.
De Grand pont, à Brest.
Oscar Michel, à Brest.
E. Michel, à Brest.
Cte Ch. de Rossi, à Brest.
Louis des Dorides.
Édouard de Monti, comte de Rezé.
Henri Guiziou, à Brest.
Marquis de Régnon, à Saint-Herblain.
Josso, contrôleur des Douanes.
Delétang, notaire honoraire.
Joüon, notaire. (2 ex.)
Le Sant, architecte.
F. Guignard.
Frédéric Cailliaud, conservateur du Muséum.
Pichelin, avocat.
De Mieulle, receveur général.
Oudiette, ancien notaire, à Guérande.
Henri de Pontbriant, à Châteaubriant.
Lavolenne, à Rosnay (Vendée).
Ludovic de Becdelièvre.
Dorn, président du Tribunal, à Châteaubriant.
Blain, professeur d’histoire au Lycée.
Ernest Ménard.
A. Gautté, avocat.
A. Decroix, conseiller général.
Stanislas Prévost.
Cte Gabriel de Lambilly, au château de Montebise (Seine-et-Marne).
Vte R. de Lambilly.
A.-F. Duboscq aîné, géomètre.
Hyrvoix.
Gouézou, peintre.
Verger.
Abbé Fournier, curé de Saint-Nicolas.
Abbé Papin, vicaire de Saint-Nicolas.
E. Livet, chef d’institution.
Vte Victor Lanjuinais, député au Corps législatif. (2 ex.)
Brunellière frères, libraires. (2 ex.)
Auguste Garnier.
Saint-Léger.
Blanchard-Mervau, avocat.
Abbé Cahour, chanoine honoraire, aumônier du Lycée.
Évariste Simon, architecte.
Pontonnier.
Colombel, avocat.
Ed. André.
Eudel.
G. Goullin, vice-consul de Belgique.
Raby du Vernay, bibliothécaire à Indret.
C. Thoinnet de la Turmelière, député au Corps législatif. (2 ex.)
Célestin Pavec, avocat, à Savenay.
Jules Lafont.
Cœuret, juge au Tribunal civil.
Antonio Carré.
Ed. Lorieux, commissaire-priseur.
Athénas, économe de l’hospice général de Saint-Jacques.
Édouard Derrien, à Chantenay.
A. Guépin, docteur-médecin, conseiller-général.
Callaud, horloger.
Ad. Lathébeaudière, juge de paix.
Georges Maublanc, avocat.
A.Mervau , à Saint-Gilles-sur-Vie. (3 ex.)
Louis Couprie, avocat.
Prosper Roy, conseiller-général.
Abbé Gautier, aumônier de Grand-Jouan.
W. Leveling.
Stéphane Halgan.
J. Lloyd.
G. Demangeat fils.
Élie Remignard, arbitre de commerce.
Léonce Biré, notaire, à Saint-Denis-la-Chevasse (Vendée).
Binard-Gabillard, receveur des domaines, à Pont-Rousseau.
Demance , professeur au Lycée.
André, directeur de l’Ecole professionnelle.
Abbé Jubineau, supérieur des missionnaires diocésains.
Félix Thomas, architecte et peintre.
Jean Maisonneuve , à Saint-Herblain.
P.-B. Goullin, ancien président du Tribunal et de la Chambre de commerce de Nantes.
Lame, inspecteur d’Académie.
Pasco, agent-comptable de la Marine.
Bouyer, professeur de mathématiques.
Ch. de Raymond, architecte.
Alexandre de Couffon, à la Cossonnière (Loire-Inférieure).
Louis Linyer, avocat.
Théophile Laënnec, docteur-médecin.
Fontan, chef de la manutention de la Marine.
Auguste Perraudeau, architecte.
Minard, organiste.
Benjamin Martineau, avoué.
François Verger, à Paris.
Léon Bureau.
Édouard Bureau, docteur-médecin, à Paris.
Gatineau, secrétaire-général de la Mairie.
Devillaire, professeur.
Abbé Héron, directeur du pensionnat Saint-Stanislas.
Benjamin Fillon, à Fontenay-le-Comte.
Dugast-Matifeux.
Paul Nau, architecte.
Pitre Figat, négociant.
Clémenson fils.
Méresse, à Guérande.
Halgan père.
Paul Anizon, docteur-médecin.
Boisguimard.
A. Guillet, pharmacien, à Clisson.
R. Fabré, ancien notaire.
Mme Groult.
Letenneur, docteur-médecin.
F. Parenteau, conservateur du Musée archéologique.
Gustave Cholet, avoué.
Auguste Laurant.
Alexandre Perthuis-Laurant.
Hippolyte Thibeaud fils, avocat.
Charles Brossard.
Le Houx, docteur-médecin.
Cte Fernand de Bouillé.
De Casenove, père.
Général Mellinet, à Paris.
Abbé A. Ollivier, professeur de philosophie, à l’Externat des Enfants-Nantais.
Mlle Priet, à la Villa-Maria.
Henri Maisonneuve, avocat.
Ernest Genevois, avocat.
P.-E. Berthault, avocat, adjoint au maire de Nantes.
Talvande, avocat.
Guibourd, avocat.
Labruyère, avoué.
Le Romain, avocat.
A.Barbe-Mintière, avoué, à Rennes. (2 ex.)
Edmond Doré.
Mlle Marie Gaulois.
Édouard Gallet, receveur des douanes, à la Barre-de-Monts (Vendée).
Auguste Crucy.
Ambroise Viaud-Grand-Marais, docteur-médecin.
Mlle du Chesnay.
Louis Moreau, homme de lettres, à Brest.
Méchineau, docteur-médecin, à Clisson.
L.-Albert Bourgault-Ducoudray.
Abbé Guillotin de Corson, vicaire à Noé-Blanche (Ille-et-Vilaine).
Guilley, conseiller municipal, président du cercle des Beaux-Arts.
A. Coquebert de Neuville, avocat.
R. Bernard.
Ch. Anthus.
Paul de la Bigne Villeneuve, rédacteur du Journal de Rennes.
B. Vaurigaud, pasteur de l’Église protestante.
De Veillechèze, chef de cabinet du préfet de la Loire-Inférieure.
ERRATA.
TOME I, cinq ff au lieu de ff se sont glissés dans les deux pre-* mières feuilles.
Pages 122, 138 et 142, lisez infamante au lieu d’infâmante.
Page i3o, vers 11, au lieu de chevaliers, lisez cavaliers.
Page 162 , vers 7, mettez un point à la fin du vers.
Page 172 , vers g, au lieu de Ouand, lisez Quand.
TOME II, page 16, vers 6, lisez vieux au lieu de rieux.
Page 3o, vers 18, on dit au lieu de ondit.
Page 118, vers 17, lisez sa vie à ma vengeance, au lieu de ma vie à sa vengeance.
Page i32, vers 1 i, fut au lieu de fût.
Page 165, mettez, à la fin ers 19, une virgule au lieu d’un point. , p ;s.
Page 206, vers i5, l/s baisers au ses baisers.
t – 1″
________________________________________
TABLE
________________________________________
________________________________________
TABLE.
QUA TRIÈME PARTIE.
LE SERMENT.
Pages.
I. La Sèvre nantaise. 3 II. Le Repas champêtre 9 III. Les Rencontres de nuit. 14 IV. L’Arrivée à Nantes. 19 V. Les Douves Saint-Nicolas 2 3 VI. La Porte Sauvetuur. 29 VII. La Malédiction. 36 VIII. L’Appel à la Vengeance 4: IX. Les Confidences dangereuses 49
________________________________________
CINQUIÈME PARTIE.
LA VENGEANCE.
Pages.
I. Château- Tlzébaud. 61 ‘Surprise. 67 III. Le Galois de la Heuse. 72 IV. Le Fléau de Dieu. , 79 V. Péan de Malestroit. 86 VI. L’Évasion. 91 VII. Le Château de Touffou. q5 VIII. L’Embuscade. 100 IX. Une Apparition. io3 X. Les Deux Amis. 107 XI. Un Arrêt posthume 112 XII. Les Routiers en gaieté. 119 XIII. Pen-Marc h 126 XIV. Les Pirates. , 129 XV. La Procession 13 5 XVI. L’Épée et la Croix. , , 142 XVII. La Flotte ducale. , ,. 148 XVIII. L’Incendie. 153
________________________________________
SIXIÈME PARTIE.
L’EXPIATION.
Pages.
1. La Tempête. 159 II. Le Convoi funèbre., 165 III. Le Fidèle Kergoff. 169 IV. La Révolte. 174 V. Les Dernières imprécations. 178 VI. Le Départ pour Loc- Tudi. 18 1 VII. Le Coup de vent. 186 VIII. Deux Gais Repas sur mer. 190 IX. Le Rivage natal. 196 X. La Faim. , 202 XI. Le Cri du Repentir. 208 XII. Un Horrible Projet 214 XIII. Les Consolations. 219 A la Bretagne. 220
.-‘ r ,. »Notes.,, {. 221 Liste.: des Souscripteurs^ A 231 1 _: Il =:::’-
NANTES, n^PRIMp^ VINCENT FOREST ET EMILE GRIMAUD.
: DU MÊME AUTEUR :
OLIVIER DE CLISSON Chanson de geste (suite).
Poëmes en préparation:
1. JEANNE LA FLAMME, COMTESSE Du MONTFORT.. (2 vol.) II. Du GUESCLIN ET CLISSO::-l. (1 vol.)
2. III. LE CONNÉTABLE DE FRANCE (1 vol.)
3. IV. LE CHATEAU DE L’HERMINE. (1 vol.)
4. V. PIERRE DE CRAON (1 vol.)
MARGUERITE DE CLISSON (Épilogue). (1 vol.)