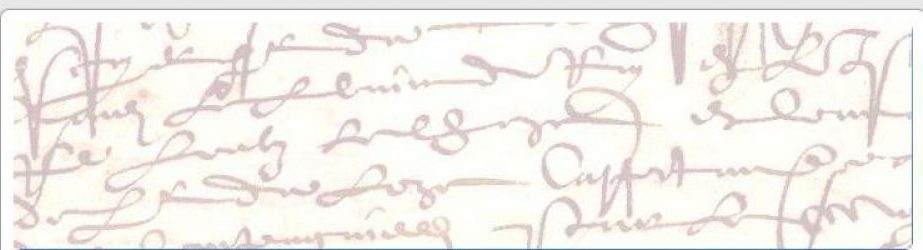Le document qui suit semble tout au moins aller en ce sens.
Cependant, j’ai en Loire-Atlantique, qui relevait alors du duché de Bretagne et de son droit coutumier, une mienne ancêtre qui se remarie 62 jours après le veuvage. Et je me suis toujours posée des questions sur ce curieux délai, manifestement accepté par l’église, mais sans doute pas par les droits humains de la coutume du douaire. Dois-je en conclure que mon ancêtre n’avait pas grand chose à attendre du douaire ?
L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne – Voici ma frappe de ce Mémoire imprimé : Pour Mathurin et Françoise Quehery, demandeurs en péremption d’instance, et intimés.
Contre Françoise Salmon, veuve de Pierre Chatizel, vitrier à Laval, déffenderesse et appelante
Il s’agit principalement icy d’une péremption d’instance, quoique la veuve Chatizel ait voulu, sans raison, faire plaider son appel.
Le 10 avril 1686, Mathurin Quehery laissa en mourant les demandeurs en très bas âge ; et l’appelante sa veuve dans le dessein de jouïr de la liberté qu lui donnoit son veuvage, elle accepta la tutelle naturelle de ses enfants ; mais au lieu de prendre soin de leur éducation, elle eut un commerce criminel et preque public avec un cousin germain de son défunt mari. Le bruit s’étant répandu dans la ville de Laval qu’elle estoit grosse, Mathurin Quehery ayeul paternel des demandeurs, présenta requeste au juge pour la faire destituer de la tutelle des enfants, et déclarer indigne du douaire, attendu son incontinence pendant l’année du deuil. Sur cette demande les parents tant paternels que maternels ayant esté appelés, on luy osta la tutelle de ses enfants ; on nomma l’ayeul paternel pour curateur universel en sa place ; et on ordonna de l’avis de toute la famille, qu’il poursuivrait les demandes qu’il avait intentées conte l’appelante.
Le 9 août 1687, intervint une seconde sentence qui permit d’informer, par enqueste, de sa débauche, et même de la faire visiter. Mais comme cette visite aurait fait une conviction parfaite, elle quitta la ville de Laval pour l’éviter, et se retira dans le village de Saint Denis d’Orque, où elle accoucha le 13 septembre 1687 d’une fille qu’elle fit baptiser sous des noms supposés. Sa retraite donna lieu au curateur des demandeurs d’obtenir permission de faire publier monitoire ; mais ell eut l’adresse d’en empescher l’exécution en surprenant le 15 octobre 1687 en la chambre des Vacations, un arrest de défenses qu’elle fit signifier le 17 du même mois ; le curateur y forma opposition et en obtint un second le 14 janvier 1688, qui le reçut opposant à l’exécution de l’arrest de défenses, lui permit de passer outre à la publication du monitoire, et même d’en obtenir un nouveau. Opposision à ce dernier arrest de la part de l’appelante, qui depuis est demeurée dans un profond silence, et a même arresté les poursuites de son beau-père en luy promettant de ne jamais demander le douaire qui faisait le sujet de la contestation ; elle a transigé avec luy en 1691, depuis son second mariage sans parler de ce douaire, dont elle se reconnaissait indigne ; mais après la mort de ce curateur arrivée en 1699 elle a renouvelé ses poursuites contre ses enfants du premier lit ; et s’estant adressée au juge de Laval, elle a formé contre eux dans cette juridiction un si grand nombre de demandes, que si elle réussisaient, elles ruineraient entièrement les demandeurs, et seroient passer dans une famille étrangère, c’est-à-dire aux enfants du second lit de l’appelante, les biens que les demandeurs ont eu de leur père et de leur ayeul paternel.
Pour défendre à ces demandes, on créa des curateurs aux demandeurs, et ces curateurs oposèrent par forme d’exception à l’appelante, sa débauche pendant l’année du deuil. La cause ayant même esté porté à l’audience, intervint sentence contradictoire le 9 janvier 1702, qui permit aux parties de faire preuve respective des faits par elles avancés, mesme de publier monitoire. L’appelante a elle-même levé, fait signifier et exécuté cette sentence ; mais comme dans le cour du procès on s’est aperçu qu’il y avait quelque chose de pendant en la Cour, qu’il estoit nécessaire de faire juger préalablement, les demandeurs ont pris une commission pour y faire assigner l’appelante, et voir dire que son opposition à l’arrest du 14 janvier 1688 ; et l’appel qu’elle avait interjetté des sentences des 9 et 30 août 1687 ferainet déclaré péris, et en conséquence passé outre à la publication de monitoire. Cette péremption est indubitable, y ayant eu constamment discontinuation de procédures pendant plus de 3 années, aussi l’appelante est convenue lors de la plaidoirie de la cause, que cette ancienne instance estoit périe ; mais elle a soutenu que les demandeurs n’estoient pas parties capables pour opposer cette péremption, d’autant plus qu’ils n’ont point repris l’instance commencée par leur ayeul.
Cette objection peu considérable, car 1er ce sont des mineurs qui agissent après la mort de leur curateur comme il auroit pu faire de son vivant, ce n’estoit même que pour leur intérest qu’il agissait, puisqu’il ne pouvait tirer aucun avantage personnel de l’action qu’il avait intentée contre l’appelante pour la faire priver de son douaire. 2e Ils sont héritiers de leur ayeul, et cette qualité leur sufirait seule pour agir, quand même ils n’y auraient pas intérest de leur chef.
Enfin les demandeurs n’avaient garde de reprendre un instance qui est constamment périe, de l’aveu même de l’appelante, puisqu’ils se seraient par là exclus d’en demander la péremption.
L’appelante dit en second lieu, que cette ancienne instance a esté abandonnée par les demandeurs, qui ont depuis procédé volontairement à Laval sans opposer la péremption.
Mais cet arguement se rétorque contre elle-même, c’est elle qui a commencé une nouvelle action devant les juges de Laval, elle a donc reconnu que son ancien appel estoit péri et ne subsistait plus.
Les demandeurs n’ayant fait aucune procédure en la Cour qui ait pû interrompre la péremption, et s’estant seulement défendus à Laval, n’ont point renoncé à leurs droits, au contraire s’estant défendus précisément de la même manière que leur ayeul avoit fait en 1687.
Cela présuposé, il est superflu d’entrer dans les moyens du fonds, puisque les Sentences des 9 et 30 août 1687, estant confirmées, les demandeurs sont constamment en droit de faire preuve de la débauche de l’appelante pendant l’année du deuil, mais cependant pourne rien obmettre dans une affaire dont dépend toute la fortune des demandeurs, ils tâcheront de faire connaître à la Cour, que la veuvge Chatizel est non recevable dans l’appel qu’elle a interjetté de la sentence du 9 janvier 1702, et qu’au fonds même cette sentence a été bien jugée.
Fins de non-recevoir contre l’appel de la sentence du 9 janvier 1702
L’appelante a levé, fait signifier et executé cette sentence, sans protestation d’en appeler, et les demandeurs ayant articulé les faits de débauche dont ils prétendaient faire preuve en vertu de la permission qui leur estait accordée par cette sentence, elle les dénia précisement, ce qui est l’execution la plus authentique et la plus formelle qu’on puisse désirer ; depuis elle a écrit, produit et contredit pour satisfaire à cette sentence, elle a menacé les demandeurs des malédictions prononcées dans l’Ecriture, contre les enfants qui relevaient la Turpitude de leurs pères et mères ; enfin elle n’a pas douté que cette sentence ne fut juridique, et elle ne s’est avisée d’en interjeter appel qu’à la veille de la plaidoirie, par ce qu’on la luy a objectée comme une fin de non-recevoir insurmontable
Moyens au fonds
C’est une maxime constante, que la veuve qui vit impudiquement pendant l’année du deuil perd son douaire et tous les avantages que son mari luy a faits, la Novelle 39 ch. 2, y est précise, et c’est le sentiment de tous les auteurs qui ont écrit sur ces matières, on se contentera de citer icy les plus considérables.
Du Moulin dit, que quoi qu’on se soit relaché sur les peines introduites par les Loix Romaines contre les femmes qui se remarient pendant l’année du deuil cependant la Loy est demeurée en vigueur contre les femmes qui préfèrent une prostitution honteuse à l’honneur du mariage.
Coquille décide la même chose, quest. 147, et il en fait une règle de notre droit dans ses Institutes Coûtumières. « De fait si la veuve dedans l’an du deuil vit impudiquement, l’héritier du défunt mari peut la faire priver de tous les avantages nuptiaux qui luy ont esté faits. »
D’Argentré, Brodeau, Ricard, Despeisses, Renusson, et tous les Commentateurs des Coutumes de Normandie, d’Anjou et du Maine, dans la dernière desquelles les parties qui plaident sont domiciliées, rendent témoignage à la vérité de cette maxime, et décident unanimement que l’héritier du mari est recevable à alléguer l’impudicité à sa veuve, pour la faire priver de son douaire et des autres avantages qu’elle a eûs de son mari : comme il serait trop long de raporter les termes dont se servent tous ces auteurs, on se contentera de citer ceux de Dupineau, dernier commentateur de la Coutume d’Anjou : « Aujourd’huy, par un droit très certain, les héritiers du mari peuvent dans l’an du deuil alléguer par exception, l’impudicité à sa veuve.
Les Arrests ont assuré la jurisprudence sur ce point.
Celuy du 11 avril 1571, cité par tous nos auteurs, et dont Me Anne Robere a rapporté toutes les circonstances avec beaucoup d’exactitude, a jugé la question en termes formels.
Le second arrest de l’année 1594, est rapporté par Berault. Une veuve qui s’était remariée 6 mois après la mort de son mari, accoucha 6 semaines après ce second mariage ; les héritiers de son premier mari luy opposèrent sa débauche pendant l’année du deuil, et la firent priver de son douaire pour cette raison.
Le 3e du 5 décembre 1631, est dans une espèce bien moins favorable que celle qui est présentement à juger. Jeanne Le Tellier, veuve de Jean Virginet déchargeur de poudre à l’artillerie, et par conséquent exempté de taille, se laissa séduire sous promesse de mariage pendant l’année du deuil. Cette mauvaise conduite ayant fait du bruit dans le village de Sucy en Brie où elle demeurait, les habitants la cottisèrent à la taille, comme était déchue des privilèges de son mari. Elle se plaignit de sa taxe, et soutint que ces habitants n’étaient pas en droit de luy faire une semblable objection, cependant l’honnêteté publique l’emporta, et par arrest rendu après une plaidoirie solemnelle et contradictoire, elle fut déclarée cotisable à la taille et déchue des privilèges de son mari.
Le 4e est du 7 janvier 1648, et quoi qu’il ait accordé le douaire à une veuve qui était devenue grosse pendant l’année du deuil, cependant comme la Cour se détermina fut des circonstances particulières, et prononça même qu’elle jugeait de cette manière, sans tirer à conséquence. Brodeau et du Fresne, qui rapportent cet arrest, disent que cette exception confirme la règle et établit de plus en plus la maxime ; que la veuve qui vit impudiquement pendant l’année du deuil, doit estre privée de son douaire.
Le 5e du 22 février 1666, semble fair pour notre espèce. La veuve du nommé Besogne, ayant vécu impudiquement avec son cousin germain pendant l’année du deuil, fut privée de son douaire, quoi qu’elle allégua qu’elle avoit été trompée sous promesse de mariage, et qu’elle avait même obtenu dispense de Rome, pour épouse celui qui l’avait déshonorée. La différence qui se rencontre entre cette espèce et la nostre, est tout à fait désaventageuse à l’appelante, puisque son cousin ne luy avait point fait de promesse de mariage, et qu’elle n’a pas obtenu de dispense de Rome.
Le 6e du 3 février 1674, est entièrement désicif. Marguerite Chaberre, veuve de Jean Delignac, et qu’il avait instituée son héritière, se remaria 13 mois après qu’il fut mort, et accoucha d’une fille 6 mois et 4 jours après son second mariage. Joseph Delignac son fils, demanda et obtint permission de faire preuve que sa mère était grosse 2 mois avant son second mariage, même que pour couvrir sa grossesse, elle s’atait absentée de la ville de Toulon, et qu’elle avait tenu son accouchement secret pendant quelques jours avant que de faire baptiser son enfant.
Objections de l’appelante
Le 1ère est tirée d’un arrest du 8 juin 1632, rapporté par Brodeau sur Me Louet, cet arrest adjuge le douaire à Jacqueline du Bois, veuve de René de Villeneuve, quoi que par un premier arrest du 22 août 1626, l’enfant dont elle était accouchée le second jour du 11e mois après la mort de son mari, eût été déclaré illégitime.
Mais il faut pour toute réponse, faire quelques observations tirée de l’auteur même, qui rapporte cet arrest.
1 – Jacqueline Dubois n’avait jamais été accusée d’impudicité ; au contraire, Me Bouguier qui rapporte l’arrest de 1616, dit que l’onzième mois étant parfait, l’enfant fut déclaré illégitime, bien que la femme fut tenue pour chaste et non soubçonnée.
2 – Brodeau remarque que cette veuve avoit fait la déclaration au Procès, pur se soumettre à la preuve de débauche, en cas qu’on osa l’alléguer.
3 – Nonobstant toutes ces raisons, l’arrest de 1632, parut si extraordinaire, que les héritiers du mari prirent requeste civile, fondée sur la contrariété qu’ils prétendaient encontrer dans ces deux arrests, et la requeste civile fut entérinée par arrest du 11 mars 1651, après lequel, il est impossible de douter de la vérité de la maxime que les demandeurs ont avancée.
La seconde objection est tirée de la qualité des parties. On prétend que des enfants ne sont jamais recevables à opposer à leur mère sa mauvaise conduite.
Mais où a-t-on puisé cette prétendue maxime, qui est contraire à toutes les autorités qui viennent d’être citées ? En effet, l’appelante demeure d’accord que les héritiers sont recevables en ce cas. Or le terme d’héritiers est générique et convient encore plus aux enfants qu’aux collatéraux. D’ailleurs, osera-t-on dire qu’une veuve qui a des enfants, pourra s’abandonner sans crainte et déshonorer la mémoire de son mari, et que celle qui n’aura point d’enfant sera obligée à plus de retenue, de peur d’être privée de son douaire, et des autres avantages que son mari peut luy avoir faits ?
En second lieu, les arrests de 1666 et de 1674, sont dans l’espèce d’enfant qui opposaient cette exception à leur mère.
3e Quand même on ne voudrait pas permettre à des enfants d’accuser leur mère quelque indigne qu’elle soit, on ne pourrait se dispenser de les écouter quand ils n’objectent la débauche que par forme d’exception et qu’ils n’agissent que pour se défendre, parce qu’en ce cas, c’est la mère, qui les force à relever des faits qu’ils voudraient ensevelir dans un éternel oubli, et qu’on ne saurait blâmer des enfants qui ne rompent le silence que pour empêcher leur ruine.
4e La prétention des demandeurs est d’autant plus favorable qu’ils ne font que reprendre un moyen allégué par leur ayeul paternel qui était en même temps leur curateur.
5e Les choses ne sont plus entières puisque la veuve Chatizel est non recevable dans l’appel qu’elle a interjeté de la sentence du 9 janvier 1702 qu’elle a levée, signifiée et exécutée sans aucune protestation. Mais quand les demandeurs ne seraient pas en droit de luy opposer un consentement si formel et si précis, il y a des commencements de preuves si forts et en si grand nombre qu’il serait impossible de leur refuser la permission qu’ils demandent.
Le premier se tire de la plainte rendue le 21 juillet 1687, par l’ayeul des demandeurs contre l’appelante qui soutint estre actuellement grosse, si enne ne s’estoit pas reconnue coupable, elle aurait poursuivi la réparation d’une injure de cette qualité, bien loin d’arrêter le cours des procédures par un arrest de défenses.
Le second commencement de preuve tire de la fuite de l’appelante, qui sortit de la ville de Laval aussitôt qu’elle eût appris que son beau-père avait obtenu permission de la faire visiter par des matrônes, et qui n’y rentra qu’après être accouchée.
Le troisième est l’extrait baptistaire de l’enfant dont elle est accouchée, et qu’elle a fait baptiser le 13 septembre 1687 sous des noms supposés. Les demandeurs mettent en fait que l’appelante était sortie de la ville de Laval au mois d’août 1687, se retira dans la paroisse de Saint Denis d’Orque, en la maison de François Barbin, qu’elle y fit ses couches, qu’elle fit baptiser son enfant commem hé hors le mariage de René Laceron, et qu’elle payé dès lors 30 livres pour sa nourriture.
Le quatrième commencement de preuve se tire de l’avis des parents des demandeurs, sur lesquels, en connaissance de cause, on osta à l’appelante la tutelle des enfants et on nomma leur ayeul pour curateur universel ; cette destitution infamante est une demie preuve contre la veuve Chatizel, d’autant plus qu’elle n’a point interjeté appel de la sentence qui prononça cette destitution, qu’elle y a même acquiescé en transigeant avec son beau-père, comme curateur universel de ses enfants.
Enfin la dernière réflexion qui est non seulement un commencement de preuve, mais une présomption très violente contre la veuve Chatizel, se tire de son silence pendant tout la vie de son beau-père, quoi qu’il ait vécu plus de 12 ans depuis le commencement de ce procès : est-il possible que si elle eût esté innocente elle n’eût pas cherché à se justifier pendant tout ce temps, et à faire cesser les mauvais bruits qui avaient couru de sa conduite, et qu’elle autorisait par son silence ?
Aurait-elle demeuré si longtemps sans demander son deuil et son douaire ? Aurait-elle fait une transaction en 1691 avec son beau-père sans parler de ce douaire, ni de ce deuil ! on voir bien qu’elle se sentait coupable, et qu’elle n’osait agir du vivant de celui qui était instruit de toute sa conduite, qui connaissait les témoins qui en pouvaient déposer et qui ne l’auroit pas tant ménagée qu’on fait les demandeurs, qui n’ont plaidé que malgré eux, et à la dernière extrémité, pour tascher d’éviter leur ruine totale. Ils espèrent donc que la Cour fera triompher dans cette occasion l’honnêteté publique et ne permettra pas que l’appelante après avoir déshonoré la mémoire de son premier mari par ses débauches, et par un second mariage tout a fait inégal, fasse passer son bien dans une famille étrangère.
M. MAGUEUX avocat
Par arrêt du Parlement de Paris à la grand chambre l’an 1702, la veuve Chatizel est déboutée, et ses enfants ont obtenu gain de cause.
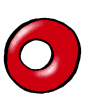
 Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.