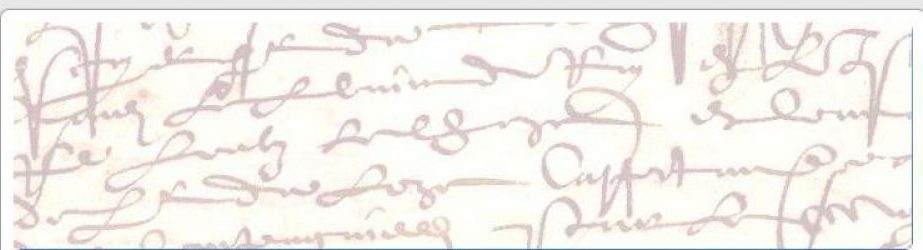Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
Dimanche !
A poignées les cloches jettent leurs appels dans l’embrassade de la ville. Ça danse au-dessus de clocher en clocher ; ça saute de toit, en toit ; ça se repose à califourchon sur les cheminées ; ça se meurt au fond des lucarnes ; ça dégringole aussi contre les fenêtres faisant trembler les vitres des dormeurs ; çà bondit de pavé en pavé, du trottoir aux égouts. Une bacchanale assourdissante de danseurs égrillards ; une fusillade de sons qui crépite en l’air, qui se répercute de fusées en fusées.
Les tours de la cathédrale ébranlent leurs crânes qui se pelliculent. Sur le parvis une large traînée multicolore s’engouffre dans les gueules des portails avec un bruit de marée.
Place Saint-Pierre René aperçut Mme Lonneril et sa fille qui se rendaient à la grand-messe. Il les suivit.
Les dalles frémissaient sous les chatouillements de la foule cherchant des places. Les chaises hystériques se trémoussaient de main en main. Le troupeau des fidèles alignés dans la nef semblait une prairie semée de feuilles d’automne et d’éclaboussures de printemps.
Un coup de cloche. Le Suisse, bariolé d’or et de rouge comme un polichinelle du jour de l’an, précédait de sa pertuisane les choristes et les prêtres chamarrés de chasubles éclatantes. Les orgues surgirent leurs accords étincelants – le rythme vers les voûtes s’élevait, se croisait, se cassait, pleuvait en morceaux écaillés. Et les chantres hurlèrent la liturgie musicale – fracas grotesque hebdomadaire.
Ils beuglaient pour leur argent, – ineptes ventrus ouvrant des gueules de crocodiles affamés. Mesquine ritournelle à côté de ce qu’on peut rêver de nécessaire à la majesté du temple : les anges des vitraux descendant accompagner les hymnes divines de la romance des harpes mélodieuses.
René avait un pli de raillerie au bord des lèvres, un pli de rancune contre ces cérémonies déchues à la vapeur – exécutants aussi pressés d’en finir que les auditeurs. Rares ceux ou celles songeant au mystère religieux qui s’accomplissait entre les doigts de l’officiant. Les femmes détaillaient les coupes des robes voisines, les hommes laissaient flotter leur esprit à des souvenirs quelconques, au froufrou des soies et des parfums.
En face, la vaste prestance de Mme Lonneril se découpait dans la lumière d’entre les rosaces et sa fille luisait ses beaux yeux pers à travers le rai d’un soleil audacieux. René sentait qu’elle l’avait aperçu. De temps à autre elle le regardait d’un coup d’oeil sous l’envergure de son chapeau grenat lorsqu’il tournait la tête. René bercé de ce manège enfourcha les chimères qui chevauchent le long des lacs azurés et des solitudes éternelles à deux. Par les vitraux de son âme filtraient des silhouettes de dévotions savantes et hasardeuses.
Le tintement désagrable des quêtes et des chaisières réclamant leur obole balayait d’ombres les lumières imaginatives. Grêle moqueuse sonnant la réalité aux pieds des enseignements du Jésus grelot¬teux sur sa croix de pierre cramponnée au torse d’un pilier.
A la sortie, il s’arrangea pour saluer les Lonneril. Le sourire gracieux de la jeune fille compensa la raideur froide de la mère. Chacun se perdit dans la masse des ambiants.
René, indécis, ne savait quel chemin prendre lorsqu’une main lui frappa l’épaule :
De Lorcin se détourna. Un jeune homme de sa taille, maigre, avec des cheveux bruns, une barbe des yeux profonds et noirs où brûlait une violence qui contrastait avec la douceur de sa voix.
Et bras dessus, bras dessous, les voilà partis gesticulant comme des fous dans la rue Mathelin Rodier qui conduit devant le château à la rue Prémion.
Près du ciel ! Au quatrième étage.
En haut :
C’était une longue salle éclairée par trois fenêtres, deux s’ouvrant sur le château et la Loire, la troisième sur le nez des arbres du cours Saint-Pierre. Avec cela un désordre augiatique : tentures bleues, vertes, junes, traînaient çà et là parmi les peaux de bêtes sur le sol, dans les fauteuils, des sophas chevauchaient de malheureux poufs étouffés. Les fleurs bombaient des caisses ; le mur était couvert de plâtres antiques comme des verrues grises. Les chevalets supportaient des toiles, les unes immaculées, les autres inachevées ou cachées sous des voiles épais. Aussi des croquis bizarres d’êtres étranges, de femmes androgynes, d’animaux monstrueux, des têtes de serpents en cuivre, des tapis, des chiens et des écureuils empaillés, un méli-mélo de luxe et de bric-à-brac au centre duquel un gros ara juché sur un perchoir peint comme une vieille grue braillait de temps en temps des cantiques. Son maître à ses heures d’ennuis les lui apprenait. Çà me rappelera l’éternité, disait-il !
Il s’approcha du perroquet.
Bigot battit de l’aile et d’une voix rauque, entonna:
Esprit Saint, Dieu de lumière…
Le peintre haussa les épaules.
Charles s’allongea dans une chaise longue, alluma une énorme pipe, et, au centre d’un véritable feu de cheminée.
Il aspira quelques bouffées.
Charles s’était, levé allant de la fenêtre à René qui écoutait impassible l’exaltation de son ami.
Charles fumait terriblement.
Toujours fumant il revint se planter sous la lumière de la fenêtre.
Il se tut, tirant les dernières bouffées de sa pipe cependant que le perroquet hurlait sur son perchoir un triomphal Tantum ergo.
René applaudit l’épilogue. Charles cria : « Bigot, ferme ton bec tonnerre de sort, ou je te flanque ma pipe dedans. »
Devant le terrible geste Bigot poussa des cris stridents, battit de l’aile et s’enfuit précipitamment sous un pouf éloigné.
Les deux amis quittèrent l’atelier et le perroquet réintégra ses pénates.
Ils passèrent l’après-midi ensemble, déambulant n’importe où, heureux de se trouver côte à côte, de causer d’art, de peinture, de musique, de poésies préférées. Ces bavardages semblent enrager les aiguilles banales des cadrans et accélérer ainsi leur voyage.
Ils arrivèrent par hasard sur le cours Saint-Pierre où l’ombre de l’abside de la cathédrale et des ruines moisies de l’Évêché, cravatées de touffes d’arbres, s’épanouit par les rondes enfantines et les vieux qui pérorent assis en chiquant et bavant dans le sable. A l’extrémité se détache, sous le plein ciel, le monument des Enfants de la Loire-Inférieure morts pour la Patrie, groupe allégorique entouré de soldats modernes et flanqué des statues fraîchement brossées d’Anne de Bretagne et d’Arthur III, rigides ainsi que des valets de bonne maison.
Tous deux s’étaient approchés.
A ce moment deux belles filles passaient et les regardaient en souriant. Puis l’une d’elles à mi-voix.
Le peintre se détourna.
Sur un signe de tête de celle-ci elle reprit :
Elles se sauvèrent en riant comme des folles, saluant de joyeux coups de tête.
La meilleure des pâtes cette Berthe, dit Charles en prenant le bras de son ami.
Elle est gentille la brune Lolette, répondit René.
Une foule considérable traversait le cours d’un bariolage millénaire.
Ils prirent la rue du Lycée, s’arrêtèrent une seconde devant le Palais des Beaux-Arts lamé de statues comme un boléro d’actrice, ne prirent garde à la riante souricière appelée Lycée et franchirent la grille du Jardin des Plantes. A l’entrée sommeille dans l’oubli d’un songe vieillot la statue du Docteur Ecorchard, fondateur dudit jardin, troublée seulement par la bascule sa compagne ayant sa légende traditionnelle
Qui souvent se pèse bien se connaît
Qui bien se connaît bien se porte
et par les promenades qu’on lui impose de temps en au travers des allées à la recherche d’une place introuvable. Au centre de l’allée des magnolias la musique déploie ses étoffes éclatantes au-dessus d’une foule en spectacle semée de rares auditeurs. La fourmilière bariolée s’agite par les allées de sable fin et les ponts rustiques. De gentes cascades ont des rires grelins étouffés dans les lierres. Les bébés blonds ou roses s’asseoient sur les roches graciles et croquent à belles dents les gâteaux de la marchande au bonnet gauffré. Ils partagent avec les poissons gourmands qui fendent des rides à l’eau calme. La voiture aux chèvres trottine ses petits pas bruyants et les mignons voyageurs un doigt dans le nez prennent le sérieux de circonstance. Des boutons clairs aux poils artistement soignés crèvent la chair verte des pelouses. Les hérons pensifs de l’éternité des au-delàs côtoient les gros canards repus qui se grattent le jabot. Sur le miroir des pièces d’eau, entre les roseaux abêtis et les maisonnettes des îles frelatées, un jet siffle des grelots d’argent et des cygnes majestueux voguent les calices blancs de leur immaculation. Au sommet du labyrinthe ombragé de fronts orgueilleux d’arbres et, d’essences exsangues ils trouvèrent Charmel et Ormanne assis sur un banc.
Charles les invita à sa plantation de crémaillère. En descendant ce furent la petite Belle et son inséparable Line — deux gringalettes avec des yeux fripons, voire canailles, gamines trop avancées pour leur âge. Elles promirent de venir. Du moment qu’on rigole, ça va !
Peu à peu René ne prêta plus qu’une oreille distraite aux propos de son ami. Il cherchait quelqu’un dans la foule. Etait-ce le hasard qui l’avait amené au jardin ? Il eut un regard joyeux quand les Lonneril entrèrent dans la meme allée, salua, et sourit à la jeune fille qui venait de lui répondre. Charles lancé dans une théorie fulminante ne s’aperçut pas que René lui faisait suivre les Lonneril. De temps en temps Mlle Lonneril se retournait discrète. Alors René devint loquace, brassant en un langage ironique tout ce qui lui tombait dans l’esprit.
Les Lonneril rentrèrent chez eux. Les deux amis arrivèrent place Royale au coeur de la ville. La nuit tombait. René vit l’heure de se rendre chez son oncle.
Ils montèrent, la rue Crébillon, heurtés par les groupes qui venaient en sens inverse, promeneurs sous l’arc des lumières électriques.
Ils savaient qu’un pacte inexprimé et inexprimable en langage humain s’était inscrit dans leurs âmes soeurs, gravé dans leurs coeurs. Un lien étroit et tenace qui les unissait malgré tout.
Il montait se mêlant à l’écho de leurs paroles exaltées le bruit des rues sceptiques des lumières, répercuté par les regards comme un rire indéfini ment sarcastique.
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.