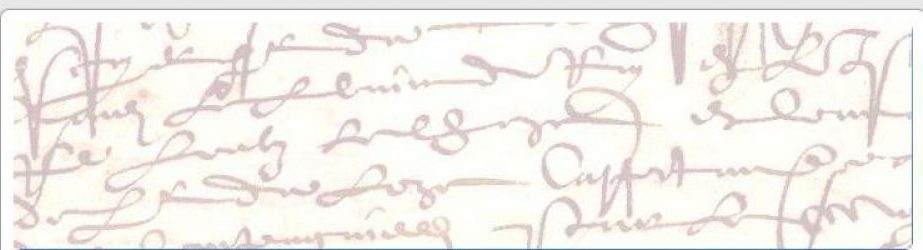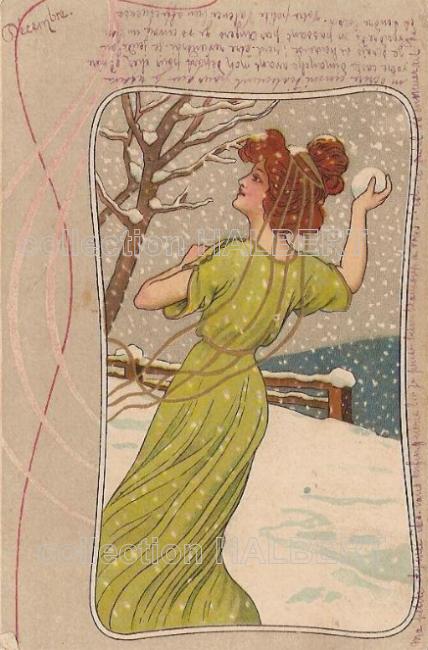début du chapitre XI : le cul-de-sac
chapitre 1 : le brouillard – 2 : la ville – 3 : la batonnier et l’armateur – 4 : le peintre – 5 : le clan des maîtres – 6 : rue Prémion – 7 : labyrinthe urbain – chapitre 7, suite – 8 : les écailles – 9 : emprises mesquines – 10 : carnaval – 11 : le cul-de-sac –
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
Coac… coar… ard… ac… ard…coc coa cco ard…
Phare, Populaire… vient de paraître
Les vendeurs de journaux se dispersaient en la ville, hurlant dans leur corne criarde et courant sans cesse à qui arriveraient les premiers au bout des multiples artèes. D’autres allaient prendre leur place coutumière près du kiosque des trams, ou faisaient la tournée des grands cafés.
Sept heures et quart environ ; René se rendait au restaurant. Un camelot l’agaça : Phare, Populaire, m’sieu ! Il acheta un numéro de chaque.
De nombreux trottins troussés jusqu’aux genoux se pressaient par les rues boueuses, montrant leurs mollets séduisants aux vieux marcheurs l’oeil au guet. Les magasins vidaient leurs employés, calicots inanes et coquettes vendeurs aux yeux cerclés par les doigts de l’amour, aussi les humbles miséreuses trop pauvres ou trops laides, les souffre-douleur d’ateliers dont on ricane au passage, l’apprentie qui se poudre et singe la première.
Rue d’Orléans, à la devanture d’un marchand de comestibles, où sur la nappe blanche et propre d’architecturaient des plats succulents, sculptés de promesses alléchantes, une gosse se haussait sur la vitrine ; elle semblait fascinée, enflant ses narines. La gamine n’était pas grosse ; ses os se moulaient à sa robe noire mince pour l’hiver. Comment ne grelottait-elle pas sous cette minuscule pélerine qui lui tombait à peine aux coudes ? Pas de fourrures, pas de gants, des doigts bleuis, croisés sur son corsage, une petite frimousse pâle exsangue, adorablement jolie ; ses cheveux étaient enroulés en chignon, – comme une dame, quoi ! Flairant une nouvelle aventure, René l’aborda gentiment.
Aimeriez-vous ces plats ?
Oh ! oui, monsieur.
Voulez-vous dîner avec moi ? il y aura des choses aussi bonnes.
Je veux bien… Vous ne me ferez pas rentrer tard car je serai battue ?
Non ! J’irai vous reconduire.
Au restautant. Une salle étroite. Un feu de charbon rouge comme une blessure vive. La table bourrée de plats exquis ; une orgie d’excellents mets et de vins de choix. René en face la gamine. Il lui avait noué la serviette autour du cou ; sans crainte de se tâcher, elle fourrageait ses mains dans la graisse, le beurre et les sucreries. Elle dévorait gloutonnement, graissait ses joues, son menton, son nez, usait rarement de la fourchette, préférant la commodité à l’usage. René s’amusait fort intérieurement de la voir se gaver.
Tu avais faim, je crois ?
Dame, je n’avais pas mangé depuis hier soir. Et encore, c’est pas bon chez nous ?
Vous êtes nombreux chez vous ?
Y a le père, la mère et deux mômes de cinq et six ans… qui sont bien mignons… on n’est pas riches, monsieurs, on n’a pas de pain tous les jours. Le père est manoeuvre. Il travaille pas souvent. Il se cuite avec ses paies et nous bat tous quand il est saoul., autrement, il est pas méchant. La mère est estropiée. Elle est des jours sans se lever. Elle se plaint. Le médecin dit que c’est pas la peine qu’il vienne, qu’y a rien à faire. Quant aux moutards, ils n’ont pas de fricot comme ça eux.
Tu les aimes bien tes petits frères ?
Ils sont si mignons… on se prive pour eux. Les grands supportent mieux la misère que les petits… Veux-tu que j’emporte du poulet dans un papier pour leur donner avec des gâteaux.
Prends ce que tu voudras ; tiens, aussi cette pièce d’or.
Non : Maman me battrait… et le père donc, y m’en ficherait une tournée… Je leur donnera ça à manger en cachette ; ils seront contents… J’en ai assez… où vas-tu m’emmener maintenant ? Tu ne me feras pas rentrer tard ?
Sois tranquille… Embrasse-moi si tu es contente.
Elle s’essuya soigneusement la bouche et grimpant sur ses genoux, elle l’embrassa sur les deux joues.
Quel âge as-tu, douze ans ?
Des prunes… dix-huit ans au mois de mai prochain.
Tu mens… une gringalette comme toi.
J’ai pas profité, pardine. Nous, les pauvres, on peut pas se développer comme les riches, à boire de l’eau, du pain sec et quelquefois des journées à souffrir la faim et travailler quand même sous peine d’être jetée à la porte par la patronne.
Qu’est-ce que tu fais ?
Je suis chez une couturieur. Elle me donne quinze sous par jour… Et je ne paie rien ; je porte le tout à la maison… Ça nous fait pas beaucoup pour tous.
Ça ne m’étonnent pas si les devantures gourmandes te tentent.
Oh ! Elles ne me tentent pas. Je suis envieuse. Je le fais exprès.
Exprès ?
C’est un truc. Quand j’ai trop faim et qu’il y aura pas à la maison, je me colle comme ce soir contre la vitrine. C’est rare qu’il ne passe pas un vieux qui m’invite à dîner avec lui.
Ce soir, ce fut un jeune…
C’est la première fois.
Lorsque tu as dîné qu’est ce qu’ils te disent les vieux ?
Ils m’emmênent avec eux dans une chambre… Je couche avec, pardi.
Et ça te fait plaisir d’aller avec ces gens-là.
Ça m’est égal… ni froid ni chaud… faut payer avec ce qu’on a…les hommes ne donnent pas à mangers aux filles pour rien.
Tu ne sais donc pas que c’est mal ?
Mal !… et crever de faim est-ce bien ?
Tu te trouves heuseuse ?
Ça dépend… Quand j’ai bien mangé et que le père me bat pas, je suis contente.
Longtemps encore il l’interrogea. Elle répondait de sa voix simple, contant avec naïveté son humble vie d’héroïsme, de dévouements, d’abnégation, avec une résignation touchante et triste à pleureur ; une âme d’élite que la misère imbécile consuit à l’indifférence de la brute par les sentiers de la souffrance besogneuse. L’idéal tué à coups d’épingles ; sur son cadavre l’acceptation d’une existence bornée aux soucis pressant du vivre quotidien, avilissement naturel, comme fatal, du corps chétif idiotant l’âme.
Il eut pitié de la pauvre fille. Il la caressa tendrement, presque dévotement, ainsi qu’une martyre nécessaire à la société. Il crut s’amurer avec une petite soeur longtemps absente, une petite soeur orpheline sans autre soutien qu’un grand frère. Elle s’était chattement pelotonnée dans ses bras. En ce nid chaud elle s’était endormie. Le silence. L’horloge tic-taquait, insupportable, régulière. René râvait, les doigts frisottant les boucles de la gamine. Son rêve puisé à la beauté de sa compagne lui mit soudain un désir comme un coup de fouet. Il se leva en sursaut.
Partons, dit-il à voix basse.
Somnolente encore elle se laissa conduire par la main. L’air frais de la nuit la réveilla complètement.
Où habites-tu, petite ?
Rue des Carmélite… on rente ?
Oui.
Tu ne fais pas comme les autes ?… Tu me trouves mal ?
Non !… Je te plains de tout mon coeur et je t’aime pare que tu es une souffrance immérité dont les goujats seuls peuvent abuser.
Alors, c’est pas pour ça… que tu m’as offert à dîner ?
Non !… C’est parce que tu m’as fait pitié.
Dis-tu vrai !… Tu as peut être dégoût des vieux d’avant toi !
Il ne répondit pas. Elle secoua la tête.
C’est pas possible que tu m’aies donné à manger pour la peau… Tu me connaissait pas… Tu me carottes.
Crois ou ne crois pas, petite amie, reprit avec sévérité René. Je n’ai aucun mépris de tes antérieurs. Je n’en ai qu’une grande compassion. Fais ce que tu voudras. Sache cependant qu’il y a de bons coeurs, des âmes susceptibles d’obliger leur prochain pour le bien ou comme réparation de l’inégalité des fortunes. Si tu penses parfois à moi, rappelle-toi que je t’ai aimée en maudissant le sort qui t’a jetée dans la vie… Au revoir, mignonne, je m’appelle René de Lorcin ; j’habite ru Saint-Pierre. Si tu as faim, viens chez moi ; tu auras ce que tu voudras sans te demander en échange qu’un baiser de soeur, et une promesse de ne plus retourner avec ses autres qui profitent de leur charité.
Des larmes brillaient aux cils de la jeune fille.
Bonsoir, monsieur, merci… voulez-vous que je vous embrasse ?
Il se pencha. Elle entoura son cou de ses deux bras et lui dit imperceptiblement à l’oreille.
Si vous voulez, je vous aimerai de tout mon coeur… je sor le soir à sept heures rue d’Orléans.
Avait-elle menti ? Etait-elle partie ? Ne se rappelait-elle plus son adresse ? René ne la revit pas et ne sut jamais ce qu’elle était devenue.
Le lendemain matin avant de se lever, il s’étirait, retardait le moment de sauter sur la descente de lit. Les journaux achetés la veille gisaient sur la table de nuit. La tête hors des draps, il les parcourut par ci, par là. Un titre l’attira : Suicide d’un banquier. Il fut stupéfait, épouvanté…
« … Hier, vers quatre heures et demie, une détonation retentissait dans le cabinet de M. Delange, banquier, rue de la Barillerie. Les employés se précipitèrent. Ils trouvèrent leur patron encore assis dans son fauteuil de cuir, couvert de sang, la cervelle éclatée, un oeil hors de l’orbite. On courut prévenir la police… »
René se leva comme un fou, s’habilla en deux tours de main et courut chez le peintre.
Tu as sans doute appris la triste nouvelle et tu viens m’apporter tes condoléances, lui dit Charles en le voyant entrer.
Mon pauvre ami, je viens de lire le journal. C’set affreux. Je tiens à te renouveler mon amitié et me mettre à ton service pour tout ce dont tu pourrais avoir besoin.
Charles sourit douloureusement.
Ne pas abandonner le fils d’un suicidé, c’est déjà la meilleure preuve de l’amitié. Merci ! Autour du cadavre vont s’agiter les spectres de la haine. Ils remueront la mare de sang de mon père pour m’en éclabousser la face. Leur rancune ne pardonnera pas les pertes d’argent. Toucher la bourse, c’est toucher plus qu’à la vie. Vae victis ! Je vais apprendre ce que va ma couter mon dédain de leurs préjugés, de leurs routines, de leurs allurs de gens bien pensants. Ils vont souffler sur mes ailes orgueilleuses et lointaines l’odeur cholérique de leurs méchancetés satisfaites ; ils s’en donneront à coeur joie dans le sang caillé du suicide.
L’enterrement fut triste, presque une fuite. René et quelques rares amis, peu de parents honteux accompagnèrent Charles derrière le cercueil de son père. La ville semblait pressée de se débarasser d’un pustule soudainement crevé.
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
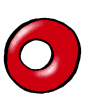
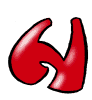 Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
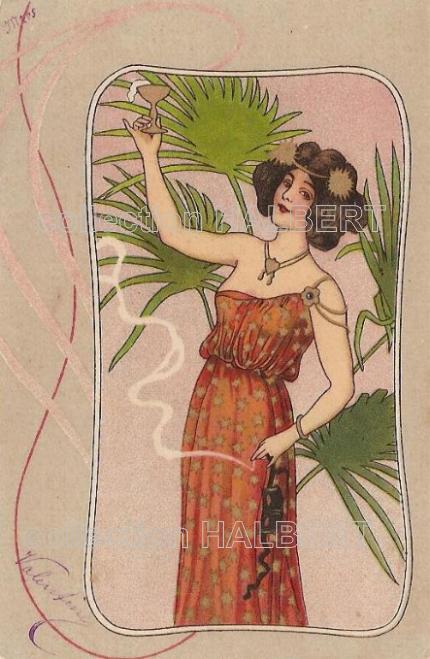
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.