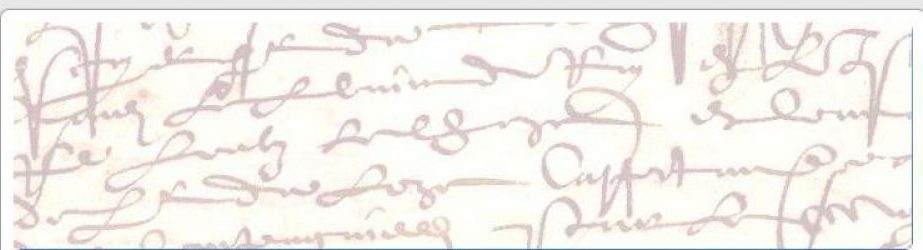Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
L’amour est le dieu de l’égoïsme bienheureux. Est-ce pour sacrifier trop sur son autel que René oubliait son ami Charles ? Il l’avait revu très rarement depuis la mort de son père. D’ailleurs, le peintre conservait une tristesse et une solitude farouches. Dans l’atelier les meubles s’en allaient. Le fameux tableau encadré de mystère dormait sous son voile au centre de la pièce.
La veille, René avait reçu une petite carte liserée de noir portant cette mention :
Défunt Bigot a l’honneur de prévenir ses amis et connaissances de sa récente entrée dans le monde des empaillés. Il y jouit d’un parfait bonheur en un éden que n’ont jamais encore souillé les bourgeois. Réjouissez-vous avec lui.
Charles avait montré à René le perroquet raide sur son perchoir. La pauvre bête était morte au milieu d’un cantique que lui apprenait son maître. Et celui-ci avait pleuré de vraies larmes en sentant le corps de son camarade se refroidir entre ses mains.
Ce soi-là, René faisait une partie de billard au cercle des étudiants. Dans la grande salle éclairée de larges fenêtres, une animation joyeuse tourbillonnait avec les fumées des pipes et des cigarettes. Les glaces se voilaient amoureusement au jour tombant. Doucement le lierre enlaçant le lustre se desséchait. De hautes affiches habillées de couleurs étincelantes paraient les murs. Sur les tables de marbre blanc les manilles se scandaient. Un calme écarté s’hypocritisait plus loin. Les piles de soucoupes glssaient avec une chanson de vaisselle sur le visage poli des tables. Des mots terribles tonitruaient horizontaux comme des coups de feu ; des éclats de rire, des discussions vives se trémoussaient d’aise. Par une porte entr’ouverte on entendait le piano et la voix d’un gosier enthousiaste hurlant quelque air favori d’opéra. La bibliothèque s’entassait ; un perpétuel froufrou de papier, les journaux du soir froissés, les revues parcourues. Sur la cheminée un charmant vénitien sérénadait à quelque lointaine et charmante Juliette. Ils étaient là, les Roméo de la jeunesse, ébruitant leur gaieté en des refrains juvéniles, mariant des toast blonds aux toast rouges, vidant des urnes d’exubérances. L’esprit se pavanait par les phrases. Et c’était aussi la joyeuse comédie de l’insouciance, de la marche fleurie vers la vie que l’on aperçoit facile et rêvassant sur les codes et les formales. D’aucuns discutent articles, d’aucuns maladies. Carabins, clerc, potards fraternisent à la cadence muette de la franche camaraderie et des amitiés naissantes. A l’abri des tentacules maudites des religions, des politiques, des calculs misérables de l’orgueil, on joue sur le même théâtre un morceau de vie, sans regarder en ennemi le camarade de travail de différente opinion. Etudiant, titre d’espérance comme un reflet de foi en des lendemains bienfaisants. Ils sont réunis su rle bord du rivage pour l’accolade avant de se disperser aux vents des exigences et des méfaits sociaux.
Les billes du billard fonçaient comme des béliers les unes sur les autres ; leurs fronts claquaient. Attentif à sa partie, René n’entendit pas la porte s’ouvrir derrière lui. Charles Delange entra. Pâle, il attendit le coup de son ami, puis il l’appela pendant qu’il blanchissait sa queue.
Ahuri, le jeune homme abandonna le jeu et sortit avec le peintre.
La gare dressa sa face noirâtre, illuminée de pendants d’oreilles électrics. Les machines soufflaient sous leurs cuirasses des blocs de vapeurs. Ils pénétrèrent sous le hall. Les employés couraient, balançant des lanternes rouges et blanches. Ils se promenèrent côte à côte, longeant le bruit, heurtés des malles qu’on roulait, des voyageurs pressés. Un train au loin faisait la manoeuvre. Des points lumineux s’entrecroisaient comme la raquette d’un volant. A l’autre bour, par delà le spectre de la Loire, les usines Lefèvre-Utils brillaient, la ville grouillait dans la nuit.
René baissa la tête sans répondre.
Charles monta dans un compartiment.
René se hissa sur le marchepied. Ils s’embrassèrent aux ricanements des voisins. La locomotive siffla. Le train d’un coup de rein s’ébranla, glissa lentement, puis plus vite. Charles agita son mouchoir.
René sentit des larmes picoter ses yeux, son coeur sursauter à son côté. Là-bas, la figure triste de son ami s’éclipsait dans le brouillard qui commençait à descendre. Le train disparut couvrant sur la nuit un convoi lugubre de mauvais augure. Le silence revint ; le vide isola René ; un malaise étrange, pénible, comme si l’on venait de refermer la tombe de sa destinée.
: chapitre 1 : le brouillard – 2 : la ville – 3 : la batonnier et l’armateur – 4 : le peintre – 5 : le clan des maîtres – 6 : rue Prémion – 7 : labyrinthe urbain – chapitre 7, suite – 8 : les écailles – 9 : emprises mesquines – 10 : carnaval – 11 : le cul-de-sac – chapitre 11 suite – chapitre 11 fin – 12 : les portes de Neptune – 13 : Cueillettes d’avril – 14 : Moisson d’exil – 15 :
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.