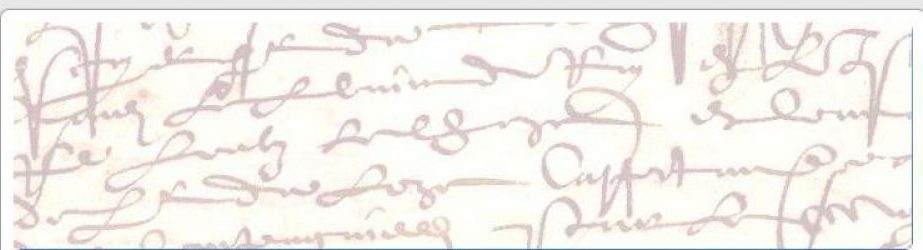Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
Le train de Bretagne reptilait par la Fosse ses anneaux enlacés d’une lourde pelisse de brouillard. Sur les glaces des portières un éventail de buée grise s’était collé. Au travers, la roulerie monotone des roues contre les rails se mêlait au grouillement des travailleurs sur les quais liserés de navires. On ne voyait rien, mais on devinait proche – à cette heure de l’après-midi – tout un monde en activité de débardeurs culbutant les sacs, roulant les barriques, une vie intensive au chant des grues et des poulies cependant que des commandements brefs giclaient comme des coups assourdis d’horloges battant le temps.
Après une halte rapide à la minuscule gare de la Bourse – hangar coquet au centre de la difficile traversée de la Ville – le train reprit à gros souffles sa lente pérégrination. La locomotive sous sa couverture jaune ruisselante crevait du poitrail la muraille brumeuse ; à chaque effort elle lançait un jet d’écume gluante comme une poitrinaire qui râle une vieille agonie. Les interminables bar-rières des passages à niveau battaient à ses côtés des gammes ferraillardes au nez placide des chevaux, aux jurons des cochers qui attendaient la masse noire se glisser derrière un opaque rideau.
La gare d’Orléans – illuminée comme une fée électrique – s’élargit, mettant un point d’or dans l’ensemble terreux. De toute la force de ses poumons la locomotive siffla un hennissement sonore, piaffa son bruyant orgueil sur les voies enchevêtrées, scabreuse et raide sons l’immense hall vitré, puis s’immobilisa les freins cerclés aux jambes.
Parmi l’inextricable brouhaha des employés hurleurs et des voyageurs bousculés René de Lorcin se pressait vers la sortie. Dans la cour il héla un fiacre, fit charger ses malles.
Chez-lui ! rue Saint-Pierre.
Sur les coussins de la voiture il se reposa une main sous le menton, paressant d’un geste familier sa barbe naissante, dans la moiteur de son respir qu’il regardait voluter indifférent.
Quelques minutes à peine la voiture s’arrêta. Le cocher ouvrit la portière à l’entrée d’une vaste maison. Sous le porche se tenait une bonne femme en coiffe.
Un quart d’heure plus tard René de Lorcin sirotait l’excellente tasse de chocolat chez son aimable propriétaire. Celle-ci assise dans un vieux fauteuil de cuir démodé regardait son hôte avec curiosité.
Soudain le chat ronronna plus fort. Dressé sur queue droite comme une asperge, il tournait au sommet du genou de sa maîtresse. Ses narines gonflées humaient les ondes aériennes saturées du délicieux fumet du chocolat.
René but une gorgée. Cette fois le chat n’y tint plus. Il quitta son poste favori et commença un multitudineux frottage aux jambes de l’inconnu.
Et sur cette énigmatique réflexion René achevant sa tasse se leva pour sortir.
Le chat n’avait cessé de sillonner contre les barreaux de la chaise. L’extrême pointe de sa queue virotait à coups secs.
Le coucou sortit sa tête du ciboire antique appelé horloge, hullula cinq fois, alors que sans bruit le minet profitant de l’inattention grimpait sur la table et lappait sournoisement le reste du chocolat.
On était à l’orée du mois de Novembre. La lumière frileuse des jours — masquée déjà par le blocus du brouillard – avait fui au fond de ses boudoirs inexpugnables.
René, le col du pardessus relevé, les mains dans les poches, descendit la Grande Rue, se dirigeant machinalement vers le centre de la ville. Crébillonner, suivant l’ancestre coutume des Nantais, c’est-à-dire monter et descendre cinq ou six fois vers cinq heures la plus belle rue semée de lumières comme une courtisane violemment fêtée.
Les mailles de la brume se resserraient en se rapprochant du sol. On aurait dit traverser de la gelée compacte qui avait des baisers glacials de cadavres. Les globes élebtrics semblaient des figures bouffies d’anges tels qu’on en voit dans les églises aux jours de fêtes resplendis de l’éclat myriadaire des cierges environnant. Encombrées de jouets fantaisistes les devantures des bazars riaient des grimaces burlesques et bariolées, alors que celles des chapeliers et des drapiers pleu-raient des vers luisants dans des fossés de moires. De vaniteux reflets giclaient jusque sur le trottoir du coeur des bijoux et des colliers forçant les papillons humains à s’arrêter dans leur hémistiche tentateur, et les vendeurs de journaux s’égosilaient ; là bouche pleine de vapeurs râclait des fonds de gorges encrassées. Avec leurs veilleuses blanchies en leur puits d’ombre, au petit trot de leurs rosse apeurées, les fiacres craquaient sourdement des déchirures de bois pourri. Les coups de fouet cassaient l’ai comme une mare gluante d’un son épais. Plus puissants les automobiles dévidaient un roulement brutal et rageur d’être maintenus. Le museau – ras du sol – avec leurs gros yeux ronds giclés des orbites ils coupaient la route condensée, secouaient des lambeaux furieux sur leurs flancs d’acier ; leurs beuglements gutturaux tourbillonnaient les poussières qui barraient la voie, affolaient la continuelle descente de ces flots entassés ainsi que d’innombrables et minuscules moutons blêmes.
Un tohu-bohu de conversations fluctuait. L’habitude : Nantes, au, travers le parcours des époques, lisse ses longs cheveux de brumes du même geste familier. Ses regards enfouis sous des voiles ténus de pluies – la pluie liseuse monotone de ses ennuis, infirmière cantale de ses chevets ! — mirent perpétuellement les pensers les plus simples et les identiques plus enracinés. Elle somnole bercée dans sa chevelure comme en un hamac persévérant de rêves vieillots. Son âme ressemble à ces papiers de soie mouillés. N’y touchez qu’avec des doigts coutumiers ! Son àme ne sait que la chanson des réminiscences qu’elle s’est lentement assimilées. Contez-lui la même histoire, elle vous écoutera. Chantez-lui la même rengaine, elle s’endormira futilement heureuse. Un rythme nouveau la ferait pleurer de douleur ou hurler de frayeur.
Ah ! la grise paresseuse de l’Ouest. Elle vieillit comme la statue de ses promenades, passive entre le souffle du temps transformant ses bijoux, donnant diverses couleurs à sa robe flottante, sans la migraine des imprévus, sans effort de foi ou de vaillance, de regret ou d’espoir, parce qu’il emploie les siècles à son oeuvre novatrice — insensiblement.

Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
Cliquez sur l’image pour l’agrandir :
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.