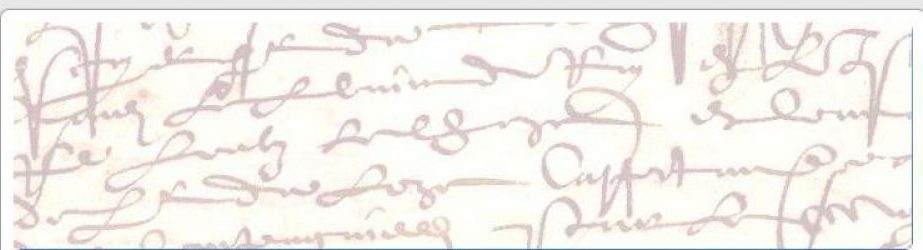Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
Quelques jours plus tard, René rencontra Melle Lonneril dans le passage Pommeraye. Elle était arrêtée à la devanture d’un magasin, admirant, sans doute les vases magnifiques panachés d’éventails en un méli-mélo de luxures éclatantes d’un goût raffiné. Le jeune homme fut ravi de la trouver séduisante en sa robe de tissu écossais aux tons brouillés où dominaient le vert et le bleu. Un boléro découpé sur une chemisette en soie développait sa poitrine sur laquelle s’étalait une cravate de mousseline neige. A la ceinture ses hanches se dessinaient fermes, inconsciemment provocantes par le dessin des contours inachevés sous les plis chevauchés de la jupe. Ses cheveux blonds illuminaient davantage son visage à l’ombre d’une capeline de mêmes couleurs que la robe, éclairée d’une boucle de strass au milieu d’un noeud drapé de liberty.
Tiens, dit-elle en se détournant, c’est vous monsieur de Lorcin !
Vous êtes délicieuse, murmura le jeune homme.
Ne me flattez pas, je croirais que vous vous moquez.
Vous vous tromperiez, mademoiselle. A quel bienheureux hasard dois-je de vous rencontrer ici ?
Je viens de chez une de mes amies. En rentrant je flâne.
Si vous voulez, nous flânerons un bout de chemin. Il me semble vous avoir vu depuis un siècle.
Elle sourit enle regardant. Ils descendirent les marches du grand escalier orné de statues d’enfants, d’étalages de souvenirs nantais et de broderies bretonnes comme des mouches d’or aux ailes bleues, de bazars débordants de jouets et de fantaisies amusantes. Au dessus d’eux le jour se promenait su rles vitres rogeoyant à la mort du soleil qui s’ensevelit à l’angle du ciel.
Ils babillèrent heureux de se trouver seuls pour la première fois. Ils ne se dirent pas leur joie d’être l’un près de l’autre, mais lls la laissèrent percer à chaque phrase.
Rue de l’Arche-Sèche, il lui prit le bas, elle le serra contre elle. L’intimité se fit plus profonde.
Vous sortez souvent, mademoiselle ?
Rarement ; il me faut des occasions.
Le pourrez-vous demain ?
Je ne sais pas.
Essayez. Je vous attendrai à cinq heures et demie au square St-André. Nous serons si bien cachés au centre de la verdure tranquille.
Et s’il pleut ? railla-t-elle gentiment.
Nous serons plus en secret encore sous le même parapluie… Vous viendez ?
Je ferai mon possible… Je vous le promets.
A demain… bonsoir, mademoiselle.
Alle retroussa sa robe, montrant sa jupe de moire rose, et disparut plus légère – le coeur a peut-être parfois des ailes.
A cinq heures, il s’impatientait déjà en parcourant les allées vides du petit square. Les vieilles commères qui marmottent de douces médisances, enfantent enleur stérilité de persistantes calomnies sont parties au foyer et le gardien travaille seul, les épaules basses. L’Erdre résonnait du bruit des lavoirs ; les camions filaient au delà des grilles assourdissant le jardin en triangle. Plus loin la passerelle de Barbin voûtait sur l’eau moire son dos ajouré comme un bas de mariée. Pour la vingtième fois, René Regarde les marches qui descendent du cours Saint-André entre les placides caricatures débarbouillées de Du Guesclin et d’Olivier de Clisson. Il scrute du regard le quai Ceineray, ombrellé de ses arbres, la rue Tournefort, la rue Sully. Le cadran du collège Saint-Stanislas, gros comme une montre dans le lointain sonne la demie.
Soudain, derrière lui, le sable craque dans un frou-frou. Il se détourna devinant l’arrivée.
Bonsoir, mademoiselle. Je ne comptais déjà plus vous voir.
Oh ! Je suis d’une exactitude militaire.
Ce n’est pas un reproche ; je m’en voudrais de vous en faire. Venez vous asseoir quelques instants.
Elle le suivit coquettement en sa ravissante toilette. Elle avait jugé ce rendez-vous important et s’était faire aussi séduisante que possible. Un paletot mastic aux manches bouffantes ornées de galons japonais. Au col, des flors de rubans pékinés par des comètes de velours noir, les bouts flottants serrés par des glands de soie. Son large chapeau de paille verte était fleuri de roses. Cette abondance d’étoffes rythmait une chanson de fraîcheur captivante, jouant sur le cerveau de René l’or d’une coupe de champagne. Des parfums montaient d’elle, l’enveloppaient, enveloppaient René, mêlés à son odeur de chair neuve de femme aimée.
Assis, il prit sa petite main gantée.
Comme c’est gentil d’être venue ! J’aurais eu vraiment de la peine si vous aviez manqué votre promesse.
Ce n’aurait cependant pas été ma faure. Je sors si rarement, si difficilement. Maman ne veut pas toujours.
Les femmes peuvent l’impossible quand elles le veulent.
Les hommes eux sont trop égoïstes.
Avez-vous pu vous en apercevoir ?
Peut-être. Avant tout leur plaisir ; le reste, s’ils ont du temps.
Je ne discute pas. Je sais que le plaisir m’est ici et que le temps qui me restera après votre départ sera vide.
Est-ce bien sûr ? N’êtes-vous pas fort occupé ?
Et par quoi ? Mon droit ne …
Elle haussa les épaules.
Ne mentez pas ? D’anciennes connaissances.
Je n’en ai plus.
C’est déjà mai d’en avoir eu.
Seriez-vous jalouse ? On n’est jaloux que de ceux qu’on aime.
Oui, René, je l’ai été depuis le mois de novembre… et je le suis encore.
Mais ne savez-vous pas que mon idylle d’hiver est terminée depuis longtemps.
Je le sais… mais les autres ?
Ah ! les autres, des passagères inconnues dont le visage est oublié à mes yeux pleins du vôtre, des amies quelconques d’un soir, que votre parfum a fait dissiper comme une vapeur malsaine, des vices que l’on méprise par ce qu’on les voir plus nus. Cela, c’est du passé mort, au creux d’un sépulcre scellé hermétiquement, queles pages sombres de la vie. Dites, Jeanne, Voulez-vous, après cette noire préface, composer le livre ensemble ? Le dieu d’amour en fera un travail de Pénélope que l’on recommence à chaque chapitre sans jamais en signer l’épilogue.
Il pressait dans les siennes sa main brûlante à travers la peau du gant.
Je suis franc, Jeanne, ne le voyez-vous pas ? J’ai souffert d’un caprice brutalement arraché parce que je l’ai jugé injuste. J’ai souffert ensuite de ma vengeance. Mon âme est encore malade, non de la réputation imbécile que le peuple nantais peut m’avoir faite de son insipide potinage, mais des éclaboussures du mal dont j’ai heurté des flaques. Par mes efforts je me suis éloigné du marais infect qui grouille par toute la ville. Au convalescent, il faut un sourire de soleil à travers les vitres ; à ma convalescence il me faut un amour exquis. Aimer : le doux remède de tout mal, de toute chute, le calmant mystérieux de toutes les blessures, le salut divin de l’égaré qui tâtonne son chemin. Jeanne, vous m’aimez, je le sais, dites-le moi vous même, non de vos gestes, non de vos regards, mais de vos lèvres ?
Il courba la taille flexible de la jeune fille vers sa poitrine, attendant une réponse. Elle baissa la tête sans parler.
Dites, Jeanne ? supplia-t-il? Vous m’avez laissé deviner votre amour. Il n’y manque plus que votre aveu. Parlez si bas que vous voudrez…
Elle se leva brusquement.
L’heure passe, monsieur, je me sauve.
Resté sur le banc il la contempla triste. Elle lui prit la main et rapide :
Oui, René, je vous aime.
Le gardien armé d’une pique inspectait les allées, emprisonnant et enterrant d’un coup sec les morceaux de papier. Il passa près d’eux d’un air indifférent. Les squares, n’est-ce pas fait pour les amoureux ?
Sur la place Saint-Pierre, ils se quittèrent. A demain. Régulièrement ils devaient se voir pami les arbustes confidents du premier rendez-vous.
Ils fleurirent de leur bonheur les voisinages déserts qu’ils choisissaient de préférence, loin des railleries mesquines des badauds. Rire dela beauté est le propre de la majorité des êtres à face humaine, de ce rire absurde qui fait aimer le chien, mépriser le maître. Solitairement, ils s’exilaient entre le silence de la rue des Orphelins, jusque là-bas derrière la caserne des dragons. Ils descendaient le boulevard extérieur à la paisible tranquilité des arbres. Ils allaient s’asseoir quelques minutes – lorsqu’elle avait une heure de plus – sur la prairie de Mauves qui se mûrissait comme une amante nouvelle sous la fécondation du soleil. La planturesque nonchalance de la prairie rêveuse et grave au bord de la Loire les envahissait de tendresse. Leurs lèvres se cherchaient, se collaient longuement. Ils buvaient à même une coupe de lèvres où moussaient leurs langues inassouvies. Tout était silence alentour. Le frottement des baisers chantaient l’hymne de l’au-delà des voluptés inquiètes. Le désir de feu mordait à satiété dans les chairs, mais la voix du retour ricanait le long des fossés.
Un matin, René reçut une depêche de Brest. Son oncle était mort l’instituant son légataire universel. Il partit aussitôt et resta cinq jours absent, sans pouvoir prévenir sa chère Jeanne. Celle-ci très attristée l’attendait chaque soir au petit jardin habituel. Puis elle ne vint plus, persuadée de la fuite du jeune homme vers quelque aventure du temps passé. Et elle pleura.
A son retour de Brest, René ne sachant comment la rencontrer, prit le parti de l’attendre à la grande poste où elle venait de temps en temps. Au centre de la vasre salle encombrée d’un énorme poële, garnie de quelques bancs minuscules, il espérait la voir venir. Derrière les cages, les employés grinçaient de plumes, tambourinaient de leurs tampons. Comme une marée les timbres, les récépissés, les monnaires fluaient et refluaient sur les tablettes de cuivres. Au fond, la poste-restante s’encombrait de voyageurs et d’inconnues hautaines ou timides. Au guichet, les noms bondissaient, l’alphabet sautillait, d’aucuns comptaient. Le commis indifférent, brutal, froissait les épitres à en-têtes commerciales et les discrètes missives parfumées. Monnaie couratnte pour son métier, ces petits chiffons délicats dans lesquels se jourent parfois la destinée terrible d’une vie entière, le bonheur ou la mort douloureuse et infamante ! Chacune s’en va, s’éparpille, emportant son secret., ce secret qui ouvre enfin la porte aux boudoirs des caresses divines et des adultères, ce secret qui vend des corps au poids du plaisir, qui met des taches pourpres au satin des souliers, qui sème les pleurs comme le vent d’automne sème les feuilles affaiblies. Les battants se déversent et s’écoulent aussi rapidement. Sillage étrange de têtes diverses, depuis le riche bourgeois jusqu’au flâneur déguenillé, la dame aux jupes élégantes jusqu’à la grue du ruisseau. L’égalité traînaille au bord des comptoirs.
Un soir, elle vint ; il alla vivement à sa rencontre. Elle eut un sourire de joie.
Vous !
Je vous attendais, Jeanne. Qu’avez-vous cru de moi ? Du mal, peut-être ? J’étais à Brest pour l’enterrement d’un de mes oncles. Je ne savais coment vous avertir sans crainte de troubler votre paix.
J’ai eu peur. On doit souffrir beaucoup quand on aime, n’est-ce pas à propos de rien… de mille chimères absurdes ?
Voulez-vous réparer cette absence par une longue promenade demain ?
Elle réfléchit.
Non, dit-elle, après-demain ; ma mère s’absente toute la journée. Je serai libre dès une heure. Attendez-moi au petit jardin, sans faute.
C’est cela. Quel bonheur ! Nous reprendrons le temps perdu aux banalités de l’existence.
L’oubli des tristesses a fui vers d’autres rives. Il faut si peu de choses pour l’expulser, parfois un serrement de main.
Il pleuvait une eau condensée qu’un vent violent, soufflant par rafales, faisait tourbillonner en flocons de brouillards sur la face morne de la ville ramassée dans la brume comme un colimaçon dans sa coquille. Le ciel éployait son éventail gris d’une tristesse mortuaire, laissant échapper des plumes épaissies. Et la pluie froide flaçait de ses petites mains la peu des visages sous les parapluies ballotés. Les doits ruisselaient des perles diamantées. Les gouttières ronronnaient doucement et vomissaient sur les trottoirs purs comme des glaces. De tous les pores de l’espace, il bruinait une torpeur agaçante qu’ondulait un rythme éternellement repris en sourdine à la harpe mouillée.
Ils se rencontrèrent tous deux troussés et crottés, nerveux sous la pluie qui les caressait, railleuse, de ses lèvres fraîches. Il s’approcha d’elle et comme les parapluies se heurtaient, il la pria de ferme le sien.
Indécis, ils regardaient les feuilles dégoutter, les aiguilles humides picoter dans l’eau de l’Erdre mouvante, sillonnée de trous, ainsi qu’une table où l’on tire aux macarons. Jeanne avait ses bottines trempées. Ils piétinaient dans les rigoles.
Qu’allons-nous faire ? murmura-t-elle.
Elle grelottait.
Je comptais sur une longue promenade parmi le réveil du printemps. Il faut y renoncer. Nous tremlez ; vous attraperez un rhume, si nous restons sous la pluie. Voulez-vous venir chez moi ? Je vous ferai les honneurs de mon logis.
Elle se fit prier, puis accepta. Elle lui prit le bras parfaitement cachée sous la soie du parapluie.
René enflamma quelques brins de bois dans la cheminée, et, pour elle, approcha le plus joli fauteuil. Il délaça ses bottines humides et les remplaça par des pantouffles à lui, un peu grandes mais suffisamment sèches. Elle jeta son chapeau sur le lit et sa chauffa les mains à la flambée.
La flamme a rosé vos joues… Il fait meilleur ici que dehors… Et nous sommes plus seuls, plus libres.
Il s’assit au bord du fauteuil, passa son bras sous l’aisselle de la jeune fille, lui caressa les joues des ses lèvres.
Comment trouvez-vous ma chambre ? Elle est simple. Jamais cependant elle ne fut si belle ; vous lui manquiez. C’était le vase à fleurs vide… Vous êtes le bouquet d’amour qui l’ornez.
Oh ! le flatteur.
Que dire d’intéressant sans parler de vous. Et comment ne pas flatter ce que l’on aime ?
Il se laissa tomber près d’elle, puis il la pris sur ses genous. Il chercha quelque chose à fire ; il ne trouva rien. Alors il comprit qu’il valait mieux se taire, que l’heure était venue du silence plus loquace que nul autre. Il la pressa contre lui, chercha sa gorge, son oreille et sa bouche tremblante. René trouvait une rose où sa langue allait puiser une liqueur printannière. Avec une douceur cauteleuse il défit un à un les crochets du corsage et découvrit le sommet des seins dormant leurs nez roses sur la chemise enrubannée. Il les caressa tous deux, les prit chacun leur tour dans sa main, joua avec les extrémités. Ils semblaient si frais qu’il voulut y goûter. Il approcha ses lèvres, les suça dévotieusement comme un bébé.
Jeanne ne disait rien. La tête appuyée sur l’épaule du jeune homme, elle fermait les yeux, égarée sans doute dans quelque rêve étrange, inconnu de son esprit vierge.
René s’enhardit. Quand il se fut rassasié des seins mignons, il glissa sa main sous les jupes, les long des mollets et des cuisses. Là, entre les bas et le pantalon, il trouva un coin de chair. A ce contact, la jeune fille poussa un léger cri, elle s’efforça de rabaisser ses jupes, d’écarter la main de René. Mais celui-ci la pressa contre lui, chercha ses lèvres, emprisonna sa langue avec la sienne. Elle se tut, vaincue.
Triomphant, il continua sa conquête amoureuse. D’un coup sec, il fit sauter le bouton du pantalon, tira délicatement la chemise. Il sentit enfin la chair nue, brûlante. Une chair sur laquelle il promena ses doigts avides de connaître les contours bien accentués, dun poli duveté. Il caressa le ventre, le nombril où il appuya son index, puis plus bas, ses doifts se plongèrent dans des toufffes épaisses, légèrement humides.
Oh ! René, laissez-moi, je vous en pris, murmura-t-elle, sans chercher à se défendre.
Je t’aime, Jeanne. Laisse-moi t’aimer ?
Il la sentair qui s’énervait de désirs à ses chatouillements. Son cerveau brpulait. La posséder de suite. Elle s’agitait sur ses genoux et soupirait à son oreille. QUand il jugea le moment propice d’une futile résistance, il l’emporta sur le canapé et l’étendit sur le dos. Il se coucha sur elle de tout son long, chercha encore sa bouche, sa langue. La ceinture tomba sur le bois du meuble ; il retroussa les jupes, essaya de descendre le pantalon, mais celui-ci restait accroché au corset. Il ne put y parvenir, embarrant ses mains malhabiles et pressées dans d’innombrables lacets. Il se redressa pour voir plus clair, furieux de cet obstacle ridicule. Alors Jeanne se défendit vivement. Elle eut honte de se trouver ainsi entre les bras du jeune homme. Elle voulut se lever.
René, laissez-moi où je ne reviendrai plus ; je ne vous reverrai jamais.
Défais ces liens, Jeanne, où je les casse.
Vous êtes méchant, laissez-moi ; je vous en prie.
En voilà des ficellements extraordinaires. Jeanne, défais-les. Je vais déchirer.
Méchant, tu es méchant. Tu ne me reverras plus.
Allons donc, reprit-il, haussant les épaules.
Devant son air penaud elle se mit à sourire.
Fébrilement, il explorait les attaches et découvrait enfin l’épingle de sureté malencontreuse. Elle emprisonnait ses mains, le repoussait, remuait les jambes, le suppliait toujours. L’épingle roula sur le rapis. Le pantalon glissa découvrant un ventre blanc et ferme, la base ombrée de poils blonds.
De nouveau René se pencha sur elle, lui prit la bouche. Elle lutta avec ruse. Heureuse de demi-bonheurs, repoussant les ardeurs qui lui faisaient mal. Elle refusa de se donner. Ce fut lui le vaincu, qui chercha soudain sa bouche dans un spasme trop hâtif et vain, imprimant un « je t’aime » en une morsure sanguinolente. La jeune fille avait tressailli du bonheur de l’aimé ; elle l’avait serré fortement dans ses bras ; une sensation étrange la pénétra. Elle ne se débattit plus, l’approchant au contraire en attouchement plus direct, puis le berça de ses baisers pendant le repos qui suit la complète jouissance. Elle souriait heureuse, aimat de tout son coeur, ne se souvenait de rien. Son triomple de vierge ignora la pudeur.
Tu ne m’aimes pas, lui dit-il doucement.
Si, tu le sais bien.
Elle souriait. Une franche gaieté volutait de tout son corps. Ses deux bras la suspendaient câline au cou de son ami.
Mauvaise mignonne, vous reviendez demain ?
Peut-être… si je peux… attendez-moi
Il la redonduisit jusqu’à l’entrée de sa rue et lui envoya du bout des lèvres un baiser, alors qu’agile elle disparut.
A cinq heures le lendemain elle frappait à sa porte ; René s’empressa de la recevoir d’abord dans ses bras et de lui offrir un bouquet de baisers. Ils s’installèrent encore dans le grand fauteuil. Elle se laissa câliner sur ses genoux. Il renouvela ses caresses les plus curieuses, les plus passionnées. Puis il l’emporta sur le lit, en l’arche des rideaux. Près d’elle, il lui conta mille petites choses tendres, pendant qu’insensiblement il la déshabillait. Bientôt elle n’eut plus que sa chemise brodée à faveurs bleues. Les seins jaillirent hors la dentelle. Ils se cachèrent dans les draps. Leurs jambes se mêlèrent. Il appuya le corps nu de l’aimée contre le sien. Leur respir se confondit. La chair battait contre la chair. Elle lui répétait son amour, cherchait avec une ardeur insatiable sa bouche, sa langue caressante. Elle-même tendait sa poitrine aux suçons, tout son corps aux baisers avides. Elle s’offrit.
Quand il l’eut prise avec précausion des pleurs mouillaient ses yeux. René avant endendu ses cris étouffés de la souffrance du premier bonheur d’amour. Il la consola de sa tendresse.
Je t’ai fait mal ?
Oh ! oui, méchant.
Tu m’en veux ?
Non, mon loup. Je t’aime.
Elle devenait de plus en plus câline. Sa pudeur primitive était morte. Entre les doigts de l’amant elle savourait l’exquise sensation d’être choyée. La chair jusqu’en son intimité avait faim d’être pétrie. Ses lèvres connurent l’homme. Elle le voulait plongé en unlacis de caresses nouvelles, inaugurant une science inconnue qui s’apprend toujours une fois apprise.
Au tic tac de la pendule coulait leur calme érotisme, un érotisme enfantin d’une saveur plein de curiosité. Sept heures sonnèrent.
Déjà, s’écria-t-elle, je suis en retard. Tu vas me faire gronder.
Reste encore, Jeanne
Elle l’embrassa follement, lui mit le museau rose de ses seins sur les lèvres.
Dis-leur bonsoir.
Et elle s’habilla vite, passant vertigineusement, jupes, bas, corset, robe en un froufrou ravissant.
A demain, Jeanne
N’es-tu pas le maître, maintenant ?
Les draps traînaient. Des taches de sang semblaient des fleurs de cire rouge.
Elle rougit.
J’ai signé mon esclavage avec mon sang.
Chérie, je serai le meilleur des amants.
Et moi la plus gentille des maîtresses.
Bonsoir, Jeannette. Tu auras de jolis rêves. Vois-tu l’on est véritablement heureux lorsqu’on est débordé par la joie d’aimer. L’ennui ne vient jamais s’asseoir aux chevets de ceux qui s’attendent avec confiance. L’unique souffrance est que l’on juge trop bien l’inutilité de l’alentour.
Il la prit dans ses bras.
A bientôt. Je t’aime de tout mon coeur. Jeanne, il arrivera sous peu que je te conserverai avec moi. Nous habiterons ensemble. Nous aurons le jour et la nuit pour nous aimer.
N’en demandons pas tant. Mes parents…
Vouloir, c’est pouvoir. Qu’avez-vous à attendre d’eux maintenant, sinon la perpétuelle barrière à vos désirs, à votre amour, le tyrannique égoïsme du bourgeois qui défend sa fille aux appels légitimes de ses sens. Pour vous, la famille, c’est la haine, la rancune, la lutte insupportable, la mauvaise écurie que l’on doit fuir pour le palais du bonheur où l’hôte aimé vous attend les bars ouverts, aux sons des cloches joyeuses de la liberté. Les abandonner, c’est reprendre votre droit à la vie, élargir votre essor vers l’horizon du renouveau, c’est pénétrer dans le jardin embaumé d’ivresses, fleuri de caresses, sarclé d’espoirs, le jardin inconnu de votre âme que l’amour dévoilera à vos yeux éblouis, à votre coeur fasciné, en ses moindres détails, et vous y goûterez la paix céleste en entendant chanter les sources.
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
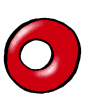
 Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.