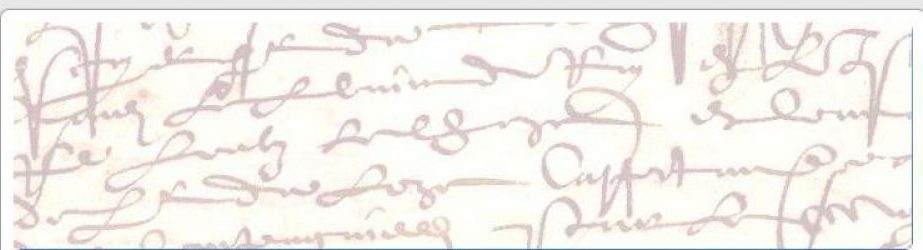Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
Vers deux heures de l’après-midi René alla rendre visite à son oncle paternel. M. de Lorcin, avocat de talent, bâtonnier de l’ordre, président d’une société de Saint-Vincent de Paul, et de beaucoup d’autres cercles catholiques, patriotes, d’études, habitait boulevard Delorme. Sa politique militante et autoritaire, jointe à une très sûre érudition lui donnait une influence considérable dans la ville. Le parti Catholique et réactionnaire le regardait, non comme un chef, mais comme son soutien le plus nécessaire. Son besoin de calme pratique ne lui aurait jamais permis de se mettre en tête d’un groupe par trop agité. Fait d’un seul bloc, il respectait ses croyances comme sa vie, n’avait qu’une ligne de conduite : le devoir. Qu’était son devoir ? Pour lui l’obéissance indiscutable à la foi de ses aïeux. Au premier rang à toutes les fêtes religieuses, il suivait le dais aux processions, et méprisait carrément ceux qui ne pensaient pas comme lui. Sa femme, aussi rigide que son mari sur les principes religieux, passait une partie de sa journée à l’église ou dans des réunions pieuses, l’autre dans la surveillance tyrannique de son personnel. Jamais grâce d’un mot grossier, d’une allusion légère, cerbère inquisiteur de l’accomplissement des rites « chez des catholiques, disait-elle, nul n’a le droit d’être impie. » Quoique mariés tard ans amour, ils s’aimaient par devoir, fidèles par devoir à loi la conjugale. Jarretière égoïste et utilitaire qui les ceint d’une honnêteté bien pensante, éminemment respectable et respectée.
En arrivant sur le boulevard René fut douloureusement surpris. Au lieu de la lointaine et splendide voûte aux doigts fluets que formaient l’allure hautaine des arbres géants entrelaçant leurs innombrables arceaux, c’était une allée somnolente d’idiotisme avec son asphalte au centre comme un cordeau écrasé, bordée d’embryons arborescents emmaillotés dans des grilles mal équilibrées. Où l’ombre quiète des feuilles d’automne versait ses caresses moites, la crudité quelconque d’une place de marché avec de rachitiques nourrissons à la couvée. A l’entrée, La statue du docteur Guérin qui doit être étonné d’avoir un tel monument à sa gloire bourgeoise ! Et maintenant que les grands arbres sont morts du venin de la meute épicière, il domine sa taille sombre en sa redingote vénérable.
Quelle raison indispensable avait pu pousser les édiles de Nantes à cette sauvage battue ? René tourmentait encore son cerveau lorsqu’il sonna à l’hôtel de son oncle. Un garçon en livrée vint lui ouvrir et le fit entrer au salon. Une vaste salle encombrée de meubles et de tentures indifférentes dans leur couleur sévère malgré leur richesse. M. de Lorcin arriva presque aussitôt. Grand, fort, la barbe grise, il se montra très affable.
Il lui demanda des nouvelles de sa santé, où il habitait.
M. de Lorcin poursuivant une idée l’interrompit.
Il désignait toujours ainsi avec une moue de dédain le mari de sa soeur.
Les deux hommes ne pouvaient se sentir. Cette haine venait de leurs divergences d’idées, et, aussi d’une sourde rivalité de puissance. M. Réchamps, l’armateur, libre-penseur et socialiste influent, était le chef d’un nouveau parti en voie d’augmentation. C’était le terrain qui tremblait sous les pas de la réaction alors maîtresse de la ville. M. de Lorcin aurait bien voulu empêcher son neveu de l’aller voir, mais comment ? René voudrait-il embrasser une haine sans raison pour lui envers un oncle qui l’affectionnait beaucoup.
Interloqué par cette brusque question René qui savait répondit vexé.
Il se leva pour écouter à la porte. Un bruit de pas se fit entendre.
A l’apparition d’une longue femme roide, vieillie par des bandeaux grisonnant à ses tempes, René se leva et tendit, respectueusement le front au baiser obligatoire.
Elle s’installa dans un fauteuil et se penchant vers son neveu l’accabla de mille et une questions, lui donna mille et un conseils qu’approuvait du bonnet son époux. Déclarant se substituer à sa mère, elle lui traça minutieusement le genre de vie qu’il devait avoir, les vertus qu’un jeune homme chrétien devait ouvertement pratiquer. La rengaine de l’oncle redite d’un ton plus sec, avec plus de précision dans les mots. Mme de Lorcin ne mâchait pas ses paroles.
Pour voir plus vite la fin de cette insipide énumération, René acquiesçait à tous les désirs de sa tante. Celle-ci satisfaite se mit à lui parler du passé, de sa famille, de sa carrière future, de ses aspirations. Sur ce sujet la conversation dura longtemps.
René fut fort enchanté lorsque son oncle lui donna congé par ces mots :
Au moment de partir René se souvint de la tonte ridicule du boulevard.
René descendit la rue Franklin. Commençaient déjà à se vomir des rues Scribe et environnantes le monde criard des trottoirs. Ce quartier leur appartenait comme autrefois les Juifs étaient parqués alentour la rue de la Juiverie. Elles préparaient leurs engins de chasse autorisée dans les brasseries et les principales rues. Hardi les vautours clairs A.G.D.G. Les imbéciles s’émerveillent ; les mâles s’incendient !
René franchit la place Graslin ombrée de son théâtre aux huit colonnes, traversa d’une extrémité à l’autre la rue Jean-Jacques Rousseau, étroite et raide comme un manche de parapluie. Place de la Bourse avec sa couronne d’arbres et ses saltimbanques de passage entourés de badauds en guenilles, Il regarda l’horloge marquer cinq heures. Longeant le monument, il arriva sur la place du Commerce.
Un tintamarre indiscontinu assourdissait les oreilles. Les lourds camions résonnaient brutalement sur les rails enchevêtrés des tramways. Ceux-ci, guêpes fauves autour de leur kiosque central, bourdonnaient et toussaient à qui mieux mieux. La voix des employés fléchaient : Les voyageurs pour Rennes, en voiture… La Bourse, tout le monde descend… Pirmil… place Mellinet.,.. Doulon, en voiture ! … Les sifflets piaillaient ordonnateurs de la volée éparpillante. Les vendeurs hurlaient les journaux du soir, les jouets d’enfants, l’indicateur des chemins de fer. Sur la ligne qui coupait le quai, les trains passaient brassant du vacarme. C’était certes la place la plus mouvementée avec sa ceinture de hautes maisons : — du Phare de la Loire, un des grands journaux quotidiens de Nantes projetant ses rayons sur toutes les branches du commerce et de l’industrie, le palais de la Bourse figeant l’heure à sa paupière rigide — qui se mourait jusqu’au fleuve d’or brun.
René rencontra son oncle dans le couloir de son appartement.
M. Réchamps, petit, sec, pétillant, quarante ans, prit le bras de son neveu. Il entama une conversation alerte. René lui raconta sa visite chez M. de Lorcin, les conseils salutaires de l’oncle, le catéchisme de la tante.
En devisant ainsi, ils arrivèrent sur le pont de l’Écluse.
Resté seul René s’accouda à la balustrade. L’écluse grouillante et moqueuse grondait, vomissant le long des pilotis et des vannes des jets de salive blanchhâtre. Interminable déroulement d’une pièce de satin bouillonnée de plis et de replis chatoyant d’un blong diapré. Les énormes chalands heurtaient du front les portes qui s’ouvraient en grinçant des dents ; ils descendaient lentement et lentement leur voyage du même pas têtu. L’amas des pourritures de l’Erdre venait entremêler ses charognes crissant des odeurs saturées d’infection. Toujours des spectateurs s’arrêtaient devant ces tourbilIonnances affolées, là, ainsi que des intrigues que nuI passant ne peut dénouer. Lorsque M. Réchamps revint, ils montèrent en ensemble la rue de Feltre et la rue du Calvaire. Des bouffées de musique balayèrent leurs oreilles des portes entrouvertes du café Riche.
Ils s’installèrent sur les coussins d’un angle libre pour être plus à l’aise et mieux observer.
Le café était comble. Les lumières croulaient vers les visages attentifs et la pâleur des tables de marbre. Les consommations reluisaient des princesses naïves bariolées dans un bal où la toilette verte des absinthes se reflétait dans les manteaux grenats ou jaunes des sirops. Sur un piédestal improvisé, l’orchestre raccrochait des lambeaux d’art au passage. Les femmes en blanc lilial avec des ceintures à gros nœuds ; leurs yeux agrandis sous les fleurs isolées d’un parterre de chevelures. Des hommes, quelconques, plongés dans un hébétement sournois. Les bourgeois écoutaient suffisamment silencieux, les valses de Waldteufel ou les fantaisies de Faust et des Huguenots, satisfaits davantage de l’exhibition des femmes sur un tréteau — proie facile à la curiosité de leurs regards secrètement pornographiques. A la fin de chaque morceau, elles passaient entre les groupes une assiette en main ; ils allaient de leurs gros sous, payant la jouissance de se sentir frôler par les corps des dames. Le fruit défendu qu’ils évoquaient en la fumée des cigares et la mousse des bocks, qu’ils rêveraient à la sortie. Un peu d’animalité pure que le voisin ne trahira pas, qui crève à la surface au contact peureux des qu’en-dira-t-on.
Et le vieux là-bas qui roule des yeux cuits sur la blonde violoncelliste ?
L’orchestre entamait la « Mousmé » de Ganne. Les groupes se levaient ; la salle devenait vide. Le rythme se débilitait au milieu des heurts des tables et des chaises,
Ils décrochèrent leurs chapeaux.
Mme Réchamps embrassa franchement son neveu et son mari sur les deux joues Très heureuse elle s’agitait, de la cuisine au salon, gourmandant d’une voix gaie les domestiques. Un couvert fut vite préparé et l’on se mit à tables
René était joli, la figure peut-être un peu efféminée avec ses yeux bleus. Il était le portrait de sa tante, sosie de la mère de René, à tel point qu’on les prenait souvent l’une pour l’autre.
Leur mariage était heureux malgré les tentatives de la famille des Lorcin. Depuis cinq ans d’intimité, ils s’adoraient loin des craintes pusillanimes des prudes et des tyranniques railleries des jaloux. Pour assurer la plus parfaite concorde, Mme Réchamps avait adopté les idées de son mari. Comme lui, elle croyait à l’avenir proche d’une justice morale vraiment, juste, basée sur l’égalité et la fraternité des riches et des pauvres. La science mise à la portée des humbles bannissant la charite humiliante remplacée par le partage légitime du frère à frère.
Elle encourageait l’armateur aux minutes de déception, calmait des colères inutiles, le soutenait de son sourire aimé dans sa lutte pénible contre la routine aux abois.
Quoique-loin de partager les théories du socialiste, René se plaisait à l’entendre parler, goûtant de profondes vérités en ses diatribes humanitaires.
Aussi le dîner fut-il très gai. Salade de plaisanteries compliments, de littérature, politique, faits, et maintes pointes aigus à l’adresse du bâtonnier. L’oncle parla, avec enthousiasme de ses chantiers où vivait une ère nouvelle de solidarité. Son œuvre à lui, ces hommes qui s’aimaient et s’entr’aidaient aux labeurs quotidiens le coeur fier d’être les collaborateurs conscients du mouvement de la machine sociale ! Ses ouvriers étaient ses meilleurs amis. La haine ne couvait pas sous les marteaux contre le patron. Sur ce pivot de granit, il rassemblait ses forces de défi. Au printemps prochain, je lancerai mon trois mâts « l’Hercule ». Tu seras de la fête, René. On ne le baptisera pas. Pas de prêtres, pas de parrains, sept cents pères orgueilleux comme aux premiers pas d’un bébé. Çà fera une histoire dans le ban et l’arrière-ban de la cléricaillerie. Ils hurleront au blasphème.
Ses yeux brillaient d’une volonté têtue. Donner un formidable coup à l’accomplissement de son rêve !
Après le dîner on passa au salon attendre les Lon¬neril. Ils ne tardèrent pas. Maigre et petit, M. Lonneril était vêtu simplement, l’oeil sournois, peu loquace. Il semblait un nain auprès de sa corpulente épouse satisfaite de sa vaste personne ! La demoiselle, une gentille blonde mise avec élégance, coquetterie même prétentieuse.
Les présentations d’usage terminées, René s’offrit de chanter. Il se mit au piano et exécuta une de ses ballades, — musique heurtée, discordante parfois, paroles étranges au rythme curieux.
Le thé fuma dans les tasses. La vapeur cerclait leur cou de boas grisâtres. Les friandises se passaient ; les dents mordaient les chairs sucrées.
René s’empressait alentour Mlle Lonneril. Galant, il la félicitait du charme de sa toilette, de ses yeux tendres, de ses dents blanches. Il accompagna comme une caresse la romance sentimentale qu’elle voulut bien roucouler. Au milieu des minauderies, on fit une partie de cartes. René tricha pour faire gagner sa mignonne voisine, à la virulente indignation de Mme Lonneril, qui ne comprenait ni la perte, ni la triche. René ne lui plaisait pas. Des manières en dessous. Les hommes causèrent politique, les dames jasèrent de modes, abandonnant les jeunes gens. Ils en profitèrent pour augmenter leur connaissance. Ils fouillèrent les replis secrets des délicieuses futilités, feuilletèrent pour se les conter les naïvetés roses qui se disent aux, heures demi-familières. René éblouit la petite de son érudition louangeuse nuancée de mi-rires. Au départ, ils se serrèrent la main lentement.
René, à l’ombre de la Cathédrale qui semblait médire sous la clarté goguenarde de la lune, rêva d’yeux et de blonde-allure un peu prétentieuse.
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.