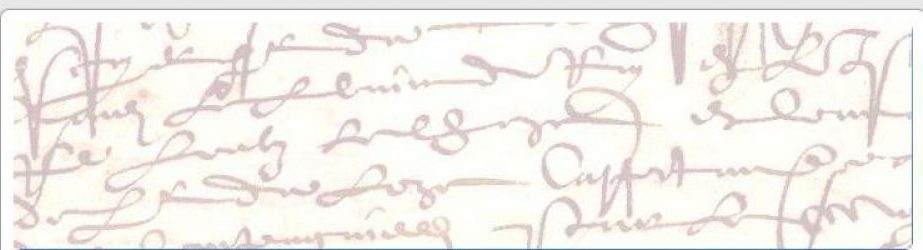Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
Le mois de mars s’éclipsait derrière le paravent du passé avec son attirail d’hiver. Le soleil montait plus haut dans le ciel, versant plus à pic ses mille flêchettes brûlantes, et comme un soupir de gai soulagement se dilatait en la ville.
On était au samedi quatre avril. Le lancement de l’Hercule dans les chantiers de M. Réchamps devait avoir lieu vers quatre heures. René s’y rendit à pied le long de la Fosse.
Le quai grondait du cahotement des va-et-vient. A l’entrée la maison des Tourelles où fut signé l’édit de Nantes pointait ses deux cônes. Tranquillement, en promeneur qui n’a pas les minutes à compter, René s’acheminait sous les arbres de la promenade de la Bourse devant l’embarcadère des Abeilles. L’ouverture des pontons est diadémée d’un croissant bleu à lettres blanches. Ou c’est un coquet pavillon en briques rouges près duquel soufflent doucement les naseaux des Abeilles corsetées de clair. Depuis la gare de la Bourse jusqu’au Bureau du port des files interminables de linges séchaient au courant de l’air. Les remous de bâteaux à vapeur flêchaient de la la bave laineuse aux flancs des lougres et des canots au repos.
L’alignement des maisons bloquaient d’infinissables yeux. Au ras du trottoir les iris se multicoloraient de boutiques en buvettes. Au fond des orbites colorés causaient des cordiers ou buvaient des marins jargonnant en langues étrangères. Des stridences dures de cornes à chaque instant. Sobrement, des vieux cassés tiraient des chaînettes de chaque côté des rails. Un train passe à pas comptés, renâcle ; la bielle fulgure. La fumée se perd dans des arbres étiques, sur les toitures malpropres des hangars où s’adossent des signaux rouges et blancs.
Labyrinthal enchevêtrement des rails, de becs de gaz isolés comme des piqûres de voile, de poteaux télégraphiques – étagères à bonnets de coton, – de piles colossales de sacs, des caisses entre lesquelles cerclaient les camions, les chevaux dolents tiraillant les wagons poussifs, des barriques aux culs verts ou rouges alignées.
Alentour, les mains derrière le dos, flegmatiquement les douaniers, les débardeurs en blouses bleues, culottes grasses, les rentiers fumant leur pipe ou digérant.
D’énormes bâches noires goudronnées calfeutrent les membres jaunâtres des planches. Les ventres gris des bidons de pétrole. Abcès sombres dans les gencives du quai. Parmi la dureté de l’ambiance, une petite guérité égaye sa robe blanche à rayyres bleues, près d’une panoplie-écriteau encadrée de crocs, – de la société des Hospitaliers sauveteurs bretons. Sur les blocs de fonte, quartiers de momies formidables, des voyous battent une manille. Dans les wagons vides, les enfants rajeunissent le port de leurs ébats.
Les curieux, le nez en l’air, s’ébaubissent devant le pont transbordeur qui s’achève peu à peu. Son premier pylône est complètement terminé depuis le mois de novembre, le second fiit de grandir à son tour, et la rue, au sommet, le doigt en l’air, semble vouloir sans cesse monter plus haut, orgueilleuse de toucher le visage du ciel. Les hommes travaillent dans les replis des tiges de fer, semblables à d’infimes araignées tissant une toile inextricable.
Plus loin, l’église Saint-Louis en un renfoncement cligne de l’oeil un bout de quai ; l’ange de sa flêche ferme les ailes sur le dôme en boule de billard. Le passage du Sanitat, curieux par sa voûte louche, protège le simple commerce d’une marchande de pommes de terre frites.
Scellés au port par d’énormes amarres nouées, les navires ont replié les ailes du voyage. Les cheminées luisent comme des fleurs brutales au travers le réseau des mâts échevelés de cordages. Tout contre figées, les grues impassibles semblent lever des bras épouvantés. A l’arrière, à l’avant, sabrent la vue les noms internationaux ; quelques drapeaux flottent.
Là bas, en face des Entrepôts de la Douane, cloportes sombres accoupis dans la boue nécessaire, au frontal perlé du titre en lettres d’or, le déchargement du sucre s’opère avec animation. Les chaînes grincent, decendent en plein estomac d’un vapeur, extirpent un à un les barils – ils pendent en l’air comme des gros crabes – les reposent sur le quai. Ils sont roulés, bousculés ; les hommes s’acharnent ; la fourmilière s’accentue ; la fumée même son ombre sur les visages. Puis ce sont des gures à bras que cinq manoeuvres tournent.Les crémaillères des roues craquèlent à chaque effort. Et les charges lentement s’élèvent, boulant une tâche sur l’horizon pur.
Au-dessus, l’horloge des docks veille, fixant irrévocablement la mesure du temps. Son ordre va plonger au-delà du fleuve dans les chantiers de constructions navales, où les poutres érigent un gigantesque jeu de quilles. Des houles invisibles passent en grondant un bruit terrible d’enclume. La chanson du fer s’attendrissant aux doigts de l’homme. La coque d’un bâtiment inachevé semble un saumon énorme resté prisonnier entre les pieux.
Des estacades étendent leur ratelier à l’entrée du port. Les dragues tournoient leurs seaux vaseux. Les remorqueurs, traînant une flotille plurale de chalands, brutalisent l’eau tranquille à coups d’hélices. Les chaloupes tendent leurs voiles de couleur. Les yachts fusent le nez dans l’écume. Un lougre cheche une place. Incessamment bourdonnent les bateaux-omnibus entre Nantes et Trentemoult.
Après la rue montante de l’Ermitage, bornée de rochers, l’escalier aux cent marches élargie à sa base ses perrons réguliers dominés parla statue de Sainte-Anne, le bras levé, hautaine de bénédictions sur l’ensemble du port de Nantes.
Un formidable chaos bout dans le crâne du jeune homme, à l’étalage de la vie sanguine de la ville. C’est là que l’on bat la pâte de l’alimenation où puisent les intestins de la Cité. La flotte fluctueuses des fumées d’usines gonfle ses voiles au souffle des haleines du travail. Nantes, immense entrepôt de denrées coloniales pour le bassin de la Loire ! Nantes, parterre colossal d’usines métallurgiques, de raffineries, de savonneries ! Nantes, poitrine volcanique de triturations à charbons ! Nantes, épopée de l’outil, de l’industrie, du commerce ! Nantes, la véritable assoiffée du matériel, de l’utilitaire, du broyage perpétuel ! Nantes, qui s’entend seulement vivre par le bruit des treuils sur son port, son port que fauchent les mats en fête, que colore le halêtement des charrues du fleuve patiemment poussées par les hélices frondeuses. Les sirènes s’appellent, se répondent. Elles se comptent ; les poitrails sont hors de l’eau. Génisses énervées attendant l’assaut du mâle ; la carène s’assouplit pour le choc d’amour. Il passe un long frisson comme l’aile d’un albatros ivre de vin. La cuve déborde de sève épaisse, de chyle résorbant, d’un chrême luxuriant. Les déchets créent la vie, la cie crée les déchets. Tour à tour dans le cercle fatal écolue la transcormation des choses, le rite sacramental de baptême et d’onction. C’est Nantes qui s’accouche perpétuellement d’elle-même par la fécondation incessante de son gigantesque port.
Les chantiers Réchamps grouillent en habits de fête. Le patron serre la main de ses ouvriers qu’il félicité chacun son tour. Et ils sont eux aussi joyeux à l’ombre du titan que refrènent de larges langes de bois et d’énormes ceintures de fer.
René est là. Il vient de présenter ses hommages à la famille Lonneril. La jeune fille a sur lui attaché son oeil clair tintant d’un simple reproche. Il n’a pu soutenir intrépidement ce regard. Cependant il eut le vertige doucereux d’un symptôme de paix atterrissant à son âme.
L’heure approchait du navire allant plonger ses flancs vierges dans la vulve éclaboussante de l’onde. Ayant sa femme au bras, M. Réchamps filt le tour du pont, attacha lui-même un bouquet rouge à la proue, puis le plus ancien des ouvriers hissa le drapeau rouge à la poupe. Et le maître parla. Il parla chaleureusement de fraternité profonde, d’égalité cordiale, d’union ineffritable. Il combla les coeurs d’espoirs, de bonheurs pacifiques. Son geste superbe semblait dessécher le lac qui les séparait du parfait domaine de justice, ses yeux poindre un horizon ensoleillé du cantique triomphal des travailleurs et des déshérités. Sur le silence respectueux et enthousiaste de la foule sa voix fripait des froufrous d’âmes réconfortées. Les coeurs s’élargissaient d’aimer ; les poings se serraient pour la lutte malheureusement imminente. La petite taille de l’amateur grandissait infiniment au choc des mots métalliques dont les étincelles emflammaient les autours. Sa main désignait la Ville. La Ville lointaine, un âté de toits moulés dans la gélatine grise, un volcan sourd où grondaient des laves d’idées contraires ; la Ville comme une citadelle à conquérir, un quartier malsain à pacifier de l’égoïsme et de la routine, une terre à défricher des mauvaises herbes de l’envie et de l’orgueil, pur y semer la bonté et la fraternité. Sa main leur montra le fleuve mousseux d’or et d’argent, la fiere brute qui ne supporte aucun obstacle, dévore les arbres, les navires et les hommes ; le fleuve qu’ils allaient dompter une fois encore à l’aide de leur travail commun : l’Hercule. Son hélice éperonnait l’au rageuse, soumise malgré sa force. Le Fleuve vaincu, au tour de la ville. Puisse l’Hercule porter un jour – précieuse comme un diamant – la victoire drapée dans les plis pourpres de leur flamboyant drapeau :
Des centaines de poitrines entonnèrent une ovation cordiale à l’armateur. Tous regardaient leur travail avec orgueil. La joie d’avoir mis la main à une oeuvre fraternelle et d’émancipation future les faisait acclamer l’homme qui les commandait, l’homme qui se dévouait pour leur cause, qui leur offrait leur formidable exécution, sa conception, sa pensée, lueur rouge de ralliement, bélier tranchant de l’avant-garde, pivot défiant les assises ancestrales du capitalisme. Et quand la masse descendit, faisant flamber les poutres à son frottement, le nez coupait les plèvres de la Loire, chassait l’eau loin derrière lui, l’écume ballonnait alentour, lasse d’une lutte désespérée entre le fleuve et le navire. Illeur parut être le conquérant d’une première bataille et se reposer sur les flots comme un guerrier las sur le champ de ses exploits. Les maisons de Tretemoult s’estompaient de brume, le port s’emmaillotait de brouillard, les grues surgissaient pareilles à des machines de guerre qui sèmeront des cadavres au lever de la lumière, les navires échelonnés le long des quais se transformaient en colossals canons, gueules bées, attendant le signal pour vomir la mort, les maisons repliaient leurs manteaux, fortifiaient leurs façades. Tout était gris, terriblement gris, symptôme de combat. Et l’Hercule impassible se dandinait, sa silhouette allongée démesurément sur le crépuscule.
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.