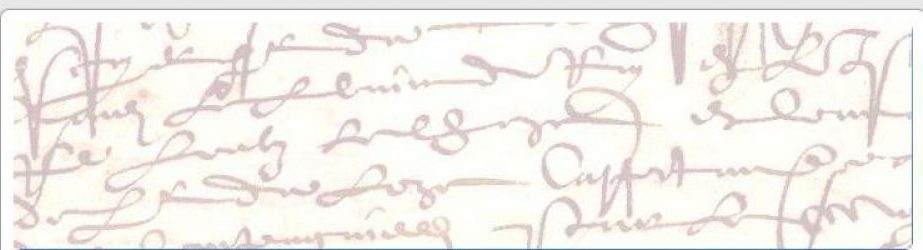Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
A sa fenêtre, René fouillait la foule qui s’acheminait à l’appel des cloches vers la cathédrale. L’air était d’une pureté remarquable pour la ville. Le soleil se bouffait d’or en la porcelaine bleu-ciel. Ainsi, chaque dimanche, il attendait Mme Lonneril et sa fille se rendant à la grand’messe. Il surprenait un sourire de son aimée. Ces jours maudits, il ne pouvait lui parler autrement.
Or il arriva qu’en cette matinée de mai, Melle Lonneril se rendait seule vers l’église. Elle salua moins discrètement le jeune homme avant de franchir la porte monumentale qui se croûtait.
René attendit quelques instants, puis, quand la place redevint claire et blanche de lumière nue il descendit et pénétra à son tour dans St-Pierre. Melle Lonneril était assise à l’angle d’un pilier. Se doutait-elle qu’il allait venir ? A chaque son du battant de la porte, elle détournait la tête. Ils se sourirent sous le regard banal du Suisse doré sur tranches. Il lui fit signe de sortir. Elle obéit.
Chez René.
Il offrit des bonbons.
Elle sourit tendant ses lèvres au gourmand.
Elle baissa le tête. Il s’assit sur ses genoux, se fit câlin.
Elle hésitait, mais ile en dit et en fit tant et tant qu’elle accepta. Ils allèren déjeuner au restaurant. Une voiture les prit à la porte pour les conduire aux courses.
Les boulevards s’ensoleillaient embrouillés du vol des poussières. Les coups de fouet stridaient comme un flot de mouettes qui s’ébattent. Les automobiles cornaient ; leur passage semait des éternuements saccadés. Les bicyclettes glissaient légères ainsi que des abeilles qui bruissent. A la queue leu leu, un indéfinissable ruban d’aune en aune sous l’ombre vaine des arbres grisonnés des pellicules de la route.
Les piétons arrivaient par bandes noires pailletées des spirales claires, vomis par tous les boulevards qui environnent le Petit-Port. Un joyeux enthousiasme mène les groupes ; les uns chantent, les bébés s’amusent, les amoureux s’embrassent, nul n’y fait attention. Des grues harnachées d’oripeaux éclatants se font huer le sourire aux lèvres. Et les chiens se poursuivent joyeusement entre les jambes.
L’immense fourmilière sortie de Nantes a traversé sans obstacle les voies larges et spacieuses, franchi l’étroite rivière du Cens, escaladé la butte du champ de courses, et là, s’arrête, s’entasse devant les barrières qui fixent la limite de la piste. Le flot s’accumule sans cesse, se gonfle en un circulaire bourrelet, enlaçant l’arène d’une ceinture infranchissable. Les tribunes prises d’assaut reluisent de miroitements féeriques ; les pelouses sont piétinées. Les joueurs sont là, bavards ou silencieux, souvent grotesques, possédés de ce mail ridicule du jeu imbécile.
Dans l’hyppodrome les voitures se promènent sur le ventre blanc du sol ; des cavaliers galopent. En des rais de lumières ils sembles des pantins de théâtres d’ombres. La piste fourrée d’herbes est envahie devant les triunes où des dames étalent fièrement d’insignifiants tickets rouges, comme des hochets de grandes maisons, où les lorgnettes agitent leurs yeux convexes.
Le signal se hisse au poteau ; la piste se purifie. Les chevaux font leur entrée, montés par des jockeys aux couleurs brillantes et fantaisistes. Les magnifiques animaux déploient leur beauté ferme, leurs formes supérieures comme une étoffe splendidement ouvragée. Ils partent s’aligner dressant fièrement la tête, hénnissant d’orgueil ou d’éblouissement au soleil qui les salue d’une pluie d’or. Soudain ils partent, découpant leurs silhouettes sur l’horizon bleuté ; derrière les arbres les casaques des jockeys sèment des éclairs ; parfois butant, s’écroulant, sautant d’un élan les fossés et les haies, pour arriver au but les naseaux en sueur, la crinière flottante, écharpe de triomphe ou de dépit. La foule hurle, trépigne ; les fantoches humains sont mis en branle et la comédie ne s’arrête plus. Mais la closhe a tinté, la musique joue des morceaux que le vent emporte par bribes dans sa dorne. L’attente sable les allées de la patience et nivelle les enthousiasmes passés.
Entre les épreuves, les ombrelles blanches versent des points joyeux sur la foule. Les dames passent re repassent des lignes de clartés dans les chemins d’ombres des hommes. Dans l’enceinte du pesage les chevaux obéissent, rêveurs, aux ordres des jockeys. Leurs yeux ovales sont emplis d’un monde étrange que l’on ne comprends pas, où parfois passent des lueurs brutales. Adoration de la bête dont l’homme se fait l’humble servant et dont il se parera la gloire : le geai volant toujours les plumes du paon. L’animation la plus diverse règne dans le vaste hémicycle du champ de courses où le soleil se mire orgueilleusement.
Nonchalants en leur landau, Jeanne et René souriaient au bonheur d’être l’un près de l’autre à la face de tous. Il gardait la main de son amie dans la sienne ou tenait galamment son ombrelle. Ils se moquaient des regards ennemis qui les cinglaient à des carrefours de haine. Heureux, ils triomphaient. Le landau de l’amour victorieux écraisait les pierres de l’envie avec une suprême indifférence.
Lorsque le soleil eut presque fini sa promenade d’après-midi, le départ commença. Les voitures prirent à la fille le long des boulevards bordés de curieux. De rares attelages éblouissaient ; quelques toilettes extravagantes ; des horizontales, la nuque sur des coussins, étalaient leurs oripeaux réclames. En réalité, une effroyable banalité que cette procession de chevaux de camion et de rosses de fiacres, que cete suite trop longue de voitures quelconques, bondées de personnes quelconques. Mais il est une coutume à laquelle les bons nantais s’en voudraient de manquer : voir le défilé des courses. Le long de la route de Rennnes, des badauds installent des chaises sur les trottoirs ; ils regardent placidement pendant deux heures, le bruit, le roulement, avalant la poussière, s’ahurissent d’une attente ridicule. Les aubergistes ont dressé des tables qui se garnissent rapidement de buveurs. Le vin blanc coule à flots, le « gros plant » et le « muscadet » de la Loire-Inférieure aussi émoustillants qu’une chaude fille du midi. De ses dernières lueurs mourantes le soleil semble emplir les verres bas de joyeux écus d’or.
La voiture de M. de Lorcin, l’avocat, avait croisé celle de son neveu. René avait compris une colère terrible dans l’âme de son oncle, et il lui avait railleusement souri. Aux abords de la rue Noire, M. et Mme Lonneril longeaient tristement le trottoir. Ils baissèrent la tête, honteux au passage de leur fille. Jeanne ne les vit pas. Seul René avait eu, une seconde, quelque pitié pour ces braves gens, puis il haussa les épaules avec dédain. La voiture arriva au Pont-Morand, gravit la rue de Strasbourg encombrée. Le crépuscule venait attirant son couvre-chef sur cette journée ordinaire et sempiternelle des courses. Les courses de chevaux que petits et grands vont contempler béats, comme une merveille intéressantes, pour s’emplir les yeux quelques secondes du galop d’un animal inconnu pour le bénéfice d’inconnus… Résumé : ce sont les tramways qui mangent le refrain des rengaines.
Un exil que j’envierais pour vous avoir toujours seule à mes côtés. Sois gentille, ma petite Jeannette, reste cette nuit, tu réfléchiras mieux demain. Nous nous aimerons librement pendant le sommeil de la terre, en le silence calme de la nuit. J’écouterai le tic-tac de ton coeur battre les minutes d’amour en baisant ton sein gauche. Laisse-moi dénouer ta ceinture, défaire ton corsage, laisse-moi arracher les épingles de tes cheveux, noyer mes doigts dans tes tresses blondes. Tais-toi, mon aimée, je veux te dévêtir moi-même, ôter les bandeaux qui me cachent ton corps… Je connais par coeur le maquis de tes lacets… Tu te souviens la première fois comme j’étais maladroit… Tes petits seins, je les embrasse tous deux… Un corset, c’est vite décrocheté… Qu’ils sont blancs tes pieds… Je les embrasse aussi, là, sur les ongles, sur les chevilles;.. Aussi tes genoux… Ta chemise, elle est jolie, mais trop difforme pour ta chair. Que je t’aime… Si je pouvais encore te mettre plus nue… Je te veux vite… tout entière… Approche-toi… les draps nous cachent… Tes lèvres… ta langue… enlace-moi… Entrer en toi… t’aimer… Jeanne sens-tu l’amour venir nous éblouir… Je t’aime…
Des soupirs, doux comme des plaintes, se bercèrent en les rideaux, entr’ouvrant l’alcôve aux pas mystérieux du rêve des amants.
: chapitre 1 : le brouillard – 2 : la ville – 3 : la batonnier et l’armateur – 4 : le peintre – 5 : le clan des maîtres – 6 : rue Prémion – 7 : labyrinthe urbain – chapitre 7, suite – 8 : les écailles – 9 : emprises mesquines – 10 : carnaval – 11 : le cul-de-sac – chapitre 11 suite – chapitre 11 fin – 12 : les portes de Neptune – 13 : Cueillettes d’avril – 14 : Moisson d’exil – 15 :
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.