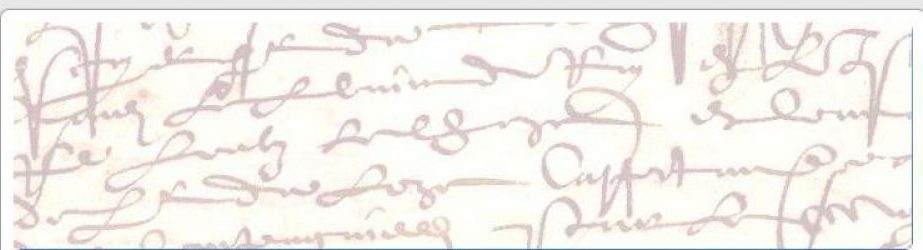Le contrat de travail était verbal ! En outre, manifestement il prévoyait un salaire plus élevé que la moyenne, puisqu’il est qualifié de « haute paye ».
Et pour compliquer la chose, l’ancienne coutume de la fourniture semble persister et on compte donc 1 060 ardoises par millier, ce qui s’appelait la FOURNITURE.
Mais, ici, on voit déjà des étrangers acheter des entreprises françaises, et bousculer les salariés !
Le 3 juillet 1867 audience civile du mercredi 3 juillet 1867 entre le sieur Chasseloup de Châtillon, propriétaire demeurant à Segré, défendeur au principal et demandeur en garantie ayant Me Louis pour avoué, et 1 – le sieur Louis Desmas, carrier à la Gatelière, commune de Noyant la Gravoyère, demandeur au principal ayant Me Gatine pour avoué, 2 – le sieur Anthoine, propriétaire à l’Isle Jersey, défendeur en garantie, ayant pour avoué Me Réveillard
Le tribunal, parties ouies à l’audience du 25 juin dernier, la cause ayant été renvoyée à ce jour pour statuer, après en avoir délibéré, considérant que la demande de Desmats contre Chasseloup de Chatillon à deux chefs distincts : l’un, principal, tendant à la condamnation du défendeur à des dommages intérêts à fixer par experts, pour inexécution volontaire, depuis le mois de novembre 1866, de la convention verbale du 25 juillet 1862, caractérisée au jugement de compétence du 28 mai dernier ; l’autre accessoire, tendant à la condamnation de Chasseloup de Chatillon, au paiement de la différence entre le prix que Desmats a touché et celui qui, selon lui, aurait dû lui être payé pour les ardoises qu’il a fabriquées du 29 octobre 1864 au mois de novembre 1866, ardoises qui lui auraient été comptées à 1 060 le millier, tandis qu’elles auraient du l’être à mille ; sur le chef de la demande de Desmats ; considérant qu’il est reconnu entre parties que sur la convention verbale du 27 huillet 1862, il avait été stipulé ceci : que si Desmats entrait à travailler à la carrière de Misangrin, il serait rétribué comme suit : pour la première année 12 francs du mille de toute ardoise qu’on lui donnerait à faire, pour la seconde année 11 franfs et pour les années suivantes 10 francs ; considérant qu’il n’apparaît pas que, soit pendant qu’il était propriétaire de la carrière de Misangrin, soit depuis la vendue à une Compagnie Anglaise, Chasseloup de Châtillon ait jamais nié, en principe, l’obligation résultant pour luy de la clause précitée de payer ou de faire payer à Desmats la haute paie convenue, si celui-ci continuait à travailler comme ouvrier à la carrière de Misangrain, qu’il s’agit seulement de savoir si le défendeur à cessé, à une époque quelconque, de remplir son obligation, après avoir été régulièrement mis en demeure de l’exécuter ; considérant qu’il est reconnu par Desmats que jusqu’au mois de novembre 1866, la Compagnie Anglaise a tout à coup refusé d’en agir avec lui d’après les anciennes manières, mais que ce fait est formellement dénié par Chasseloup de Châtillon ; considérant que c’est au créancier qui se prévaut de l’inexécution de l’obligation pour demander la résiliation du contrat et des dommages intérêts à justifier de la mise en demeure du débiteur et de l’inexécution qui sert de base à sa demande ; alors surtout que l’obligation a été remplie pendant un laps de temps considérable tant par le débiteur lui-même que par un tiers agréé par le créancier, et que l’inexécution subséquante alléguée serait un fait nouveau qui ne doit pas se présumer d’après ce qui a eu lieu jusque là ; considérant que Desmats ne prouve ni n’offre de prouver d’ancienne manière, qu’à dater du mois de novembre 1866 la Compagie Anglaise de Misangrin auroit refusé de continuer à l’employer comme ouvrier à 10 francs le millier d’ardoise et qu’à la suite de ce refus le demandeur ait mis Chasseloup de Châtillon en demeure d’assurer au profit de Desmats l’exécution prolongée de la convention de 27 juillet ; considérant que, par cette convention, Desmats n’avait point stipulé que Chasseloup ne vendrait pas la carrière de Misangrin, sans son consentement, qu’il n’avait pas stipulé davantage que s’il la vendait il serait tenu d’engager ses acquéreurs dans les liens où il s’était engagé lui-même ; que le demandeur n’est pas, dès lors, recevable à exiger de Chasseloup de Châtillon en plus de son engagement psersonnel, qu’il a seul stipulé, la garantie gratuite d’un payement de la Compagnie Anglaise, soit envers Chasseloup de Châtillon, soit envers Desmats lui-même ; qu’aux termes de la convention du 27 juillet, qui ne doit être ni restreinte, ni étendue, le demandeur ne peut réclamer qu’une seule chose promise à savoir que Chasseloup de Châtillon lui fasse avoir n’importe comment et à quel prix la haute paie convenue de 10 francs par milliers d’ardoises s’il continue à travailler à la carrière de Misangrin ; que Chaseloup de Châtillon n’a point à rendre compte à Desmats des voies et moyens à l’aide desquels il remplira son engagement ; que l’heure, en un mot, de se plaindre ne sera venue pour le demandeur que quand Chasseloup de Châtillon niera l’obligation ou que quand Desmats justifiera que lui-même a cessé de travailler à la carrière de Misangrin, moyennant le salaire exceptionnel stipulé en la convention du 27 juillet, et ce par des circonstances indépendantes de sa volonté ; considérant que par plus après qu’avant la vente de la carrière de Misangrin, Chasseloup de Châtillon, qui n’avait pas été mis en demeure, n’était tenu de faire des offres de travail et de salaire à Desmats, que l’exploitation de la carrière continuant après la vente, c’était à Desmats à s’y présenter pour y travailler comme par le passé, à réclamer la haute paie convenue avec l’ancien propriétaire et en cas de refus, soit de travail, soit de paiement, à la faire constater régulièrement ; considérant qu’à supposer que l’on pût voir dans l’assignation, donnée par Barré huissier à Segré, non seulement une demande en dommages et intérêts, fondée sur l’inexécution prétendue de la convention verbale du 27 juillet, mais encore une sommation ou mise en demeure tardive, tendant au moins implicitement, à l’exécution de la convention dont s’agit, il faudrait alors reconnaître dans la dénégation par Chasseloup de l’inexécution de son obligaiton du fait de la Compagnie Anglaise, l’équivalent virtuel d’une offre de continuation à exécuter cette obligaiton par le même intermédiaire déjà agréé par Desmats, offre faite en temps utile et satisfactoire ;
Sur le deuxième chef de la demande de Desmats, considérant qu’il est allégué par Chasseloup de Châtillon et non contredit par Desmats qu’à la carrière de Misangrin le millier d’ardoises est compté aux ouvriers fendeurs sur le pied de mille soixante au lieu de mille ardoises ; considérant qu’une pratique analogue obligeant les ouvrier à ce qui est connu dans l’industrie sous le nom FOURNITURE, se retrouve dans toues les carrières d’ardoise ; considérant que ce qui est ambigü doit s’interpréter par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé, et qu’on doit suppléer dans les conventions, les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles ne soient pas exprimées ; considérant que, d’après ces règles, le millier d’ardoises dont il est question dans la convention du 25 juillet doit nécessairement être entendu non du millier mais de 1 060 ardoises, comme il est d’usage sur les lieux ; que ce qui prouve bien que les parties l’ont ainsi compris, c’est que Desmats a réclamé pour la première fois dans son assignaiton du 5 janvier 1867, contre un mode de supputation, remontant à plusieurs années ;
sur la demande en garantie : Considérant qu’il n’est pris aucune conclution contre les appelés en garantie, par ces motifs le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à Chasseloup de Châtillon de ce qu’il dénie formellement qu’à aucune époque antérieure à son exploit introductif d’instance, Desmats ait éprouvé aucun refus relativement à sa paie exceptionnelle de 10 francs par millier d’ardoises, dit qu’il n’est pas justifié, quant à présent, que Chasseloup de Châtillon ait cessé d’exécuter la convention verbale du 27 juillet 1862, soit par lui m ême, soit par l’intermédiaire de la Compagnie Anglaise qui lui a succédé dans l’exploitation de la carrière de Misangrin ; déboute en conséquence Desmats des demandes en dommages intérêts, fondée sur l’inexécution prétendue de la convention du 27 juillet ; déboute également Desmats du chef de sa demande tendant à ce que Chasseloup de Châtillon soit condemné à luy payer un supplément de prix sur les ardoises par lui fabriquées ; renvoit la Compagnie Anglaise hors de cour, sans dépens ; condamne Desmats en tous les frais de l’instance, sauf ceux de l’incident vidé par le jugement du 28 mai dernier
![]()
![]() Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos
Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos