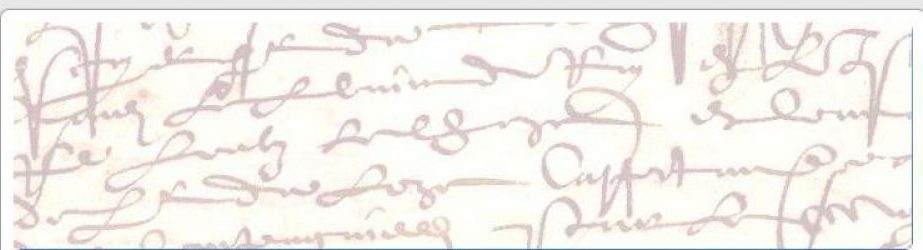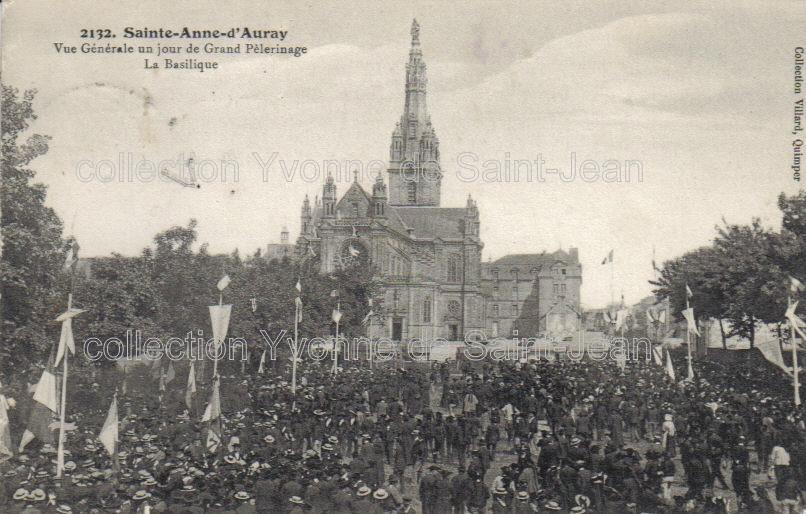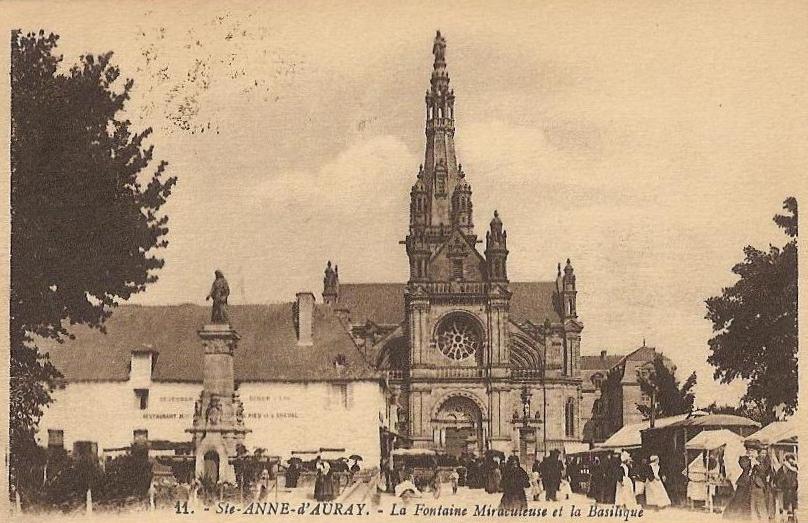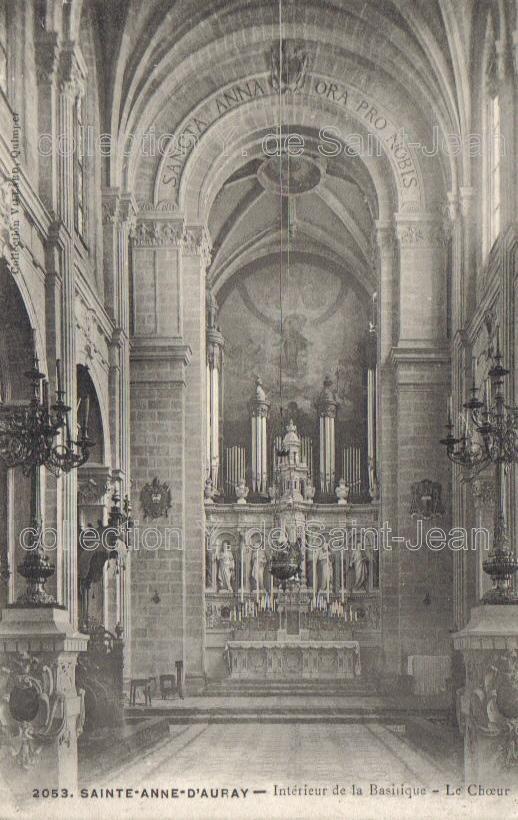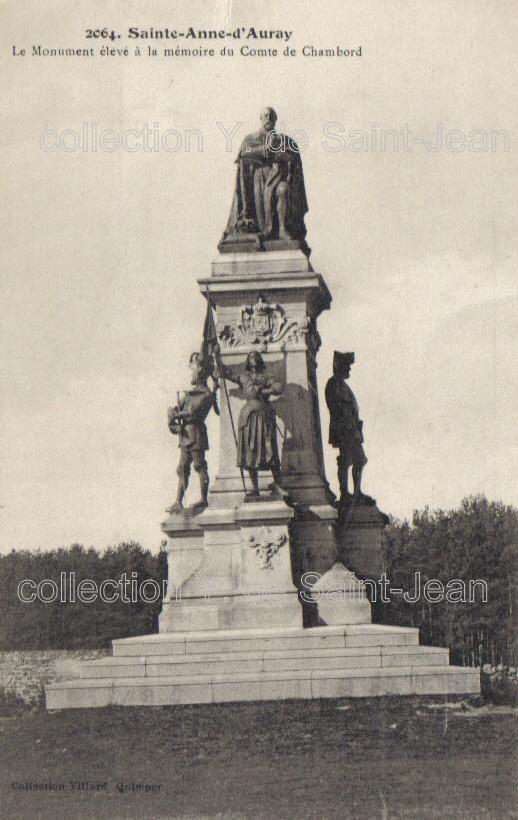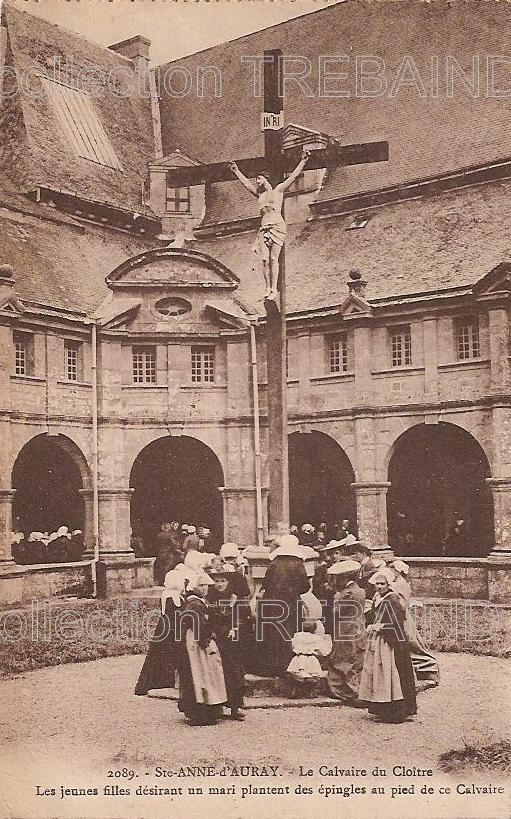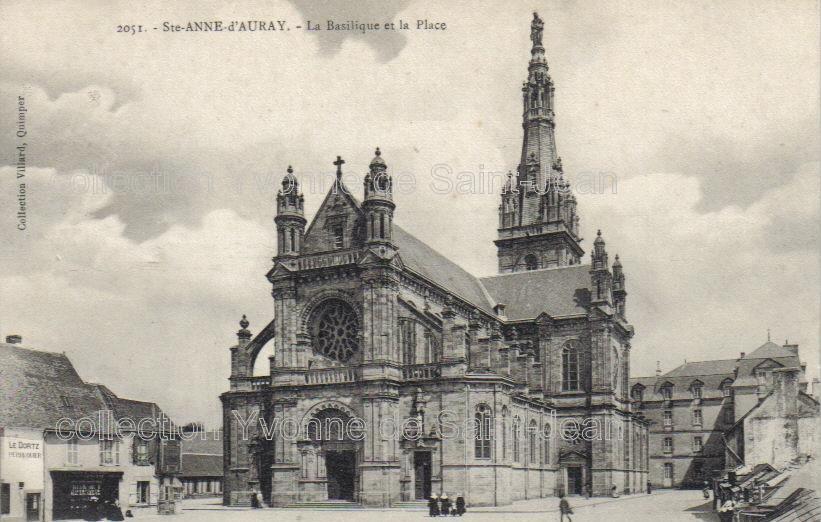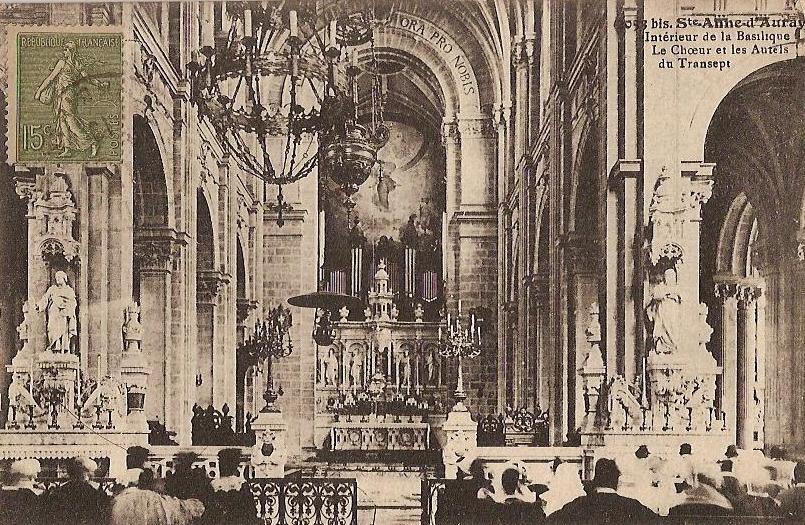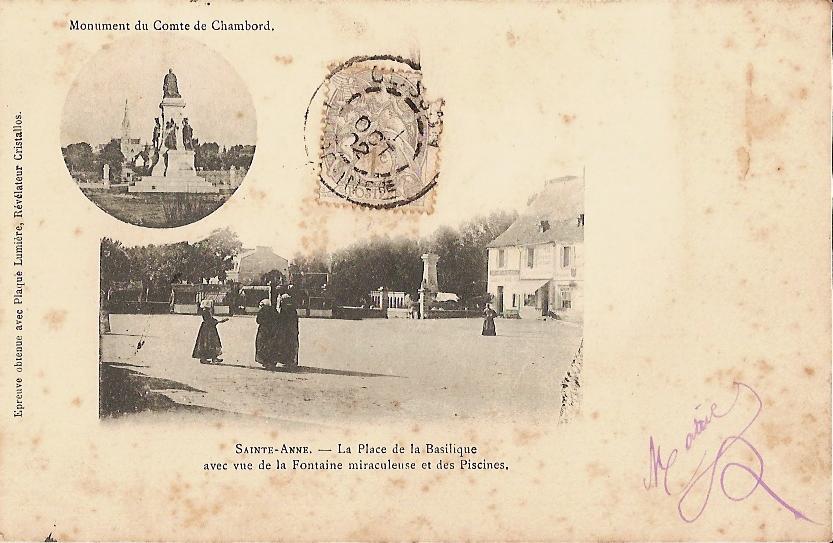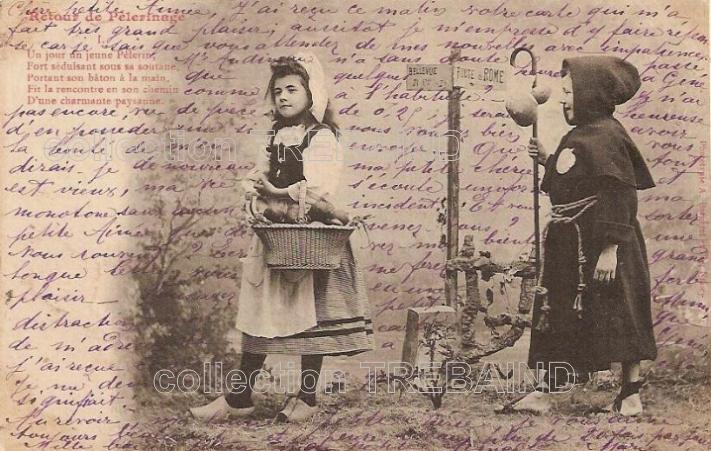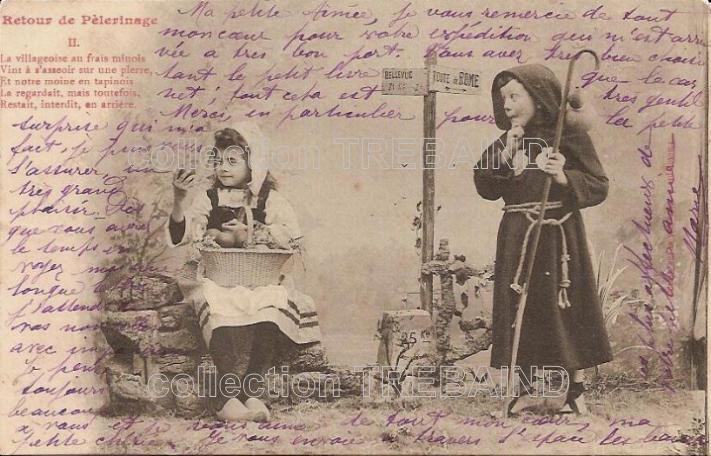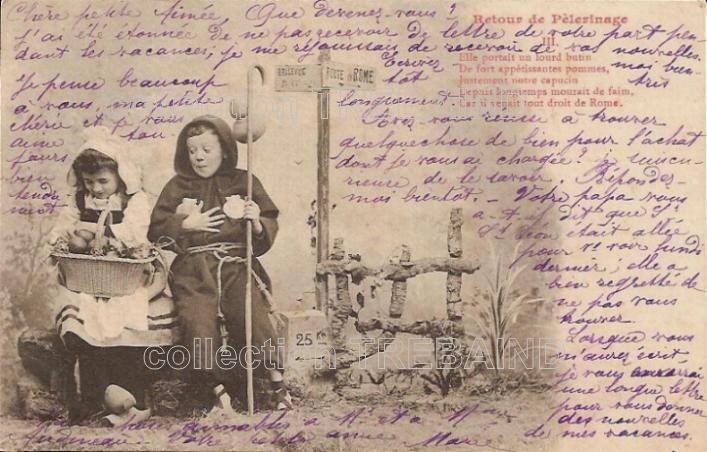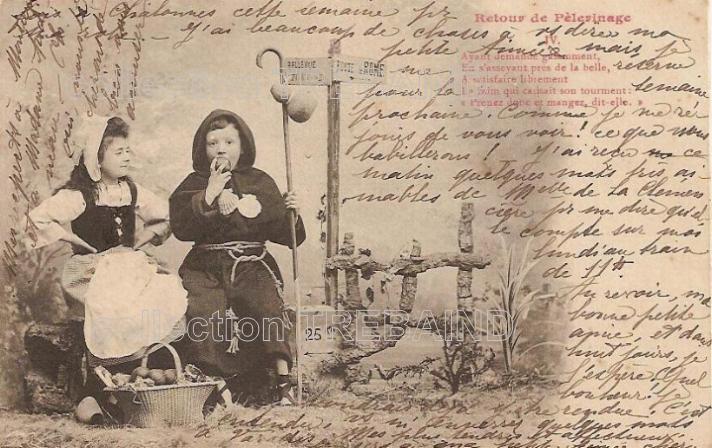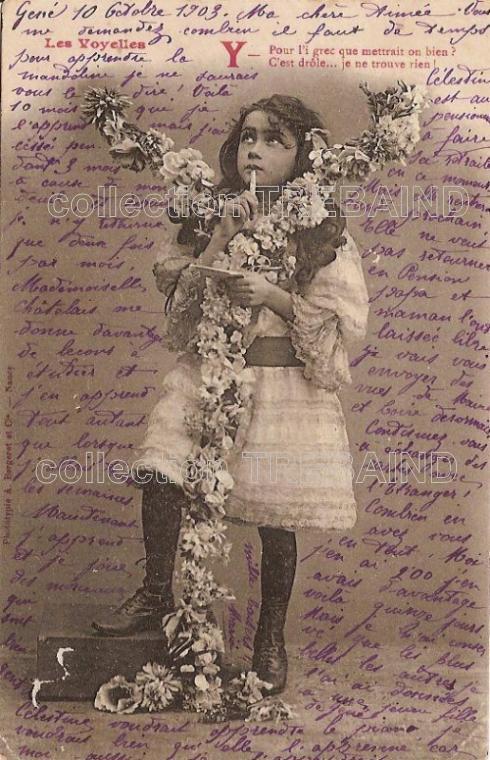Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, 1997 :
huitième : droit sur la vente au détail du vin, théoriquement fixé au hitième de la valeur de celui-ci, dans les pays sujets au droit de gros.
J’ai beaucoup d’actes concernant ce droit, en particulier des prises à sous-fermes dans certaines paroisses, etc… et généralement le montant est assez important.
On dit que c’était un impôt juste, comparé à la gabelle, injuste car payée par certains seulement, mais j’ai pourtant trouvé qu’en Normandie, par exemple, ce n’était pas le huitième, mais le quatrième.
Enfin, dans tous les actes notariés que j’ai déjà relevés sur le huitième en Anjou, il est toujours précisé sur tous les breuvages vendus au détail, ce qui signifie aussi le cidre, pas uniquement le vin.
Ici il est question d’un impayé d’un montant si ridiculement faible que je suis surprise de constater que pour s’en faire payer Jacques Allain ait entamé des poursuites, dont le coût est certainement supérieur à la somme due. Doit-on en conclure que la vente au détail de Busson est excessivement faible et que personne ne boit à Beaucouzé et St Nicolas ? J’en doute.
En 1543, les prénoms ont encore parfois une forme ancienne, ainsi Michau
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2
Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1543, devant Lemelle notaire Angers, sur les procès questions et débats qui estaient mus et pendants en la cour des eslus d’Angers entre Jacques Allain demandeur d’une part,
et Michau Busson défendeur d’autre part,
touchant le droit d’huictiesme de vin vendu au détail par ledit Busson au-dedans des paroisses de Beaucouzé et St Nicolas les Angers et dont plus ample mention est faicte par le procès sur ce mu et édifié
lesdites parties pour pled et procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié convenu entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, scavoir est que pour estre et demeurer ledit Busson en amitié vers ledit Allain qui l’acquite et quicte par ces présentes de ce dont il faisait question et demande ausit Busson pour raison du droit de huictiesme du vin vendu par ledit Busson au-dedans desdites paroisses de Beaucouzé et St Nicolas jusqu’au dernier jour de décembre passé, iceluy jour compris,
ledit Busson a promis audit Allain la somme de 32 sols 6 deniers dont il a payé présentement audit Allain 4 sols tournois et le reste payable dedand Pasques prochaine venante et en ce faisant et payant ladite somme lesdites parties sont et demeurent quicte l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont en despendent lesdites parties eussent pu et pouvaient faire question et demande ledit Allain jusqu’à ce jour à ce tenir etc se sont soubmis et obligés lesdites parties etc sous la cour royale Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers ès présence de Charles Raimbault et Jehan Le Bonnyer.
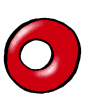
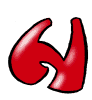 Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
![]()
![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.