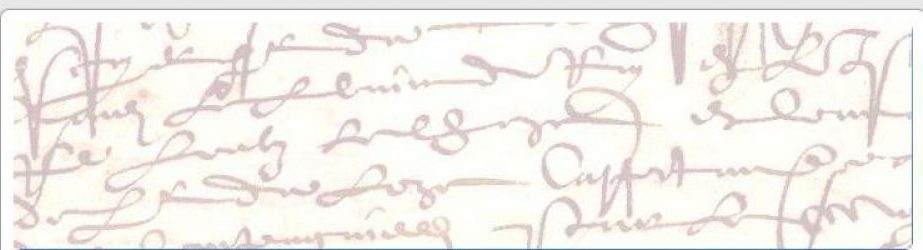Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
Chapitre XVI
Une Fête-Dieu en 1903
Et Jeanne et René vécurent ensemble.
Ils s’aimaient, inattentifs à la passion électorale qui remuait même les bourgeois placides et de la bonne ville des ducs de Bretagne. Une luxure d’affiches se vautrait sur les murs. Fraîchement et hâtivement collées ces déclarations sur papiers de couleur faisaient croire à de vieux oripeaux humides trouvés dans ses caves, que la cité étalait pour le séchage.
Un soir, le jeune homme rencontra son oncle Rachamps, mi-triste, mi-joyaux.
René, la réaction triomphe, je suis battu, mais le vieux Lorcin a reçu une forte déchirure dans sa voile.
Ah !
Viens prendre l’apéritif…OUi, René, le parti socialiste gagne plusieurs centaines de vois. Dans quelques années on les balayera comme des détritus gênants.
Il continua… puis il apprit à René que M. de Lorcin voulait l’interdire, qu’il avait fait quelques démarches à ce sujet, et qu’il était nécessaire de se méfier de lui.
Maintenant qu’il est vainqueur, ce vieux roublard sera dangereux… Et puis, ça le suffoque de te voir avec la petite Lonneril…Sais-tu à ce propos, que tu affliges ces braves gens ? Ils sont dans un grand chagrin et m’en veulent à moi… Enfin, je ne mêle de rien… cela vous regarde… viens dîner… nous causerons.
Le lendemain René ne se souvint que d’une chose : son oncle voulait le faire interdire. La colère le tourmenta pendant quelques jours, et n’y tenant plus, il se rendit un après-midi boulevard Delorme. On le fit entrer au salon, où son oncle pérorait parmi plusieurs électeurs influents.
Mon oncle, permettez-moi de vous offrir mes félicitations pour le succès que vous faîtes remporter à votre parti. Je ne croyais pas vous trouver en si grande compagnie, car je venais en même temps vous annoncer mon départ.
Où vas-tu ?
Oh ! Pas loin. Je suis fatigué de la ville, je vais habiter la campagne, une jolie petite maisonnette sur les bords de l’Erdre. J’y passerai l’été avec… ma maîtresse.
Hein !
Le mot est peut-être un peu impertinent, j’en conviens, mais n’est-ce pas le terme académique ? Ce n’est pas tout. Mon oncle Réchamps m’a appris votre intention de m’interdire. Ceci n’est pas sérieux, je suppose, car je ne suis ni fou, ni prodigue, j’use de ma fortune comme il me plaît, et puis, sur ce terrain, je me sens fort de ma victoire, malgré la bonne volontér d’un tribunal d’amis, autrement dit complices.
La vie que tu mènes depuis quelques mois est vraiement curieuse et scandaleuse pour notre nom. Le bon sens, les avertissements…
Les rapts avec violence…
N’y pouvant mettre ordre, nous nous voyons forcés d’essayer les grands remèdes.
Sans doute avec l’aide de ces messieurs ?
Parfaitement. Tous les gens honorables…
Vraiment. Qu’en fîtes-vous M. le baron des Valormets ? Et vous M. Varlette ? Et vous messieurs Séniland et Béthenie ?
Ce fut un brouhaha d’exclamations indignées.
René recula vers la porte et croisant les bras sur sa poitrine, il leur cria d’un ton sec et railleur.
C’est vous qui vous permettez de critiquer ma conduite ! Est-ce dans les maisons publiques messieurs Séniland et Béthenie, que vous prenez ce droit ? Le maudit hasard – peut-être la providence – en m’y faisant vous rencontrer, vous a fait une vilaine farce.
Monsieur, vous mentez…
Il haussa les épaules.
Si je m’amuse, moi, j’ai la jeunesse pour excuse, vous, vous n’avez pas le mariage, j’imagine ? Si je me suis égaré dans le vice des rues pendant quelques mois, c’est de votre faute. A Nantes, vous passez pour des cléricaux, eau bénite de pères les prudes, et la ville sous votre commandement est infestée, comme pas une ville du monde, d’un débordement malpropre de grues de toutes les catégories. A partir de cinq heures du soir on ne peut faire un pas sans se voir arrêter, coudoyer, interpeller par une de ces harpies, vos pensionnaires brévetées. J’ai réussi, je ne sais comment, bien malgré vous, à sortir de l’égoût. Je touve une amie, je l’emmène respirer un ai sain, loin des contaminures de vos vices. Je le fais hautement, et je me moque de vos menaces, mon oncle, car elles sont vaines. Je ne suis pas une femme que l’on effraie du commissaire de police, je me défendrai. Adieu, je vous quitte avec un seul regret, celui de vous voir adulé par des hypocrites et des misérables dont vous faîtes votre compagnie : un Varlette qui fait lécher chaque semaon son impuissance par deux petites gamines, un Valormets qui abuse de la pauvreté pour contenter ses vices et voles les femmes des malheureux, et d’autres encore qui ne valent guère mieux. Vous criez bien haut votre innocence, messieurs. Vos protestations seront écoutées de vos croyants, mais au fond du coeur, de vous à moi, vous sentze la vérité vous cingler la face de soufflets. Je vous méprise et je vous défie… mais ne bavez pas sur moi, ou je vous donnerais des coups de pieds dans la figure.
Les hommes se levèrent menaçants. M. de Lorcin s’avança, sévère, s’interposant.
René, on n’insulte pas les hôtes de son oncle ! Je te prie de sortir.
René avait-il jeté le désarroi dans le cam de ses ennemis ? Il n’entendit plus parler de la fameuse interdiction.
En errant leurs baisers par l’ensolleillement des environs de Nantes, ils avaient déniché un gentil pavillon encastré de verdure, dont les pelouses comme un frais tablier descendaient humecter son colant au courant de l’Erdre. A gauche, la Jonnelière étalait ses cafés et ses pontons, plus loin, le point du chemin de fer barrait de son arc géant le fronton de la vallée où doucement se promenait la rivière.
Comme il l’avait dit à son oncle, René quitta la rue Saint-Pierre, sa chambre était trop étroite et trop sombre pour l’épanouissement de son amour d’été. Ils s’intallèrent aussitôt dans un mobilier neuf et délicat. A l’écart, ils tissaient dans le calme les tapisseries de leurs amours. La campagne si triste et si mélancolique malgré ses habits de fleurs et de verdures lorsqu’on est seul, devient un théâtre féérique à décors nouveaux quand deux amants y mêlent leurs pas légers comme leurs caresses.
Le dimance, l’Erdre se couvrait de canots. La rivière semblait une vitre sur laquelle courent des mouches. Les chansons folles se trémoussent d’aise. Et l’on rit, et l’on s’embrasse à pleine bouche sur l’eau. Courbés par le vent, les voiliers filent comme les volants d’un jeu de raquette. Les vapeurs, qui font le service d’été, fument, sifflent, troublent l’onde de leur museau tranchant. L’écume vient heurter les roseaux des rives et s’accrocher aux cils des nénuphars.
L’air tourbillonne en ses arceaux les cris de la Jonnelière envahie par les nantais qui vont s’y donner l’illusion d’une partie de campagne en buvant de la bière, de la limonade et croquant dse galettes sous la tonnelle d’un cabaret.
Ils y allaient quelquefois. Comme des enfants, ils se balançaient, jouaient aux boules, graissaient leurs doigts aux galettes. La musique, elle aussi, faisait son excursion. Un vieux bonhomme, haut comme une botte de gendarme, grinçait de sa vielle, gagnant quelques sous parmi les générosités du dimanche.
Le monde des commis et des ouvrières venait prendre provision d’air et d’insouciance, après le renfermé de la semaine dans leurs ateliers clos où les poumons sont mal à l’aise. A la tombée du jour, tous les oiseaux rentrent à la cage, et les derniers refrains s’emplissent d’un au revoir gamin au soleil mourant de la liberté hebdomadaire.
Après le dîner, tout s’était tu. Assis l’un près de l’autre sur la pelouse, ils regardaient la pluie noire enlacer les bords de l’Erdre. La brise fraîche ondulait des frissons par les choses qui se reposaient. La rivière clapotinait comme un petit chien qui ronge un os sous la table. Les étoiles, une à une, mettaient le nez à la fenêtre pour contempler la terre à l’orée du sommeil. La lune aussi roula sa face bouffie.
Les amants tressaillirent ; leurs bouches se cherchèrent. Ils se laissèrent glisser sur l’herbe tendre. Quelques agrafes craquèrent ; l’étoffe eut un léger froufrou. L’ombre blême de la lune enlinceula de ses traînées éparses la douceur infinie de l’aimer.
René venait parfois en ville pour ses affaires. Or, un jour de pluis qu’il passait par la place Saint-Pierre, il vit la cathédrale emmaillotée d’échafaudages grotesques, et des hommes qui la grattaient impitoyablement. Les pellicules blanches ruillselaient partout. Le jeune homme sentit au coeur une cruelle blessure et son âme se meurtrir de colère. Il rentra chez lui furieux.
A l’heure du dîner, Jeanne, ne le voyant par descendre de sa chambre, où il s’était enfermé, monta le chercher. Elle le trouva dans une grande exaltation au milieu d’une avalanche de papiers et de notes.
Dès qu’il l’aperçut, il lui conta ce qu’il avait vu.
J’ai été si douloureusement impressionné, qu’il m’a fallu confier mon âme à quelqu’un. Je l’ai fait à moi-même et j’ai noté les confidences une à une. Ecoute :
René lut, avec une émotion intense, le récit de son âme chagrine et révoltée (Article paru le 10 octobre 1903 dans « Nantes-la-Grise » revue littéraire, artistique et théâtrale fondée par l’auteur.)
Il pleut. Avec une douceur lente d’amoureuse la pluie s’en vient frotter la figure pâle des maisons et les toits qu’elle caresse ont des sourires humides de volupté.
Je suis sorti cependant. Sous mon parapluie, je m’achemine au long des murs, perdu dans des haleines subtiles de brouillard, reconnaissant bien ma ville à son âme qui se vaporisait
Peu de monde. On me croyait seul, un rêveur, alors que la pluie causait avec moi. Elle babillait sur la soir de mon « pépin », gamine heureuse qui vous confie d’interminables suites de choses inattendues.
J’allais au hasard, je ne sais plus, heureux d’avoir sa compagnie dans l’ambiance monotone et somnolente.
C’étaient les arbres renfrognés hérissant leurs feuilles alourdies. C’étaient les quais déserts avec les chalands en chiens de garde accroupis près des pâtés de sable et des tartines crêmeuses de tuffeaux. C’étaient les coinquements affolés des tramways crvant la pluie et pissant de la fumée sur les rails. Enfin, la grande cathédrale, comme une difficile énigme de siècles effrondrés, sa base crispée sur le front de la ville, son dos si haut, si perdu dans la brume qu’il semblait former le socle des cieux.
Pauvre vieille, cassée entre les béquilles qu’on lui impose ! Elle m’a parue bien peinée, bien triste ! La pluie sur sa façade formait de grosses larmes qui ruisselaient. Tout près d’elle, j’ai cru l’entendre parler : plainte d’une séculaire qui ne veut plus rien, sinon qu’on la laisse mourir en paix, descendre morceaux par morceaux vers une immortalité de ruines.
A quoi bon les vains remères, les cautères inutiles ! A quoi bon la martyriser, rabougrir son orgueil énergique d’antan par des replâtrages honteux et ridicules ainsi qu’une vieille cocotte dont on veut cacher les rices ! Un balai contre cette clique de chirurgiens, d’apothicaires, de rabouteux qui tourmentent sa gigantesque et noble agonie ! un bailai contre tous ces vaniteux d’une science imbécile qui n’a pas plus d’effet que le coup de pied de l’âme !
Et sa tristesse persistante me disait :
« Venez vous seuls, mes aimés, vous qui n’avez que de douces paroles. Prenez place à mon chevet. Contez-moi vos rêves d’aujourd’hui, je vous conterai en bonne grand’mère ceux de vos aînée. Vous comprendrez en moi une race d’aïeux dont vous n’êtes qu’un banal reflet
Tout passe, tout se lasse. La pourpre, l’or, ni les cuirasses ne brillent sous les rayons jaloux du soleil ; les étendard de triomphe ne flottent plus autour de moi, la foule des fidèles n’a plus la foie crédule et splendide d’autrefois. Tout est rapiécé.
Les barbares jadis envoyaient contre ma grandeur l’océan en furie de leur haine. Ils allumaient des brasiers hauts comme des montagnes pour m’ensevelir et faire taire ma voix dominatrice. Ils avaient alors la colère du temps et des orages. Et quand je succombais, des mains géantes me relevaient sur ma défaite éclatante.
Les petits chefs minuscules de votre temps n’ont plus de haches, ni de béliers, ils prennent des ciseaux, des maillets, des rabots, ils grattent, creusent, piquent. Que faire contre cette gale inconsciente qui me ronge aussi lâchement que bêtement ?
Nantes, dont je suis la synthèse formidable de son histoire m’abandonne. Elle me laisse, comme un joujou usé, déchiqueter par les fourmis et la vermine de l’obscutiré. Elle supporte impassible que l’on masque aux générations les cicatrices gravées par les Normands et les Sans-Culottes sur mes vieilles chairs.
Vous, défendez-moi, ou pleurez avec moi. Soyez l’écho de mon impuissance, vous qui me savez vivre d’une autre vie que la vôtre. »
Elle s’était tue ! … Ce n’était qu’une illusion. La voix était venue des pores de la pierre me toucher en plein coeur.
Mais que puis-je faire ? Dire à tous ce qu’elle m’a dit ? Me croira-t-on ? On rira simplement : c’est un fou, pensez-donc ! Et le vingtième siècle avancé chantera sur la place Saint Pierre un « Viens Poupoule » d’un air de « Je m’en fiche », tandis que le bruit du facé concert en délire assourdira les grincements des gratteurs sur les pierres d’une de nos plus merveilleuses cathédrales de France.
Ah ! s’il plaisait à Dieu que je fusse le maître, je la laisserais s’écrouler seule, et le soir, parmi ses ruines comme des lambeaux d’âme, j’irais apprendre une leçon que l’on a oubliée. Je ne vomirais pas sur les flancs respectables une armée mesquine pour se gaver de poussière et salir sa face d’échafaudaes grotesques. Car je ne suis pas le rustre qui, trouvant un blanson dans son champ, ne lève même pas le soc de la charrue pour l’éviter.
Je lui sonnerais au contraire mon meilleur fauteuil de calme et de tendresse, cependant qu’assis dévotement à ses pieds sur un modeste tabouret, je l’écouterais souffler en mon âme docile les parcelles d’une tradition bien morte de colossale beauté. »
Alors l’âme nantaise de la petite Lonneril s’éveilla dans un sourire bénin.
Mais tu es fou avec ton boniment. Qu’est-ce que cela peut te faire. Elle sera plus propre, si on la gratte, voilà tout.
Stupéfait, René la regarda comme un aigle qui vient de tomber du haut d’une montagne, les ailes coupées. L’antagonisme de leurs deux races cassa le rêve insensé qu’il avait cru. Il lui dit avec une lourde ironie
Une fois qu’elle sera grattée, on doit la laver avec nos pompes à indendie pour enlever la poussière
Ah !
Nous irons ensemble voir ce grand débarbouillage. On le fait tous les cent ans à la cathédrale de Paris
?!?!
Les jours succédèrent aux jours. Leur vie ne variait guère, si ce n’est qu’ils s’apaisaient. Lui, s’était remis à l’étude, se sentant absolument seul ; elle, se faisait appeler madame de Lorcin.
Jeanne arrangeait sa vie de petite bourgeoise avec cet égoïsme particulier aux nantais. Elle potinait chez les voisins et les fournisseurs, parlait souvent de son « mari », portait ostensiblement une alliance au doigt. Il lui laissait toute liberté, même en en souffrant, sans jamais la contrarier. Elle était toujours pour lui l’amante qui se laisse faire, qui s’abandonne à chacun de ses désirs avec un sourire si heureux et si câlin. Cependant l’ennui commençait à le tourmenter, la solitude lui pesait. Certaines heures, il aurait eu besoin d’un ami. Jeanne, prête aux caresses, aux baisers, était distraite à ses propos intimes. Il confia son chagrin à Delange par de longues lettres presque quotidiennes. Le peintre lui répondait, l’encourageait, le suppliait de quitter la province, de venir près de lui. Il lui rappelait ses avertissements au sujet de sa maîtresse. Ses sens l’avaient aveuglé. Comme ses pareilles, Jeanne était l’incarnation de l’âme bourgeoise nantaise, vide de tout penser immatériel. Tombé dans un engrenage périlleux, s’il ne luttait pas dès maintenant, il s’affaiblirait et s’annilhilerait bientôt à toute oeuvre intelligente.
René avait en vain cherché des motifs de séparation. Les pleurs avaient toujours eu raison de ses velléités. Comment résister à cette soumission perpétuelle ? Comment briser cette petite poupée heureuse de sa nouvelle existence ? Comment aurait-il pu trouver au fond de son coeur la méchanceté nécessaire à cette mauvaise action ?
Le mois de mai s’en était allé se perdre au labyrinthe du passé. Juin collait à son tour son front brûlant au vitrail de l’été. Un dimanche matin René dit à son amie.
Prends ta plus belle robe, nous allons voir les processions de la Fête-Dieu !
Vers neuf heures, ils entrèrent en ville. La foule se pressait. On mettait la dernière main aux guirlandes des rues pavoisées comme des rosières. Le ciel s’assombrissait, des gouttelettes d’eau filtraient des nuages gris. Les cloches de la cathédrale carillonnaient fanfaronnes, parsemant dans l’espace leur appel vibrant. Ils arrivèrent sur la place Saint-Pierre lourde de monde. Et quand tous attendaient paisiblement la sortie de la procession, on vit arriver des hommes noirs avec des sous-ventrières tricolores qui gesticulèrent comme des mannequins mécaniques. On vit des sergots refouler les spectateurs le long des trottoirs et des bandes brutales se parquer dans la rue de Châteaudun. Soudain des képis bleus apparurent caracolant sur leurs chevaux. Mais voici que les képis bleus poussèrent leurs chevaux contre les assistants avec bestialité et qu’ils firent des rondes au cendre de la place. Un grand murmure courut de ce burlesque carrousel. Le préfet venait d’interdire la procession. C’était la première fois depuis longtemps qu’un homme avait l’audace d’interrompre une coutume nantaise. Un moment de stupeur passa. Les plus paisibles des commerçants grondèrent. Les catholiques massaient sur les marches de l’église, armés de bâtons ; d’autres étaient partis processionner dans les rues de la ville. Ils entrèrent quelques-uns dans la préfecture, mais la bravoure n’étant pas la vertu des bourgeois, ils ressortirent aussitôt, effrayés de leur vaillance et restèrent derrière la grille d’entrée. Leur lâcheté les enragea, ils brisèrent deux malheureuses guérites, victimes bien innocnentes, ccassèrent une sonnette… puis, énivrés par leur triomphe, élevèrent des barricades avec des barrières en bois vert dans la rue Royale. Ils se battirent contre les gendarmems, rossant leur chef d’importance. Sur la place un grand remous se produisit. Comme balayé par un vent terrible les assistants courbaient la tête et ployaient les genoux. Sous le porche de l’église, Mgr Rouard, évêque de Nantes, offrait l’ostensoir d’or ainsi qu’un fulgureux soleil levant, et donnait solennellement la bénédiction. Un silence plein de fois couvrit la grande place ; à peins quelques rugissements de brutes troublèrent le geste infini d’un Dieu captif qui se montre par la lucarne de sa prison à la foule de ses serviteurs incapables de le délivrer.
Ce fut tout. Un résumé de beaucoup de bruit, et de bruit inutile.
René n’avait cessé de sourire à cette agitation grotesque de la force armée et de la colère des catholiques, du chef des képis bleus, à pied, une canne à la main, de l’autre, une cravache comme un vulgaire argousin. Parfois un homme passait, acclamé, les menottes aux mains entouré de quatre ou cinq gendarmes. On demandait : qu’a t-il tué ? Un homme ! un gendarme ! Non, il a effleuré la queue d’un cheval, la botte d’un pandor : non, il s’est laissé marcher sur la pied par cocotte sans lui dire merci ; non, c’est un pendable, il a crié : vive la Liberté. Tant pis pour lui. Est-ce que l’on applaudit les régimes disparus ?
Les échafaudages emprisonnaient les membres de la cathédrale, dressant sa formidable enverdure en face la tourbe des pygmées. Jadis, lorsque son carillon sonnait l’alarme, les fidèles accouraient prêts à lutter jusqu’au dernier soupir pour elle. L’évêque se serait mis au sommet des marches, aurait présidé la bataille et béni de son geste les râles des mourants. Qu’auraient fait quelques gendarmes en quête d’avancement, quelques commissaires de police, devant la foi sublime et insensée d’un peuple révolté ayant dans les veines du sang de fer ? L’on j’aurait pas brisé des guérites, mais des crânes. Et elle, la Cathédrale, dominant de son orgueil la bataille, fière de ses féaux, elle aurait déployé l’étendart triomphal de son ombre, éblouissant les valets d’un préfet quelconque ou d’un gouverneur ambitieux.
L’or, le traitement n’étaient pas encore venus salir l’âme des prêtres. Le sang des catholiques n’était pas avachi. Ce n’est plus le même coeur qui battait sous les pourpoints de cuirs ou de soie, qui s’épouvante maintenant sous la redingote boutonnée. Misérable semence qui frétille, que l’on mène tête basse à coups de fouets ! Ils grondent comme des chiens battus. Ils rendent le grandiose ridicule. Ils se dispersent peu à peu dans les rues. Oh ! Ils en causent beaucoup au fond de leurs fauteuils. Ils parlent de luttes futures, de revanches impitoyables en sirotant leurs cafés. Leurs cris ont à peine troublé la somnolence de la cathédrale. Cependant plus d’un sera convaincu s’être montré un héros pour avoir brandi une canne contre un pauvre cheval de gendarme. Il est vrai que des juges pousseront la plaisanterie jusqu’à punir de prison quelques braillards à la voix plus forte, complices d’une farce grotesque à laquelle ils s’en voudraient, certes, de ne pas se joindre.
Le charlatanisme s’infiltre partout comme une eau d’inondation. Magistrature, armée, ministres des cultres, tous pantins ridicules de foire, ex-titans de granit rapetissés par leur siècle de plâtre. Leurs gestes ne sont plus que des ombres chinoises sur un mur mal éclairé. C’en est fini de la noblesse de la lutte, la mode en est aux pantalonnages. En ce jour, la ville d’un élan unanime s’y adonne. Autour des églises, où les curés peureux font du zèle en chaussons, se tassent la foule des badauds, mimant avec une précision comique le joyeux couplet :
Quant un gendarme rit
Dans la gendarmerie
Tous les gendarmes rient
Dans la gendarmerie
Au centre d’un bagarre un bonhomme « socio » s’affale sur le trottoir. Ses citoyens-frères s’émeutent à propos de la mort du vieillard, mort que l’on exploitera avec une impudence politicienne. On fera des pélerinages annuels et civils sur la tombe du marture de l’anévrisme. Les bourgeois en auront la frousse pendant huit jours. Ça calmera le vent guerrier qui vient de soulever les pans de leurs redingotes. Leur coeur sera terrifié de l’accusation lancée contre eux : « Assassins ! ». Mais bientôt ils reprendront leurs sens disloqués. Leur majesté irrévocable saura défendre la pureté de leurs actes. « L’émotion peut hâter la mort d’un vieillard, la fougue, surtout la nôtre, n’est capable que de briser que des guérites préfectorales ».
A la nuit tombante, Jeanne et René reprenaient le chemin de leur nid. La ville fatiguée s’était isolée au fond de son alcôve de brumes. Une à une ses veilleuses s’éteignaient. Avant de souffler la chandelle le mari contait à son épouse les atrocités des bagarres, les blessures béantes, le sang giclant, les yeux bondissant de l’orbite. L’épouse admirait l’exaltation magnanime de l’époux. La première fois sans doute qu’ils vivaient de chimères.
Le drap noir du sommeil couvrait la ville ; la ville qui oubliait, la ville qui reprenait sa tranquillité morne. La ville qu’une velléité belliqueuse avait endolorie, à laquelle il fallait le repos habituel ; la ville s’étalant sur le matelas moëlleux de sa boue visqueuse, et qui saigne du moindre effort pour s’en décoller.
La colère du boeuf est vaine, il reprend son allure placide en recreusant les éternels sillons.
Ludovic Garnica de la Cruz. Nantes la brume. 1905. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.
NANTES LA BRUME, Ludovic Garnica de la Cruz, 1905
1 : le brouillard
2 : la ville
3 : la batonnier et l’armateur
4 : le peintre
5 : le clan des maîtres
6 : rue Prémion
7 : labyrinthe urbain
7 : labyrinthe urbain – fin
8 : les écailles
9 : emprises mesquines
10 : carnaval
11 : le cul-de-sac
11 : le cul-de-sac – suite
11 : le cul de sac – fin
12 : les portes de Neptune
13 : Cueillettes d’avril
14 : Moisson d’exil
15 : Les courses
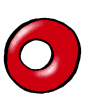
 Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.